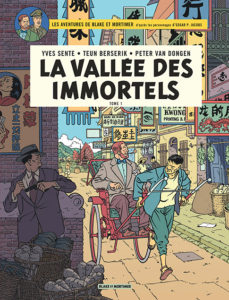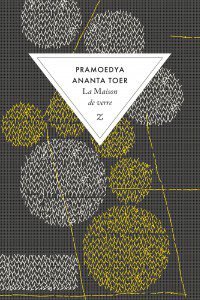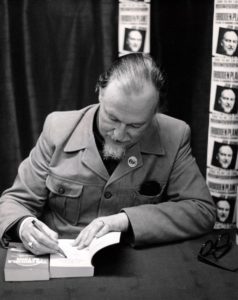Après Après avoir été bouleversés par son « Magnificat » lors du Festival Premières en 2011 puis par son « Requiemachine » en 2013 co-produit par Le Maillon, nous sommes réjouis en découvrant que Le Maillon avait programmé l « Hymn to love » de Marta Gornicka et nous l’attendions avec grande impatience.
Et ce fut, comme on le prévoyait un grand moment, un de ceux qui nous emmènent, nous transportent, nous plongent dans l’irrémédiable beauté d’un spectacle original, que l’on peut qualifier de « parfait » parce qu’il dit tout et porte avec justesse la critique de la réalité sociale et politique qui se vit actuellement aussi bien en Pologne que dans beaucoup de pays occidentaux en pleine crise d’identité.
Il le dit avec cette façon très particulière que Marta Gornicka a imaginée pour porter haut et fort les critiques qu’elle juge indispensables et qui doivent être communiquées au plus grand nombre. Son outil, est ce choeur, cet ensemble de plus de vingt personnes qui, à l’image de la société se compose de gens aux allures, aux âges très divers, de conditions différentes, parmi elles on y repère aussi bien un enfant qu’une trisomique. C’est un corps aux multiples visages dont la force, l’énergie nous galvanise par sa détermination à nous faire entendre, à travers des chants magnifiquement interprétés, ce message qui dit à la fois l’amour du pays et la catastrophe quand il devient nationalisme ardent, refus de l’histoire, dédouanement pour un passé douteux pour ces crimes de guerre qui ont eu lieu sur le sol de la Pologne.
C’est aussi un corps chorégraphié qui s’avance vers nous, martelant le sol se disloquant parfois avant de se reconstituer par petits groupes, défilant de façon martiale, portant sur le public des regards pénétrants.
Ainsi nous nous trouvons immanquablement impliqués et saluons l’habilité de la metteure en scène qui a su se servir pour écrire le texte de ce spectacle des chants traditionnels, patriotiques de son pays, montrer de manière enthousiasmante les dangers d’un nationalisme qui de fait jour chez eux et se fait galopant un peu partout, s’accompagnant de ce refus de s’ouvrir aux autres pour sauvegarder une « intégrité » dont on sait qu’elle conduit au repli sur soi, à la haine des étrangers voire aux exactions criminelles.
Merci à Marta Gornicka et à ce magnifique ensemble pour ce superbe et nécessaire avertissement.
Il est vraiment dommage qu’un incident technique ait conduit à annuler la seconde représentation au grand dam de ceux qui désiraient fortement voir ce spectacle.
Marie-Françoise Grislin avoir été bouleversés par son « Magnificat » lors du Festival Premières en 2011 puis par son « Requiemachine » en 2013 co-produit par Le Maillon, nous sommes réjouis en découvrant que Le Maillon avait programmé l « Hymn to love » de Marta Gornicka et nous l’attendions avec grande impatience.
Et ce fut, comme on le prévoyait un grand moment, un de ceux qui nous emmènent, nous transportent, nous plongent dans l’irrémédiable beauté d’un spectacle original, que l’on peut qualifier de « parfait » parce qu’il dit tout et porte avec justesse la critique de la réalité sociale et politique qui se vit actuellement aussi bien en Pologne que dans beaucoup de pays occidentaux en pleine crise d’identité.
Il le dit avec cette façon très particulière que Marta Gornicka a imaginée pour porter haut et fort les critiques qu’elle juge indispensables et qui doivent être communiquées au plus grand nombre. Son outil, est ce choeur, cet ensemble de plus de vingt personnes qui, à l’image de la société se compose de gens aux allures, aux âges très divers, de conditions différentes, parmi elles on y repère aussi bien un enfant qu’une trisomique. C’est un corps aux multiples visages dont la force, l’énergie nous galvanise par sa détermination à nous faire entendre, à travers des chants magnifiquement interprétés, ce message qui dit à la fois l’amour du pays et la catastrophe quand il devient nationalisme ardent, refus de l’histoire, dédouanement pour un passé douteux pour ces crimes de guerre qui ont eu lieu sur le sol de la Pologne.
C’est aussi un corps chorégraphié qui s’avance vers nous, martelant le sol se disloquant parfois avant de se reconstituer par petits groupes, défilant de façon martiale, portant sur le public des regards pénétrants.
Ainsi nous nous trouvons immanquablement impliqués et saluons l’habilité de la metteure en scène qui a su se servir pour écrire le texte de ce spectacle des chants traditionnels, patriotiques de son pays, montrer de manière enthousiasmante les dangers d’un nationalisme qui de fait jour chez eux et se fait galopant un peu partout, s’accompagnant de ce refus de s’ouvrir aux autres pour sauvegarder une « intégrité » dont on sait qu’elle conduit au repli sur soi, à la haine des étrangers voire aux exactions criminelles.
Merci à Marta Gornicka et à ce magnifique ensemble pour ce superbe et nécessaire avertissement.
Il est vraiment dommage qu’un incident technique ait conduit à annuler la seconde représentation au grand dam de ceux qui désiraient fortement voir ce spectacle.
Marie-Françoise Grislin
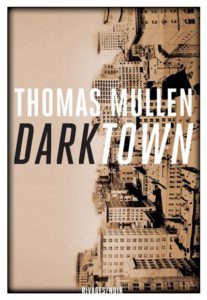 Thomas Mullen
Thomas Mullen