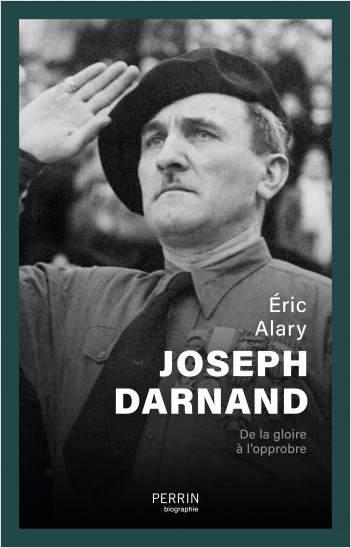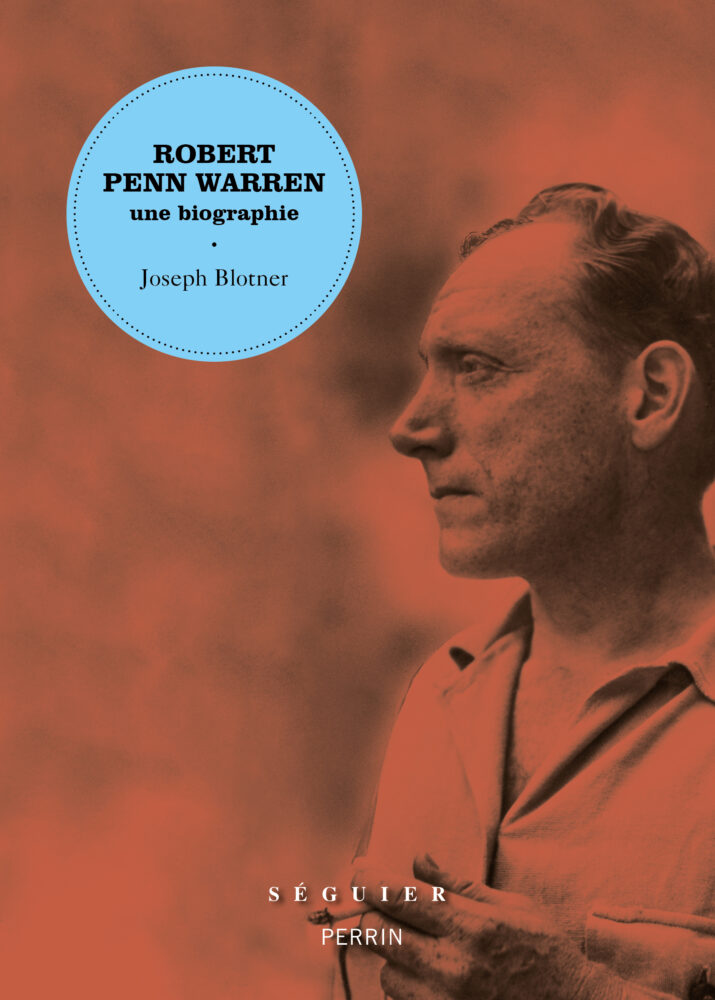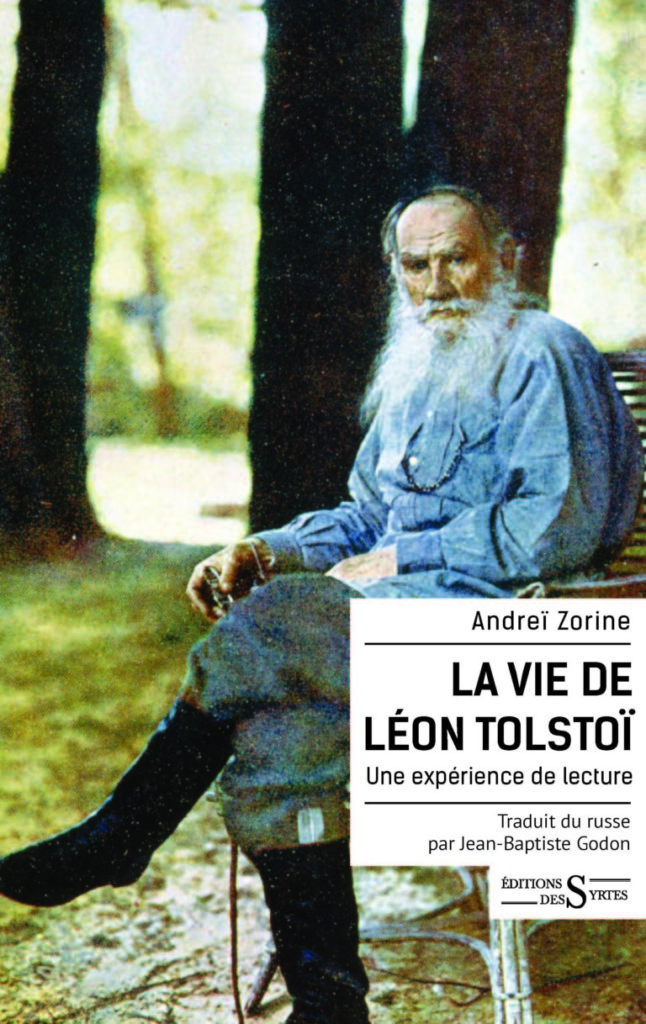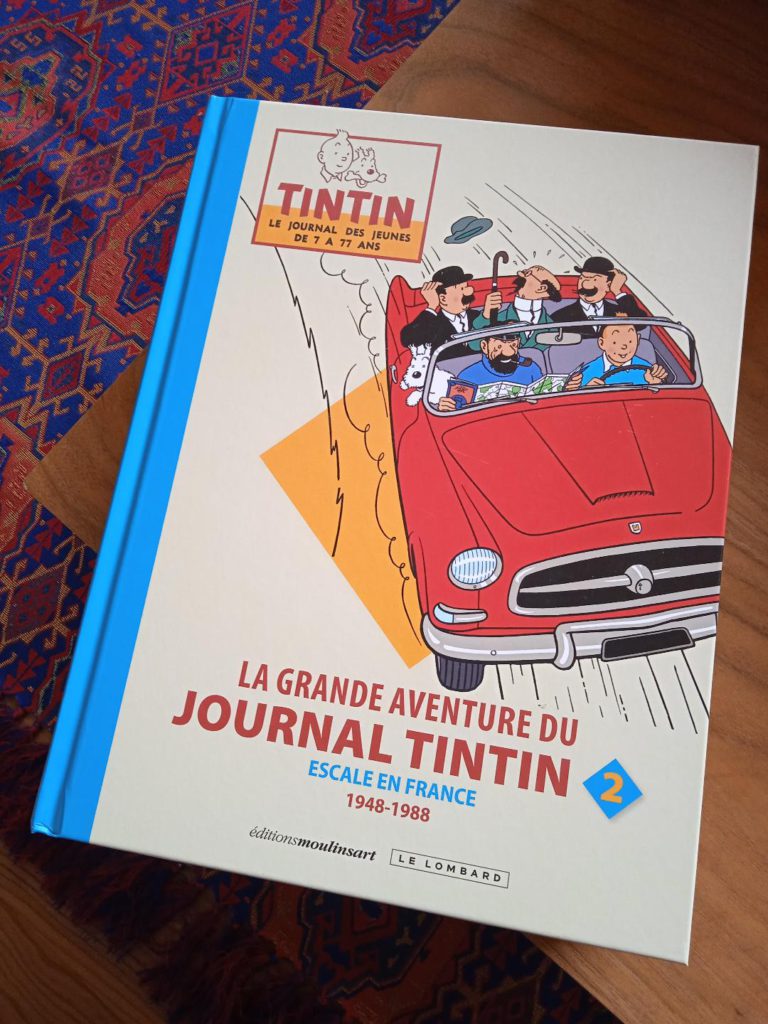Le Musée d’art moderne de la ville de Paris consacre une magnifique rétrospective à Nicolas de Staël
Si vie tant artistique que personnelle fut une celle d’une comète. Mais à en juger par l’affluence aux premiers jours de l’impressionnante rétrospective que lui consacre le musée d’art moderne de la ville de Paris, la queue de cette comète brille encore, quelques soixante-dix ans après sa mort, de ses feux les plus éclatants.

Marseille, 1954, collection privée
Des feux qu’il vola tour à tour aux dieux de Sicile et aux reflets d’argent de Normandie et de cuivre de Provence et qui constituèrent une œuvre « curieusement décalée, semblable à l’homme, ombrageuse mais solaire. Sensible et d’une rigueur, ou d’une détermination, qui porte ces quinze ans de travail bloc » assure ainsi Fabrice Hergott, directeur du musée d’art moderne de la ville de Paris dans l’avant-propos du très beau catalogue qui accompagne cette exposition. A travers près de 200 œuvres dont un certain nombre tirées de collections particulières montrées pour la première fois, le visiteur assiste à la lente transformation du peintre en génie. Car le voleur de feu réussit très vite à domestiquer et à transformer ce dernier au gré de ses voyages pour lui donner des airs de tempête de couleurs avec ses verts éclatants ou ses roses émouvants. Derrière nous, des spectatrices s’émeuvent toujours autant du caractère révolutionnaire de sa peinture qui continue de consumer leurs coeurs. « Il a cassé tous les codes » lance ainsi l’une d’elles.
Bien décidée à sortir Nicolas de Staël des frontières picturales posthumes dans lesquelles le monde de l’art tenta de l’enfermer alors qu’il les traversa à maintes reprises, l’exposition explore tant la dimension figurative que l’abstraction d’une œuvre conçue avec un identique génie. Il suffit de contempler la série sur le football avec le magnifique Parc des Princes (1952) tiré d’une collection particulière et qui constitue l’un des points d’orgue de l’exposition pour se convaincre de sa perception unique du spectacle du monde.
Dans son atelier rue Gauguet ou devant sa palette, l’exposition offre au visiteur la possibilité d’entrer dans le brasier de la création d’un peintre bâtissant ses tableaux par aplats successifs réalisés au couteau et avec un pinceau à la main devant ces magnifiques encres de Chine.
C’est à Antibes, devant un soleil couchant s’éteignant dans une Méditerranée dont il emprunta l’éclat pour composer ces derniers chefs d’œuvres comme Marine la nuit (1954) ou Marseille (1954) que la comète devint astre, astre qui aujourd’hui encore rayonne sur la peinture contemporaine. Un astre libérant un feu qui, grâce à cette merveilleuse exposition, continue de briller sur le monde et sur nos esprits.
Par Laurent Pfaadt
Nicolas de Staël, la peinture comme un feu, Musée d’art moderne de la ville de Paris
Jusqu’au 21 janvier 2024.
A lire le catalogue de l’exposition, Stéphane Lambert, Nicolas de Staël, la peinture comme un feu
Chez Gallimard, 224 p.