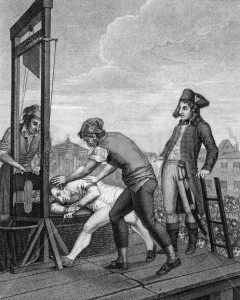Des best-sellers de l’Antiquité à redécouvrir
Des best-sellers de l’Antiquité à redécouvrir
Ils furent les Misérables et les Trois Mousquetaires de l’Antiquité.
Aujourd’hui, plus personne ne les connaît et pendant longtemps, le roman antique a été réduit aux seules œuvres d’Homère qui a
dominé la littérature antique. Si bien que l’on croyait que la forme romanesque était née au
Moyen-Age.
Depuis le volume de la Pléiade il y a près de 60 ans, aucune grande publication n’avait réuni auteurs grecs et latins. C’est donc peu dire si l’ouvrage publié aujourd’hui par les Belles Lettres et placé sous la direction de Romain Brethes et de Jean-Philippe Guez constitue une petite révolution. Mais surtout, il rétablit une vérité historique et littéraire et permet de mesurer la puissance créatrice, imaginative de nombreux auteurs antiques. Regroupant sept romans écrits en grec, l’ouvrage convie ainsi le lecteur sur la trace d’amants séparés, à la rencontre de femmes magnifiques, au coeur de batailles dirons-nous pour l’occasion « homériques » et dans des aventures aux confins du monde (Perse, Babylone, Ethiopie,…).
Au sein de cette vaste et passionnante littérature qui défile, la thématique de l’amour est omniprésente. Elle se décline sous toutes ses formes : érotique dans le Satiricon de Pétrone que magnifia à l’écran Federico Fellini et qui reste à ce jour le roman plus connu du volume, ou pudique comme celui de Théagène et de Chariclée dans les
Ethiopiques que ne renieraient pas nombre de cinéastes
d’Hollywood. Cet amour est tantôt partagé par de simples mortels, tantôt exalté par des dieux comme dans le Daphnis et Chloé de
Longus, qui fut un véritable best-seller en son temps et dont le mythe inspira bon nombre de peintres et de musiciens. Véritable matrice de ces romans, « l’amour est le critère fondamental de distinction entre les individus et établit entre eux, en fonction de leur réaction, une hierarchie morale, qui mine les distinctions ethniques traditionnelles »
selon Dimitri Kasprzyk qui a préfacé les Ethiopiques. Peu importe alors qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, l’amour tel qu’il est développé et magnifié dans ces romans permet de comprendre que les relations sexuelles, avant d’être une affaire de goût, répondaient d’abord à une classification sociale.
L’imitation et le désir amoureux se répandent donc comme un nectar au fil des pages et on se rend compte que l’Antiquité n’était pas si différente de notre époque dans sa conception du beau et du corps. « Le premier symptôme de l’amour est donc la voracité du regard » écrit Jean-Philppe Guez en introduction de Leucippé et Clitophon d’Achille Tatius. De plus, ces quêtes amoureuses se déroulent toujours dans une atmosphère où se mêlent réalité et fantastique, et les auteurs se plaisent à distiller avec malice quiproquos et illusions, garantissant un succès qui ne s’est pas démenti pendant plusieurs siècles.
Et puis, il y a cette beauté de la langue – qui doit beaucoup aux excellentes traductions – qui transparaît à chaque ligne et qui témoigne des techniques d’écriture et oratoires qui ont façonné notre langue, notre langage et notre littérature. Achille Tatius écrit ainsi que « dans les affaires d’Aphrodite, la simplicité est bien plus agréable
que la recherche ; car alors le plaisir qu’on prend est un plaisir naturel ». Ne croirait-on pas lire du Marivaux ?
Grâce au glossaire fort utile en fin de volume qui permet de remettre les mythes évoqués dans leur contexte, il est désormais possible de découvrir des trésors oubliés de la littérature latine qui prendront certainement toute leur place au côté de Gargantua ou d’Ulysse sur les rayonnages de la bibliothèque de l’humanité. Cependant, une question ne manquera pas d’émerger sitôt la dernière page lue : à quand le second volume ?
Romans grecs et latins, sous la direction de Romain Brethes
et Jean-Philippe Guez, Les Belles Lettres, 2016
Laurent Pfaadt