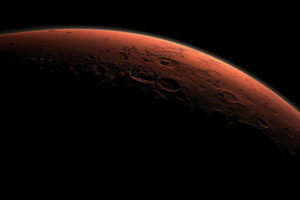Après les terribles
attentats de
Carcassonne et de
Trèbes et à l’heure où
notre nation, toutes
sensibilités
idéologiques et
religieuses
confondues, rend
l’hommage mérité au
héros national que
fut le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, il convient de garder son
sang-froid, de prendre un peu de recul et de préserver ce qui fait
notre bien le plus cher : le vivre-ensemble.
Ces derniers jours, l’attention s’est focalisée non pas sur l’Islam mais
sur une idéologie tirée de cette religion : le salafisme. S’il est vrai
qu’elle gagne l’esprit de certains musulmans qui ne constituent pas,
rappelons-le, la majorité de nos concitoyens français dont les aïeuls
ont contribué à libérer à Verdun, au chemin des Dames ou à
Strasbourg, le territoire d’un péril autrement plus mortel que le
salafisme, il faut réaffirmer que la très grande majorité des
musulmans de France aspire à vivre en paix, à être considéré comme
des citoyens à part entière et à inscrire leurs enfants dans notre
histoire commune afin qu’ils deviennent, sans renier leurs héritages
qu’ils soient cultuels ou culturels ou qu’ils aient opéré, de génération
en génération cette mutation, ces acteurs qui contribueront à faire
de notre pays une nation admirée et respectée pour l’histoire et le
message qu’elle a su porter et qu’elle portera, à n’en point douter,
dans les décennies et les siècles à venir.
A l’heure où bien souvent il est aisé de fustiger ce qui va mal, il
convient de regarder vers ce qui fait sens, vers ce qui fait société.
L’Islam, disons-le clairement, n’est pas une menace pour les sociétés
européennes. Bien au contraire. Cette religion peut être un atout
car il existe des lignes de convergence entre des points de vue qu’il
est dangereux d’opposer, au risque d’arborer le masque de celui que
l’on vilipende. J’en veux pour preuve le soufisme, approche
spirituelle et mystique de l’Islam qui se situe à l’opposé du salafisme
et qui place l’amour au cœur de son message. Nous devrions, tous, et
en premier lieu ceux qui agissent sur l’opinion publique, utiliser cette
arme idéologique, indépendamment de tous les instruments que
l’Etat met à notre disposition, pour lutter contre cette idéologie
islamique mortifère.
Le don de soi est une qualité devenue tellement rare en ces temps
d’individualisme effréné pour que le geste du lieutenant-colonel
Beltrame soit glorifié à sa juste valeur. Peu importe finalement que
ce geste ait été dicté par humanisme, conviction religieuse, sens du
devoir ou altruisme profond, il porte en lui un message éternel
relayé par ces hommes qui presque jour pour jour, il y a un siècle,
tombaient par milliers sur les champs de bataille de l’offensive du
printemps 1918 : ensemble nous serons toujours plus fort.
« Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C’est le passage
dont il est question dans les livres, l’ancien chemin obstrué, celui dont le
prince, harassé de fatigue, n’a pu trouver l’entrée » écrivit dans le Grand
Meaulnes, Alain-Fournier, mort au combat le 22 septembre 1914. Le
lieutenant-colonel Beltrame nous a montré l’entrée. A nous de nous
y engouffrer.
Laurent Pfaadt, écrivain