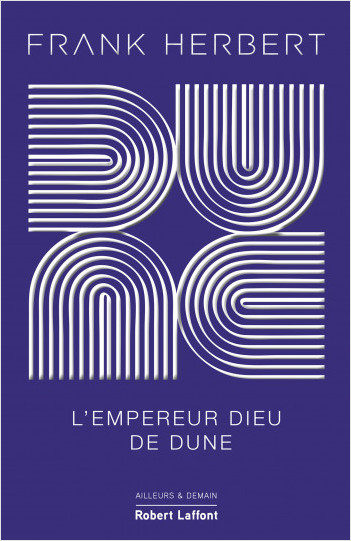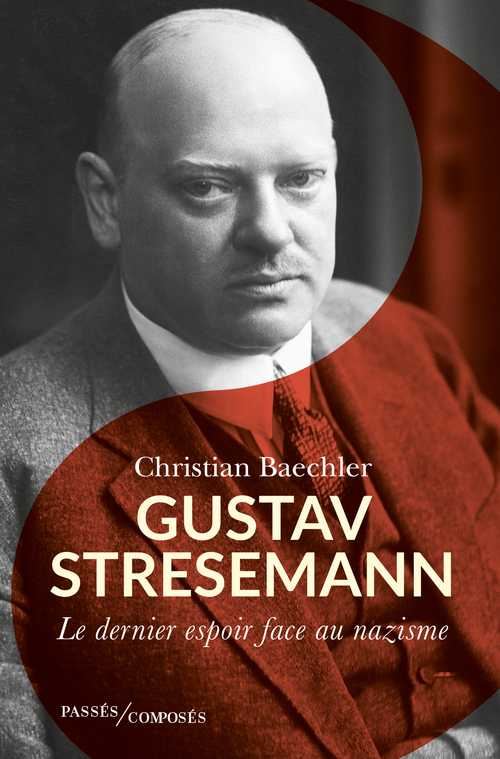Avec De l’argent à flamber, l’écrivaine danoise Asta Olivia Nordenhof inaugure une passionnante saga consacrée à la tragédie du Scandinavian Star
Dans plusieurs décennies, l’histoire se souviendra certainement qu’une jeune auteure pleine de talent écrivit ce qui fut l’épopée littéraire de référence du Titanic de la fin du 20e siècle. Le 7 avril 1990, 159 personnes ayant embarquées sur un ferry low-cost, le Scandinavian Star, reliant Oslo à Frederikshavn perdent la vie à la suite d’un incendie. L’enquête conclut à une somme d’escroqueries organisées. Les vies de plus de cent cinquante passagers ont ainsi été le prix à payer de l’enrichissement d’investisseurs sans scrupules devenu le symbole de la voracité d’un système capitaliste fou.
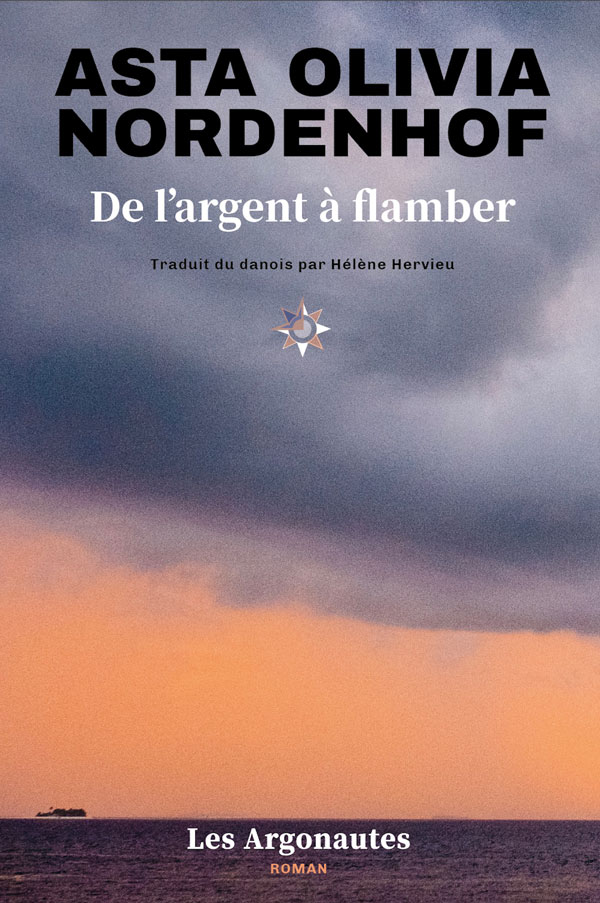
A partir de ces éléments, Astia Olivia Nordenhof a bâti une fresque sombre et majestueuse récompensée par de nombreux prix notamment celui de l’Union européenne. A coups de chapitres courts et secs, elle déploie un récit implacable, prenant à témoin son lecteur en remontant le temps d’avant la tragédie, à la genèse du drame, en compagnie dans ce premier opus, de deux personnages à la fois pathétiques et magnifiques, Kurt et Maggie qui, d’une certaine manière, personnifient la tragédie du Scandinavian Star. Avec tout le talent littéraire qui est le sien, l’auteure nous installe dans ce ferry sans possibilité d’en descendre. Un sentiment d’urgence s’empare alors du lecteur. Il cherche Kurt et Maggie, pensant qu’ils sont de futures victimes. Mais impossible de mettre la main sur eux. Et tandis que le ferry vogue vers son funeste destin, les vies brisées de Kurt et Maggie, consumées dans leur relation asymétrique, comme celle qui oppose dans ce capitalisme effréné passagers et propriétaires, se dessinent sous nos yeux. Et la violence qui les unit est, dans une sorte de miroir inversé, le reflet de celle que génère ce capitalisme sur ceux qui veulent être leurs complices et ne sont, en fait, que leurs victimes consentantes.
Dans ce troubillon, Astia Olivia Nordenhof ne laisse aucun répit à un lecteur devenu addict. Elle tient à lui montrer les conséquences de ce système que nous entretenons tous et dans lequel nous nous complaisons, sciemment ou non. Que chaque geste même le plus anodin, vient alimenter ce monstre qui finit par nous dévorer. Car Maggie, Kurt et tous ces gens finissent d’une manière ou d’une autre par payer nous dit Nordenhof. Physiquement, moralement, éthiquement. Pour ce système qui les broie quotidiennement. Détestables, Kurt et Maggie sont malgré tout touchants car ils portent en eux une sorte de fatalité indépassable. Parce que Kurt ne peut échapper à ce capitalisme qu’en devenant l’un de ses bourreaux ordinaires. Et le pire dans cette affaire, c’est qu’il ne le sait pas. C’est là la plus grande victoire du système que dénonce magistralement Astia Olivia Nordenhof dans ce livre.
Par Laurent Pfaadt
Astia Olivia Nordenhof, De l’argent à flamber, traduit du danois par Hélène Hervieu
Les Argonautes, 216 p.