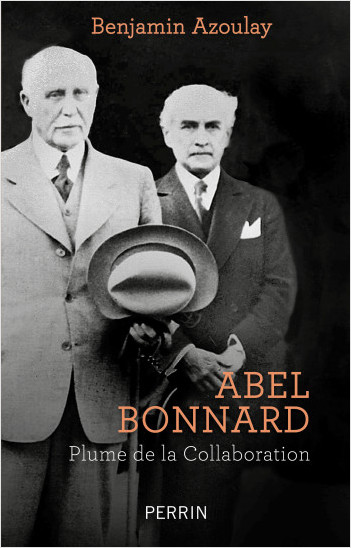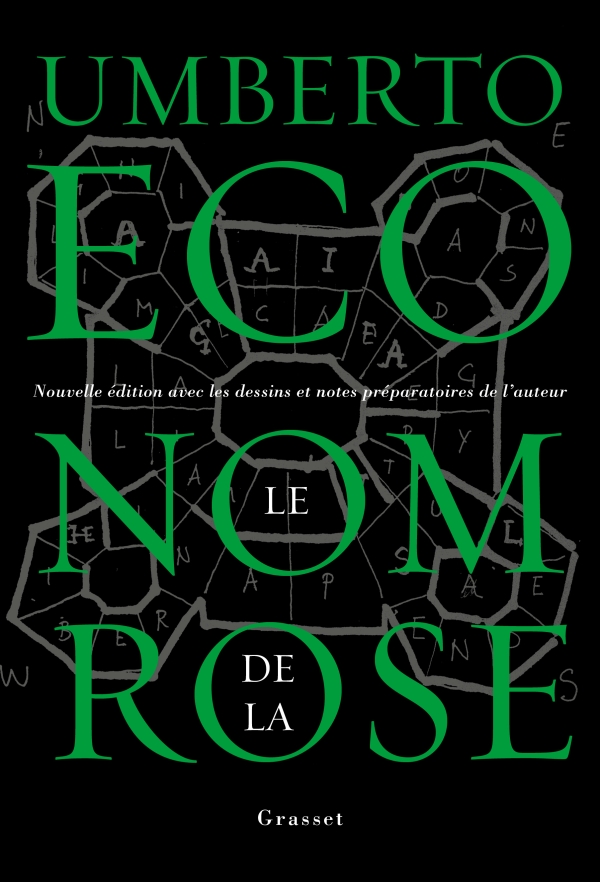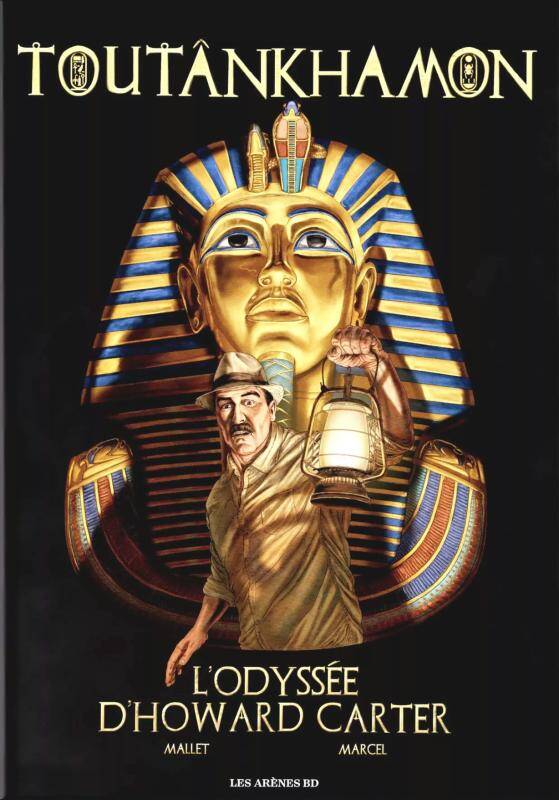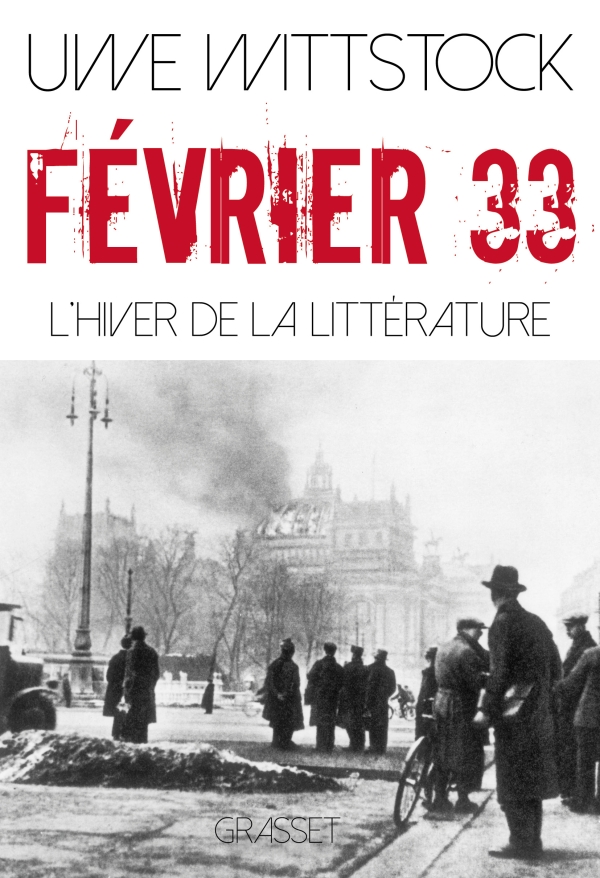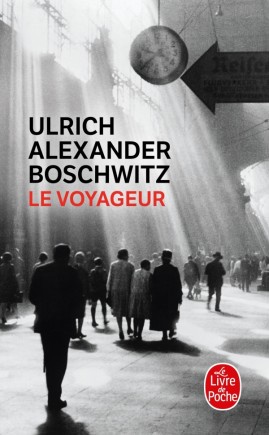En cette fin du mois de janvier et débordant sur février Le Maillon a proposé au public d’aller à la rencontre de spectacles dont le thème « l’exil » porte à la réflexion et à la solidarité. , le TJPCDN, Pôle-Sud.
S’il n’est pas nouveau il a été particulièrement remis dans
la lumière lors de l’entrée des Talibans à Kaboul en août 2021 et leur prise en
otage de toute l’Afghanistan. Depuis, la répression et l’horreur pèsent sur la population
de ce pays.
Que des institutions culturelles se soient démenées pour faire sortir quelques artistes de ce pays martyr est tout à leur honneur. C’est le cas à Strasbourg pour 8 d’entre elles, Le Maillon Théâtre de Strasbourg scène européenne, le TJP CDN, Pôle-Sud CDN, le TNS, Musica, l’Opéra national du Rhin, Jazz d’or et l’Oosphère, d’où la proposition du Maillon d’organiser un Focus sur le thème de l’Exil et de nous faire rencontrer ces artistes exilés en nos murs.
Première proposition de ce Focus, la pièce « En transit » de l’iranien Amir Reza Koohestani créée en juillet dernier au Festival d’Avignon. La pièce est écrite à partir de l’expérience vécue par le metteur en scène et croise l’ouvrage de l’allemande Anne Seghers justement intitulé « Transit » écrit en 1942 lors de son séjour à Mexico où elle avait dû s’exiler en raison de la guerre et de la répression menée contre les communistes, les Juifs, et les intellectuels dont elle faisait notoirement parti. Au cours du périple qui la conduira jusqu’à Mexico elle a pu observer les difficultés rencontrées par ceux qui, comme elle, transitaient par le port de Marseille. C’est l’objet de son récit, que, par hasard le metteur en scène est en train de lire lorsque, à l’aéroport de Munich, alors qu’il s’apprête à partir pour Santiago du Chili pour présenter une de ses pièces, il est arrêté par la police des frontières pour avoir dépassé de 5 jours son autorisation à résider dans l’espace Schengen, retenu avec d’autres personnes et renvoyé à Téhéran. La coïncidence lui parait suffisamment pertinente pour qu’il décide de mêler ces deux moments dans une création qu’il intitulera « Transit ».
La pièce met donc en perspective des personnages de
différentes époques confrontés les uns et les autres au mutisme de
l’administration, aux fins de non-recevoir, à l’incompréhension de ce qui est subi,
aux tracasseries de la bureaucratie aveugle autant qu’impitoyable et sourde à
toute justification. Un parcours kafkaïen retracé
de manière suggestive par quatre
comédiennes (Danae Dario, Agathe Lecomte, Khazar Masoumi, Mahin Sadri) qui interprètent tous les rôles dans un décor
aussi froid et gris que ceux qu’on trouve dans les aéroports ( scénographie
Eric Soyer), une valise y semble abandonnée en attente de son propriétaire
convoqué dans cette immense salle de transit ,réitérant ses demandes
d’explication à une policière qui ne fait que lui répéter qu’il n’est pas en
règle et qu’elle doit appliquer la loi. Les visages excessivement agrandis sont
projetés sur un écran en fond de scène, mettant ainsi en valeur l’expression
consternée de ces gens confrontés à l’absurdité et à l’angoisse de ne pas
savoir le sort qui leur est réservé face à tant d’arbitraire. (vidéo Philipp
Hemwarter ).Parfois ils s’installent
face à un employé chargé de les interroger sur une petite structure dressée au fond du plateau ou bien on les voit enfermés dans
une sorte de cabine en verre dans laquelle ils s’agitent impuissants à se faire
entendre.
Une démonstration concluante de l’absurdité d’une administration
qui n’a de cesse de créer des complications et de placer des obstacles sur le
chemin de ceux pour qui l’exil est une nécessité et pour tous ceux qui
prétendent à juste titre à la liberté de voyager.
- Représentation du jeudi 26 janvier
Le samedi suivant intitulé « Journée Afghane nous
offrait la possibilité de voir à l’œuvre
des artistes afghans séjournant ici depuis leur extradions en août 21 leur donnant la
possibilité de s’exprimer en tant qu’artistes.
Outre une exposition photo dans le hall, de petites formes
théâtrales étaient jouées dans la petite salle.
« La Lune » par Razia Wafaei Zada et Sayeh Sirvani qui nous racontent qu’on dit qu’il faut 9 lunes pour que naisse un enfant et posent la question « combien de lunes faudra-t-il pour que renaisse l’Afghanistan ?
Dans « Les Femmes Turquoises » Bas Gul Garimi et
Nina Faramarzi chantent et dansent. L’une est voilée, l’autre pas Elles
évoquent, le fouet, les châtiments corporels ce qu’elles qualifient du mal
dissimulé sous la religion, cruauté exercée par ces hommes stupides et
ignorants.
Dans « Levez le voile » Ahmad Ali Ebrahhimi, Ghodratollah Benyamin et Nina Faramarzi posent la question « partir ou ne pas partir « évoquent le voyage en bateau, le naufrage, la peur et disent qu’il faut lever le voile sur ce qui se passe dans leur pays et qui est un crime contre l’humanité.
La quatrième proposition intitulée « Où me blottir » est une performance marionnette et poésie réalisée par Mohammad Ali Mirzayee, Sepldeh Esmaeilzadeh, Nouri Talebzadeh auxquels d’est joint Renaud Herbin du TJP-CDN.
Enfin et très attendue « Les Forteresses » de la Cie « La ligne d’ombre » mise en scène de Gurshad Shaheman, assisté de Saeed Mirzaei, pièce créée à Marseille le 26 août 2021 puis représentée à la MC 93 de Bobigny en juin 2022. Suivie d’une tournée qui l’amène jusqu’à nous en ces jours.
Le metteur en scène franco- iranien Gurshad Shaheman, né en1978 a quitté l’Iran a l’âge de 10 ans.
Il propose dans cette pièce un retour vers son pays natal à travers les récits de vie de trois femmes de sa famille, toutes, nées dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan dans les années 60, sa mère qui s’est exilée en France, ses tantes, les sœurs de sa mère, l’une ayant choisi de s’installer en Allemagne, la dernière décidant de rester en Iran. Elles se retrouvent pour ce spectacle après des années de séparation à l’instigation de leur fils et neveu qui, à partir de leurs témoignages a écrit le livre « Les Forteresses » édité par « Les Solitaires Intempestifs » et qui est le texte de cette pièce si particulière.
D’abord par le cadre qui nous est proposé, un vaste salon à l’orientale où le public est invité, par le metteur en scène en personne, à prendre place sur des divans recouverts de tapis persans. (scénographie Matthieu Lorry-Dupuy, lumières Jérémié Papin)
Ensuite par la séparation des protagonistes qui sont, d’une part sur le plateau central les femmes de la famille Hominaz, Jeyran et Shady dont l’auteur a recueilli les paroles et auprès desquelles il se tient car c’est à lui qu’elles s’adressent, mimant les gestes du quotidien, préparer et servir le thé, les repas, composer un bouquet de fleurs et d’autre part les actrices, installées sur des chaises placées parmi les spectateurs, chargées, elles, pendant toute la représentation de dire ces récits de vie qui reflètent, pour la plupart, les violences subies. Ce sont donc à travers les voix de Guilda Chahverdi, Mina Kavani, Shady Nafar que l’on découvre leurs parcours semés d’embûches qu’elles ont dû surmonter, qu’il s’agisse de la révolution en 1979, de la guerre Iran-Irak, de l’arrivée des Islamistes au pouvoir, de l’exil.
Des récits précis, intimes qui donnent parfois les larmes
aux yeux quand on apprend leur désir d’études contrarié et souvent empêché,
voire interdit, leur militantisme bafoué, suivi d’enfermement dans d’horribles
geôles où l’on pratique les pires tortures, leur mariage forcé, à peine sorties
de l’adolescence, leur vie conjugale sans liberté.
Une bonne part de ces confidences portent sur le
comportement des hommes pères, frères, maris tous plus ou moins odieux, faisant
montre d’un autoritarisme démesuré, n’hésitant pas à pratiquer des châtiments
corporels sur leurs épouses, exerçant une véritable tyrannie sur elles et les
enfants. Plusieurs anecdotes nous ont fait froid dans le dos et même si elles
n’ont pas été victimes du pire comme de la lapidation d’une femme dénoncée
comme prostituée par son mari à qui elle refusait de continuer la prostitution
qu’il l’obligeait à pratiquer, toutes ont été soumises aux pratiques de ce patriarcat
d’autant plus indéboulonnable qu’il est soutenu par la république des mollahs,
celle qu’elles n’auraient jamais cru possible après avoir contribué à vaincre
le shah.
Leur seule porte de sortie a donc été pour trois d’entre elles,
le divorce et l’exil.
De sombres récits réalistes et émouvants, heureusement
entrecoupés par des intermèdes dansés et chantés dans la langue interdite en
Iran et qui est la leur, l’Azéri. (son et musique électro acoustique signée
Lucien Gaudion)
Des témoignages bouleversants, un véritable éloge de la résistance,
et du courage de ces femmes pour qui l’émancipation est une lutte, comme
aujourd’hui encore les femmes en font la démonstration en Iran.
Marie-Françoise Grislin
- Représentation du 3 février