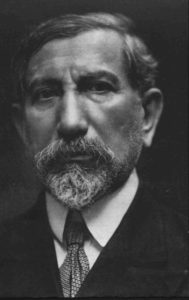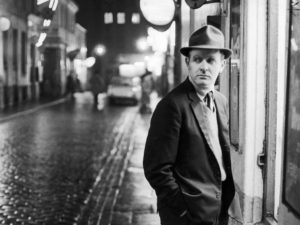« L’écrivain doit avoir l’ambition d’égaler les meilleurs »
A l’occasion de sa venue à Paris à l’Institut Goethe, Hebdoscope a
rencontré l’écrivain autrichien, Michael Köhlmeier.
Michael Köhlmeier est certainement l’un des écrivains vivants de
langue allemande les plus populaires. Auteur d’une œuvre variée qui
mêle romans, pièces de théâtre et réécritures de textes
philosophiques et mythologiques qui lui ont valu une certaine
notoriété outre-Rhin et que les lecteurs français peuvent désormais
apprécier dans son dernier ouvrage Qui t’a dit que tu étais nu, Adam ?
paru aux éditions Jacqueline Chambon, l’écrivain autrichien n’hésite
pas à s’engager, via sa littérature, dans les grands débats de son
époque.
Récent lauréat du prix littéraire de la fondation Konrad Adenauer,
succédant ainsi à Herta Muller ou à Cees Noteboom, Michael
Köhlmeier est connu du public français grâce à ses romans
notamment Deux messieurs sur la plage (2015), qui relate avec
beaucoup de liberté la rencontre sur une plage californienne en
1929 de Charlie Chaplin avec Winston Churchill et qui constitue un
sommet littéraire de dérision et d’ironie. Mais ce n’est que la partie
émergée de cet iceberg littéraire qui comprend de nombreux
ouvrages non traduits en particulier Occident, ce roman-fleuve qui
offre, à travers les yeux de ses personnages dont plusieurs
mathématiciens, le panorama d’un 20e siècle tourmenté.
Lors de cette rencontre conduite par Dieter Hornig, maître de
conférences au département d’allemand de l’Université Paris 8
Saint-Denis et grand spécialiste de l’écrivain, le public a ainsi pu
découvrir un peu mieux un écrivain qui tient en très haute estime le
Rouge et le Noir de Stendhal et Anna Karénine de Tolstoï, estimant à
juste titre qu’un « écrivain doit avoir l’ambition d’égaler les meilleurs et
d’écrire le troisième plus grand roman après ces deux-là ». Michael
Köhlmeier confesse d’ailleurs bien volontiers à propos des Deux
messieurs sur la plage où se mêlent histoire et fiction que son père
étant historien, ce dernier « se serait effondré s’il avait su ce que je
faisais. Avec mon père nous nous sommes beaucoup aimés mais aussi beaucoup disputés. Et écrire un roman fut comme une sorte de
vengeance ».
Grace à la complicité de ses traductrices, il a été permis au public
germanophone et germanophile présent ce soir-là d’entendre des
passages lus par cet écrivain autrichien qui parle selon lui l’allemand
uniquement par hasard et se reconnaît bien volontiers une filiation
avec la route de Cormack Mc Carthy. De route, celle du destin dont
on ne sait où elle mène, il en est question dans son dernier roman, la
petite fille au dé à coudre (2017), écrit avant la crise des réfugiés mais
dont l’histoire, celle de ces enfants réfugiés livrés à eux-mêmes,
résonne terriblement à l’aune de ce drame. Et comme dans ses Deux
messieurs sur la plage, l’histoire fait une incursion indirecte dans son
œuvre. Michael Köhlmeier a rappelé qu’il a tiré la genèse de ce livre
dans ces enfants-loups qui arpentèrent la Baltique au lendemain de
la seconde guerre mondiale. « Et puis, à Vienne, j’ai vu cette migrante
mineure que j’ai observé, seule, debout, pendant près d’une heure et
demie. L’histoire a, à ce moment-là, germé dans mon esprit. » Et avec
cette économie de moyens qui le caractérise, la petite fille au dé à
coudre est ainsi née.
Par Laurent Pfaadt
Retrouver la programmation de l’Institut Goethe sur : www.goethe.de
A lire de Michael Kohlmeier :
Deux messieurs sur la plage, Jacqueline Chambon,
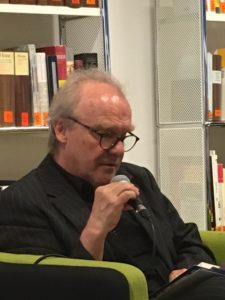
250 p. 2015, Babel, 330 p. 2017
La petite fille au dé à coudre, Jacqueline Chambon, 112 p. 2017