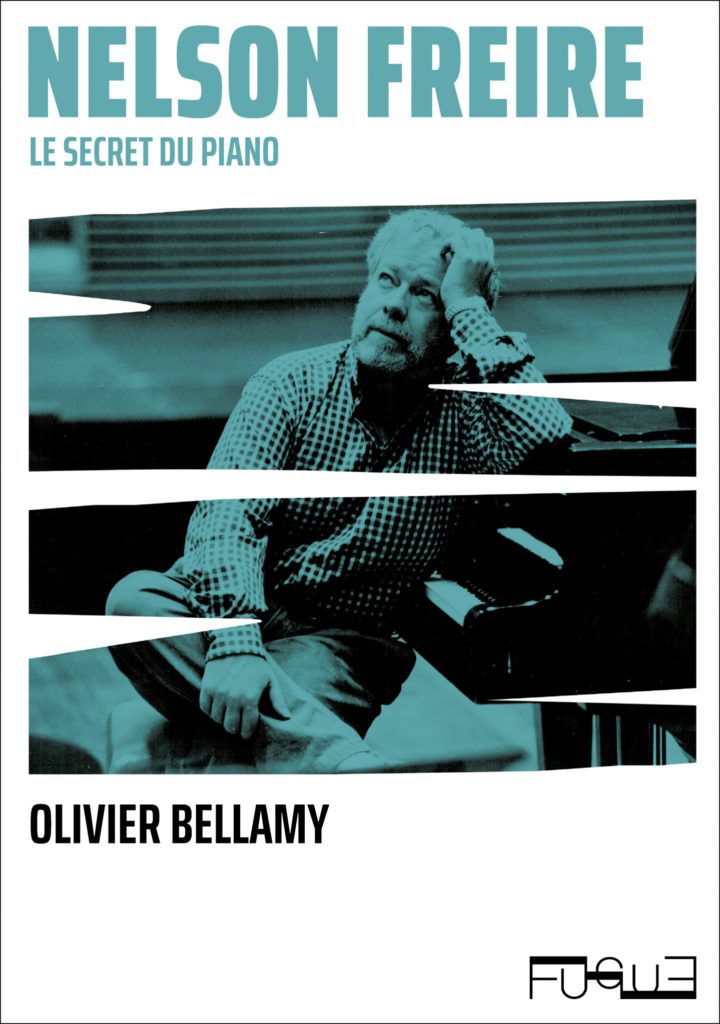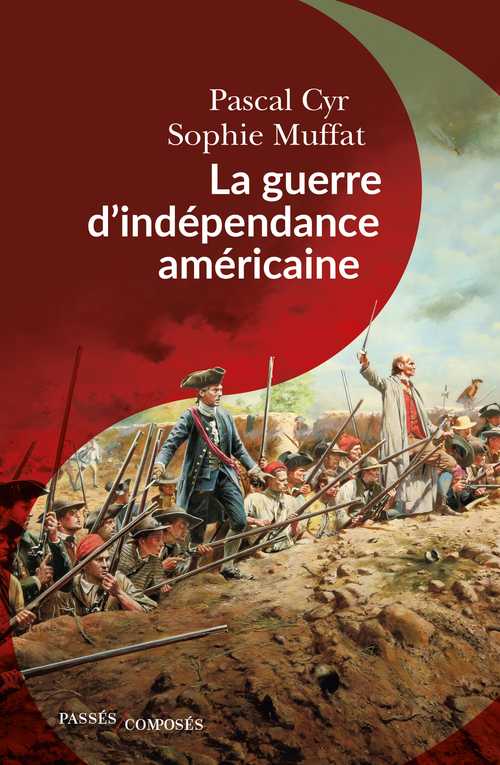Il y a quatre-vingts ans, jour pour jour, était déclenchée l’opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord, première étape de la reconquête d’une Europe passée sous le joug nazi.
Deux mois plus tôt, la Wehrmacht commençait le siège d’une ville qui allait se refermer sur elle et symboliser sa défaite : Stalingrad. Au même moment, de l’autre côté du globe, les Américains livraient une autre bataille dantesque, celle de Guadalcanal, après une autre, en juin, non loin de l’atoll des îles Midway.

1942 constitua réellement le tournant de la seconde guerre mondiale. C’est ce que montrent parfaitement Cyril Azouvi et Julien Peltier dans ce livre passionnant alliant pédagogie et érudition. Porté par une rédaction et un graphisme particulièrement réussi signé Julien Peltier qui séduira à coup sûr les plus jeunes, ce livre s’ouvre à n’importe quelle page, à n’importe quelle session pour en croquer tel détail, étudier une carte en compagnie du maréchal Paulus, comparer le Panzer III et le Crusader durant la bataille du désert ou lire une analyse historique. Tout est fait pour faire de cet ouvrage, le livre de chevet par excellence pour tout passionné du second conflit mondial.
Ainsi présentées, les grandes étapes de cette année charnière montrent ainsi un Troisième Reich engagé dans une course à l’abîme tant sur le plan militaire que dans son aveuglement idéologique. Les focus mis sur certains points donnent ainsi une réalité palpable aux théories et grandes opérations de cette année 1942. Il y a presque un côté cinématographique à voir la comparaison des fusils à Stalingrad ou dans les face-à-face des acteurs qui animèrent cette sombre année. Amis ou ennemis, tels Himmler/Heydrich ou Rommel/Montgomery, ces portraits permettent l’indispensable incarnation d’un conflit car il est bien connu que l’histoire est avant tout faite par des hommes…et des femmes que les auteurs n’oublient pas comme en témoigne la Résistance française ou ces femmes soviétiques pilotes de chasse dans le ciel de Stalingrad, ces « sorcières de la nuit » pour citer le récent roman de Chantal Malaval (Préludes)
1942 fut également l’année de l’accélération de la Shoah. Le 20 janvier 1942 se tint la conférence de Wannsee qui décida de la solution finale de la question juive. Et les auteurs de montrer l’accélération de la machine de mort nazie marquée notamment en France par la rafle du Vel d’hiv, les 16 et 17 juillet.
Les Américains quant à eux, engagés sur le front du Pacifique, préparaient les contours d’une victoire qui allait intervenir trois ans plus tard. Le 6 janvier 1942, le président Franklin D. Roosevelt lançait le « Victory Program », vaste programme d’armement qui profita notamment à l’URSS d’un Staline devenu un allié. Et dans le plus grand secret commencèrent les premières recherches du projet Manhattan sous la responsabilité de Robert Oppenheimer qui, malgré ses sympathies communistes, s’était vu confier la concrétisation d’une bombe nucléaire qui allait, non seulement renverser le cours de la guerre mais permettre aux Etats-Unis de dominer l’après-guerre.
Pour autant, ce 8 novembre 1942, les boys américains posant le pied sur le sol africain ne se doutaient pas que leur pays allait devenir une super-puissance. Seule comptait alors la délivrance de l’Europe. Mais nous, lecteurs, nous connaissons, grâce à ce livre vivant, la suite de l’histoire.
Par Laurent Pfaadt
Cyril Zouvi, Julien Peltier, préface d’Olivier Wievorka, 1942, Passés composés
A lire également sur cette année 1942 :
Chantal Malaval, Sorcière de la nuit, Préludes, 384 p.