Le gaman est cette notion japonaise qui veut dire « supporter ce qu’on
ne peut maîtriser ». Supporter ce qu’on ne peut maîtriser. Mais que
maîtrise-t-on au juste ? Cette question, cette impuissance nichée au
fond du cœur de la famille Takahashi traverse comme une flèche
empoisonnée le sublime livre de Christian Kiefer, finaliste du Grand
prix de littérature américaine pour Les Animaux (Albin Michel) en
2017.
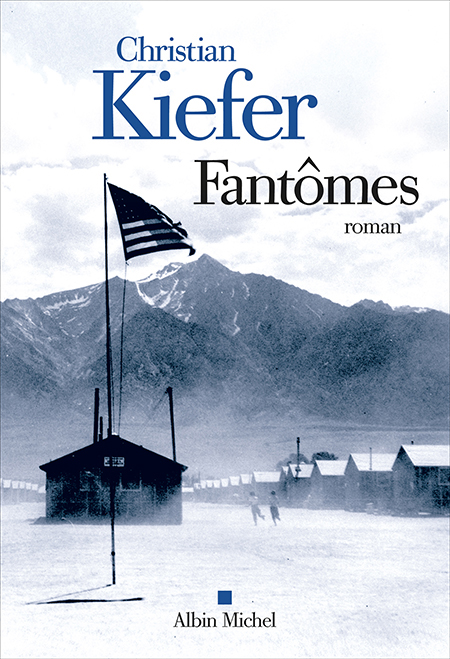
Personne ne maîtrise son destin, trop grand pour les Wilson, ces
paysans fruitiers, trop écrasant pour les Takahashi, leurs ouvriers
japonais, surtout quand il est paré des oripeaux de la haine et du
racisme. Dans Fantômes, l’auteur expose ainsi celui que subirent les
émigrés japonais et les citoyens américains d’origine japonaise au
lendemain de l’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Ce
drame, déjà esquissé par James Ellroy et Joy Kagawa (au Canada),
trouve enfin sa place dans la littérature américaine. Humiliée,
déclassée, la famille Takahashi se retrouva ainsi internée dans le
camp de concentration de Tule Lake en Californie alors que leur fils
Ray se battait sur les champs de bataille européens. Mais que le
retour du héros fut tragique…
Christian Kiefer rend ses personnages, tous les personnages de ces
deux familles terriblement attachants. Kimiko Takahashi d’abord,
cette fleur de cerisier fanée par le destin et son mari, Hiro, enfermé
dans sa pudeur culturelle que l’on veut pousser à la révolte, Homer
Wilson, patriarche au bon cœur et sa femme Evelyn, prisonnière du
poison du conformisme et du racisme qui finira par corroder son
cœur. Mais il y a surtout Ray, le fils Takahashi, beau comme un
samouraï des temps modernes qui allait emprunter malgré lui la voie de la guerre alors qu’il n’aspirait qu’à aimer Helen, la fille des Wilson.
De cet amour impossible et de leur fruit défendu dont ils furent tous
deux privés, Christian Kiefer tire, à travers la voix du narrateur,
parent des Wilson, un chant, celui des fantômes qui hantent le cœur
de ses personnages dans une litanie sans fin. Un chant aux échos de
souffrances qui entre dans nos têtes pour ne jamais en ressortir.
Jesmyn Ward, la double lauréate du National Book Award, a parlé à
juste titre de « roman qui chante » car c’est bien de cela qu’il s’agit. Au
fil des pages de ce livre qu’elle ouvre et referme, c’est bel et bien la
voix de Ray que l’on perçoit, omniprésente, comme celle d’un ange
perché contemplant le sombre théâtre de cette tragédie que
personne n’a voulu mais qui est quand même advenue. Alors
pourquoi ? Parce qu’on a laissé faire. Parce qu’on a baissé les yeux
quand il fallait les garder grand ouverts. Parce qu’on a laissé la
guerre, toutes les guerres, envahir nos cœurs. Aujourd’hui comme
en 1942 ou en 1968, l’avertissement de Christian Kiefer n’a ainsi
rien perdu de sa force.
Ici, aucun manichéisme, simplement l’histoire d’une amitié devenue
haine car écrite par d’autres que ceux qui la vivent et racontée par
un narrateur à l’âme pulvérisée par la guerre et l’injustice. Mais ce
que nous disent Evelyn et Kimiko est ailleurs. Tous, au feu comme
dans l’antichambre de la mort, se retrouvent un jour ou l’autre sur le
chemin de la vérité. Ils y croisent les fantômes de leurs vies et de
leurs actions passées pour y assumer leurs responsabilités. Car ces
fantômes demeurent, jusqu’à notre dernier souffle, en nous.
Par Laurent Pfaadt
Christian Kiefer, Fantômes
Chez Albin Michel, 288 p.