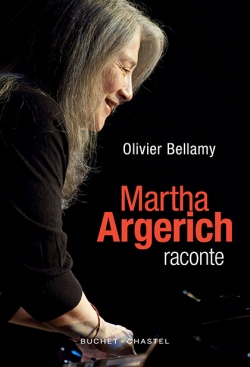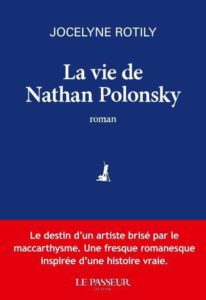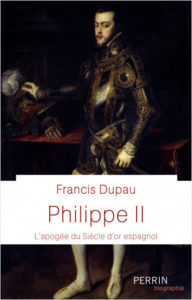Il est des livres dont on se souvient longtemps. Des livres qui vous
marquent à jamais. Lilas rouge fait partie de ceux-là. Ce livre qui
débute à la fin de la seconde guerre mondiale, en 1944, lorsque
Ferdinand Goldberger arrive avec sa famille dans cette Haute-
Autriche vallonnée. Dans ces pages magnifiques, le lecteur est très
vite saisi par le silence. Le silence comme une « délivrance » d’un
homme devant son crime, le silence de ses proches qui a eu raison
d’eux, le silence de ces habitants taiseux, le silence enfin d’une
nature monumentale qui écrase le lecteur de sa beauté. Mais les
souffrances et les traumatismes se transmettent, de génération en
génération, dans les non-dits et Ferdinand Goldberger et ses
descendants vont l’apprendre à leurs dépens.
On a parfois l’impression de se retrouver dans Une vie cachée de
Terence Malick avec ces hommes et ces paysages. Mais ici,
Ferdinand Goldberger y apparaît comme l’exact opposé de Franz
Jägerstätter. Lui-aussi s’est caché pour fuir la guerre mais il a fui son
passé. Or écrit Reinhard Kaiser-Mühlecker, « chaque homme était
cerné de toutes parts par son passé – personne n’avait droit à une
échappée vers le sud, pas même Goldberger. Le croire était une illusion.
Mais la certitude qu’il en était ainsi lui rendait précisément la chose
insupportable ». L’auteur choisit ainsi le bourreau plutôt que le
martyre devenu bienheureux de l’Eglise catholique. La culpabilité
plutôt que l’héroïsme. Mais à y regarder de plus près, les deux
hommes se rejoignent dans cette Autriche croyante, dans la
conviction que Dieu régit tout. C’est en tout cas ce que pense
Ferdinand Goldberger, que le péché originel du crime perpétré a
engendré une malédiction qui doit se transmettre de génération en
génération.
Et c’est ainsi que le récit avance et se détache des Goldberger, pour
évoquer à travers eux, l’histoire récente d’une Autriche à la fois
victime et complice du plus grand des crimes et qui a dû porter,
jusqu’à son histoire récente notamment lors de l’élection de Kurt
Waldheim en 1986 à la présidence de la République, le poids d’avoir
été le berceau du Führer. Héritier des Bernhard et Jelinek dans cette
volonté de confronter l’Autriche à son douloureux passé, le livre de
Reinhard Kaiser-Mühlecker s’en distingue cependant par sa froide
distance, comme ce temps qui passe à la propriété des Goldberger et
fait son œuvre. Vivre avec plutôt que d’exorciser le mal et le diluer
dans un nouveau berceau, celui de la propriété de Ferdinand
Goldberger mais également dans celui d’ue nouvelle génération
d’écrivains. Ici réside indubitablement la rédemption.
Un livre comme un berceau, comme une renaissance. Celui des mots
comme la respiration d’un enfant, celui d’un cri littéraire qui dit la
souffrance passée ou la joie à venir, celui enfin d’une vie qui
s’épanouit, libérée de toute culpabilité. Comme ces lilas rouges qui
refleurissent à chaque printemps même s’ils ont la couleur du sang.
Par Laurent Pfaadt
Traduit de l’allemand (Autriche) par Olivier Le Lay
Reinhard Kaiser-Mühlecker, Lilas rouge,
Chez Verdier, 704 p