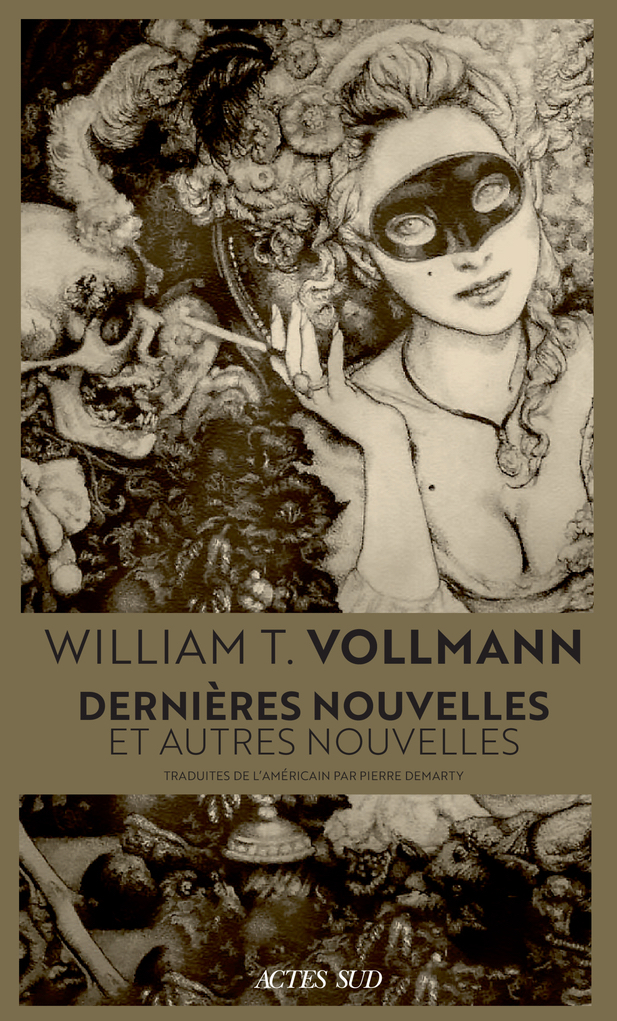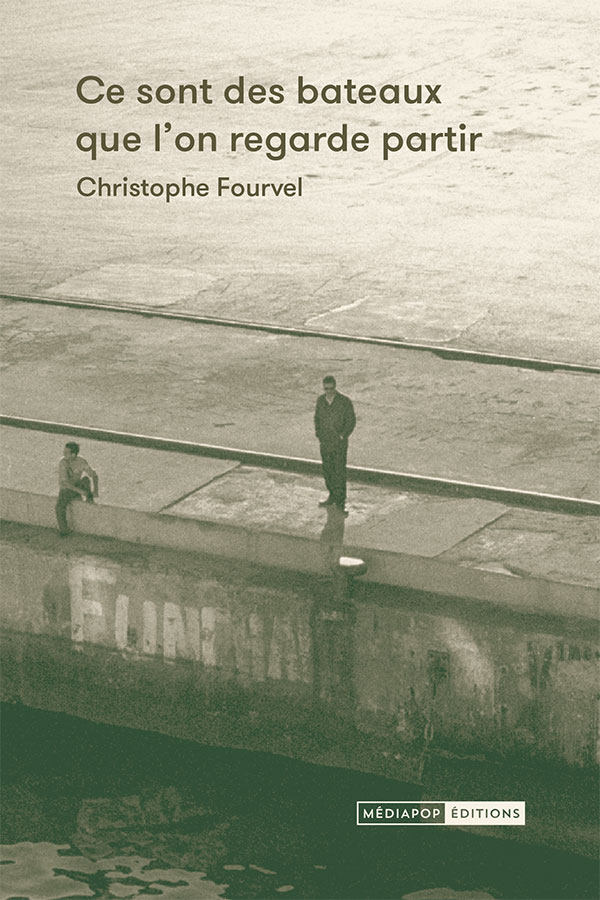Après l’humidité de la jungle, le froid polaire. Mais quel que soit
l’environnement, il se trouvera toujours des hommes intrépides ou
fous pour s’y confronter, s’y perdre. Voilà en substance ce qui attend
le lecteur en s’embarquant dans ce nouveau voyage au cœur des
ténèbres. Après La Cité perdue de Z, la Note américaine et le Diable et
Sherlock Holmes, le nouveau récit magistral de David Grann nous
emmène sur les traces d’Henry Worsley, aventurier moderne de
l’Antarctique.
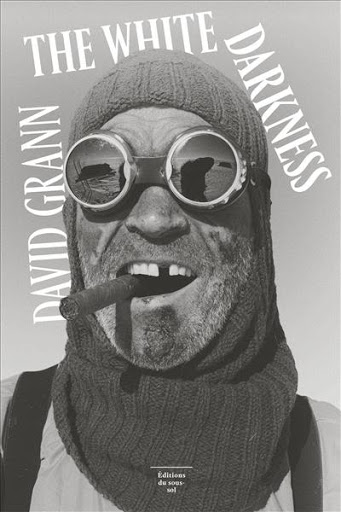
Fervent admirateur de l’explorateur britannique Ernest Shackleton
qui mena de nombreuses expéditions dans l’Antarctique jusqu’à
collectionner les effets personnels de ce dernier et descendant de
l’un des compagnons de l’expédition Endurance que Shackleton
mena en 1914, Henry Worsley effectua une brillante carrière dans
les commandos d’élite de l’armée britannique avant que le démon de
l’expédition polaire ne le rattrape. Très vite, avec d’autres
descendants de compagnons de Shackleton, Worsley monta lui-
aussi une expédition au Pôle Sud sur la base de celle de son illustre
modèle qui renonça à atteindre le Pôle Sud pour préserver la vie de
ses hommes. Les pages relatant ainsi, à un siècle d’intervalle, les
expéditions de Shackleton et de Worsley sont, comme toujours avec
Grann, haletantes. Les chutes dans les crevasses, la titanesque
ascension du glacier Beardmore ou les vents coupant comme des
rasoirs entretiennent le suspens. La mort est omniprésente car «
l’Antarctique a deux façons de vous ôter la vie (…) Elle vous use sur une
longue période en vous faisant peu à peu mourir de faim, de froid ou
d’épuisement (…). Ou elle vous jette dans la gorge d’une crevasse en une
fraction de seconde » relate ainsi Henry Worsley. Les figures
disparues de l’exploration polaire dont celle de Robert Falcon Scott
qui mena lui aussi une expédition vers le Pôle sud en 1912 et la
mythologie du Pôle sud ajoutent à la dramaturgie, rendant ainsi plus
palpitant encore l’exploit de Worsley et de ses compagnons.
Mais le grand intérêt du livre vient après, lors de ce point de bascule
entre quête et obsession. Henry Worsley, acclamé comme un grand
explorateur des pôles réunissant des fonds importants pour des
œuvres caritatives, veut aller plus loin, dans l’exploit, dans l’effort,
dans l’absolu. Pourquoi ? Pour voir « son âme à nu » comme il l’écrivit
lui-même. A cet instant, la littérature du journaliste américain
excelle une fois de plus à rendre compte de ces ténèbres, ceux qui
traversent le cœur des hommes. Worsley vient de rejoindre Percy
Fawcett, tous deux prisonniers de leurs propres obsessions. A un
siècle d’intervalle, les deux hommes ne vécurent que pour cela.
Leurs proches furent sacrifiés, la vie quotidienne ne compta plus.
Enfermé dans leurs rêves destructeurs, ils n’ont eu, sans se l’avouer,
d’autres horizons que la mort. Ce fut le prix à payer voir son âme à
nu dans la blanche obscurité.
Par Laurent Pfaadt
David Grann, The White Darkness
éditions du sous-sol, 160 p.