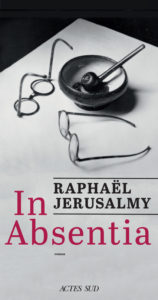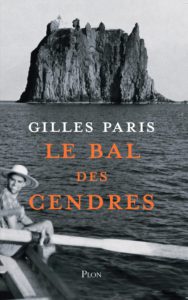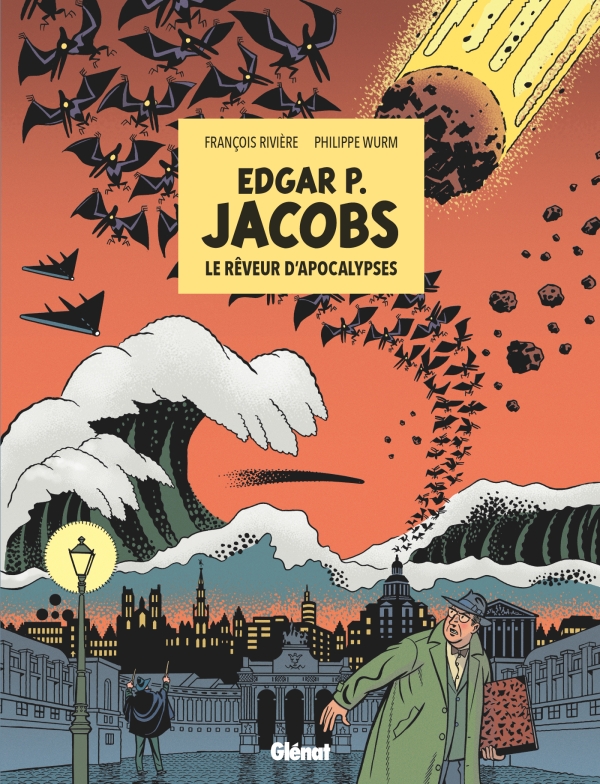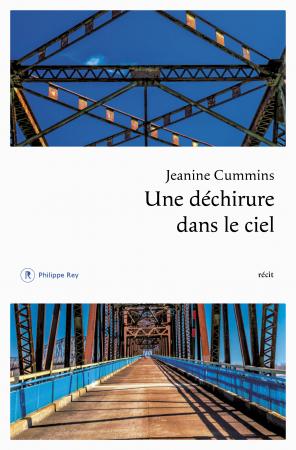Alexandre Saintin retrace dans un livre passionnant, le parcours de ces intellectuels séduits par le nazisme
C’est peu l’arbre ou plutôt les arbres qui cachent la forêt. Car évoquer la collaboration intellectuelle, et l’admiration littéraire envers le régime nazi se résument bien souvent à quelques noms : Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle et Robert Brasillach auxquels on adjoint parfois Jacques Benoist-Méchin, Ramon Fernandez et Lucien Rebatet. Des hommes qui, par haine, idéologie ou opportunisme ont cru dans le régime nazi.

Pour comprendre cet engouement qui conféra parfois à de la fascination, Alexandre Saintin a lui-même entrepris ce voyage historico-littéraire. Il en a ramené un ouvrage à tous points de vue passionnant, une galerie de portraits qui, au-delà des convertis et des antisémites, se veut plus clair-obscur qu’il n’y paraît sans pour autant atténuer les responsabilités individuelles et collectives. En scrutant les récits de voyages et les productions de ces intellectuels – pour la plupart hommes de lettres, journalistes, professeurs d’université – avant et pendant la guerre, l’historien a voulu comprendre.
Comprendre tout d’abord que l’Allemagne d’Adolf Hitler engagea dès son arrivée au pouvoir la bataille des idées qui remporta des succès notoires à grands coups de voyages outre-Rhin. Ces derniers serviront ainsi à tisser des liens, créer des réseaux pro-allemands comme le groupe Collaboration qui regroupa par exemple Abel Bonnard, Pierre Drieu La Rochelle ou Pierre Benoit, et deviendront faciles à mobiliser lorsque viendra le temps de la guerre et du régime de Vichy. Mais alors comment expliquer cette attirance ? Là encore le livre offre de brillantes réponses qui dessinent un spectre composite et non unique de ce vertige : volonté de détruire la « Gueuse », la République qui séduisit nombre de maurrassiens, recherche d’un pacifisme naïf pour ces hommes de bonne volonté tel Jules Romains ou antisémites notoires, héritiers de l’antidreyfusisme notamment au sein des journaux Candide et Je suis partout. La plupart d’entre eux finirent par se rejoindre dans l’aveuglement collectif de la collaboration.
L’autre grand mérite du livre est d’élargir la focale et, dans un chapitre passionnant, il s’attache à évoquer le voyage en terre du Troisième Reich de ceux qui, clairvoyants, alertèrent l’opinion sur les dangers du régime d’Adolf Hitler en regroupant surtout communistes, socialistes et chrétiens. Mais reconnaît l’auteur : « face à ce ralliement de cœur ou de raison des intellectuels allemands au régime nazi, rencontrer un homologue faisant profession de s’opposer à ce dernier fut sans étonnement une gageure pour les voyageurs français ».
Après la guerre vint l’épuration. L’ordonnance du 26 août 1944 créa l’indignité nationale, un crime qui frappa ceux qui avait collaboré avec l’occupant. Il concerna près de 50 000 personnes dont Louis-Ferdinand Céline, Lucien Rebatet qui fut condamné à mort puis gracié ou Charles Maurras exclu de l’Académie française tout comme Abel Bonnard dont le successeur se nomma…Jules Romains. Une manière de dire que l’histoire n’est pas linéaire et toujours complexe. Comme un tableau clair-obscur dans lequel entre magnifiquement le livre d’Alexandre Saintin.
Par Laurent Pfaadt
Alexandre Saintin, Le vertige nazi,
Passés composés, 320 p.