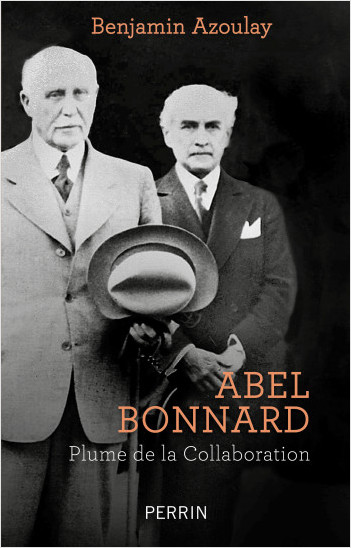Ian Fleming, le créateur de James Bond, a dit de lui qu’il était « l’espion le plus exceptionnel de l’Histoire ». A la solde du Kremlin, Richard Sorge fut envoyé, avant la seconde guerre mondiale dans cette Asie qui plongea la première dans la guerre, d’abord à Shanghai puis dans ce Japon militariste qui allait devenir l’un des plus fervents alliés du Troisième Reich. Beau, charmeur, cultivé, il s’introduisit, sous une couverture de journaliste dans les milieux allemands, notamment auprès des diplomates du Reich, devenant même l’amant de la femme de l’ambassadeur. Grâce à son immense toile d’araignée, il glana alors pour le maître du Kremlin, de précieux renseignements jusqu’à la date de l’opération Barbarossa, l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht en juin 1941 ainsi que la certitude que le Japon n’engagerait pas de troupes contre l’URSS en Sibérie, préférant se concentrer sur l’Asie du Sud-Est. Mais Staline ne crut pas Sorge et ce dernier finit par être arrêté fin 1941, puis exécuté en 1944.

Owen Matthews nous raconte tout cela. Avec son talent de conteur déjà manifeste dans ses livres précédents, notamment dans Les enfants de Staline (Belfond, 2009), l’ancien reporter embarque son lecteur dans les rues de Tokyo et les salons feutrés où se décide la guerre pour nous dévoiler de la plus belle des manières ce grand jeu qui s’organisa au début du second conflit mondial. Plus de sept cents pages qui se lisent d’un trait sur cet espion qui changea le cours de l’histoire.
Par Laurent Pfaadt
Owen Matthews, Richard Sorge, un espion parfait, le maître agent de Staline
Le livre de Poche, 720 p.