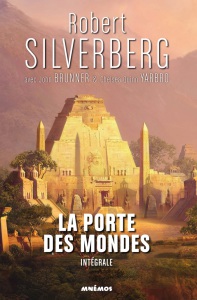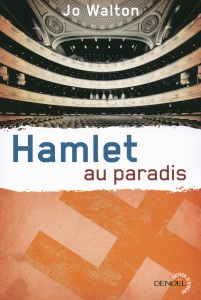Douze siècles d’histoire de la Russie à découvrir

Une somme sur la Russie, voilà ce qui vient immédiatement à l’esprit en parcourant l’ouvrage de Michel Heller, paru initialement en 1997. L’auteur nous invite à un voyage historique incroyable de St Petersbourg, la capitale des tsars à Vladivostok en passant par la mer d’Azov, Moscou, Novgorod ou Ekaterinbourg où fut exécuté Nicolas II. Des vikings suédois menés par leur chef Rurik formant cette principauté « rus » qui devait donner son nom aux habitants de ce pays continent jusqu’à la fin de la monarchie des Romanov en 1918, l’ouvrage parcourt avec bonheur cette histoire millénaire faite d’exploits comme la victoire de Pierre le Grand sur les suédois à Poltava en 1709, de soubresauts et de légendes (celles de l’imposteur Dimitri, de la disparition du tsar Alexandre ou des pouvoirs guérisseurs du moine Raspoutine).
Comme le développe avec brio Michel Heller, la Russie ainsi que son empire se sont édifiés sous l’autorité de chefs, de tsars. Deux figures émergent ainsi de ce panorama : Ivan le Terrible dont l’action fut prépondérante et Pierre le Grand dont Michel Heller tout en soulignant l’incontestable action de modernisation de l’état et d’impulsion impériale, porte un jugement plutôt sévère.
La longue histoire de la Russie puis de l’URSS fourmille de personnages qui ont bouleversé l’histoire du monde. Indubitablement, Lev Davidovitch Bronstein dit Trotski fut de ceux-là. Sur ce point en tout cas, la biographie que Robert Service, professeur à Oxford et auteur d’un Lénine convaincant (Perrin, 2012), consacre au fondateur de la IVe Internationale s’inscrit dans l’historiographie communément admise. Pour le reste, l’ouvrage démolit à juste titre d’ailleurs, l’image romantique d’un Trotski, héraut d’une révolution communiste moins brutale et surtout qui aurait accompli l’utopie voulue par Marx et Lénine.
Oui, Trotski n’appartenait pas à la faction bolchevik des révolutionnaires d’octobre et il fit preuve de réelles qualités de stratège lors de la guerre civile contre les Blancs, restés fidèles au tsar. Mais selon Service, l’homme ne fut pas un réaliste mais un idéologue obtus, se complaisant dans un verbe acerbe nourri par un ego démesuré au lieu de se confronter au pouvoir. « Lui-même a toujours voulu qu’on le considère comme un idéaliste révolutionnaire, sans jamais admettre la faiblesse de ses arguments » écrit ainsi Service. L’auteur en conclue d’ailleurs que son gouvernement aurait été bien pire que celui de Staline avec qui il partageait – n’en déplaise à ses partisans – de nombreux points communs.
En tout cas, qu’elle fut blanche ou rouge, l’histoire de la Russie et de ses grands hommes recèle cette part de fascination propre aux grands empires.
Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, Perrin, coll. Tempus, 2015
Robert Service, Trotski, Perrin, coll. Tempus, 2015
Laurent Pfaadt