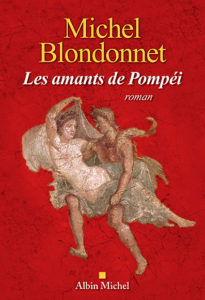Silvia Costa, jeune metteure en scène italienne, collaboratrice de Romeo Castellucci, a présenté au Centre Dramatique National avec Le Maillon, un spectacle original, intitulé Dans le pays d’hiver ». Si elle s’est inspiré de six des » Dialogues avec Leuco » de Cesare Pavese (Le mystère, La bête, L’homme-Loup, La mère, Le déluge, Les dieux) ce ne seront pas à proprement parler les textes de cet auteur italien que nous entendrons. En effet, influencée par sa formation de plasticienne, à l’instar de Romeo Castellucci, elle insiste sur ce qui est symbole et images pour nous arracher à tout réalisme et nous emmener dans un monde allusif, poétique, énigmatique qui se réfère à la mythologie.
D’entrée de jeu notre attention se porte sur ces colonnes à l’antique, cette alcôve au fond de laquelle on aperçoit un animal, et au premier plan une femme couchée dans une pose statutaire. Bientôt, elle lève un bras et d’un geste de la main donne une impulsion à cette longue tige à pointe qui pend au-dessus d’elle, la transformant en balancier, puis en détachant la pointe elle devient épée de Damoclès. Ainsi, nous indique-t-on, semble-t-il, que tout dans ce spectacle sera métamorphose, équilibre et mesure. Effectivement, les scènes se dérouleront d’une façon précise, avec une attention constante à l’allure, aux attitudes des trois protagonistes, danseuses et comédiennes, au port hiératique, aux poses sculpturales, Laura Dondoli, My prim et Silvia Costa elle-même, instigatrice de ce spectacle qu’elle a mis en scène et scénographié.
Un spectacle essentiellement visuel, esthétique mais qui nous donne aussi l’occasion de nous pencher sur la condition humaine de manière plutôt ludique puisque les dieux ne cessent de s’interroger, avec gravité, parfois ironie, toujours curiosité sur leur sort comparé à celui des humains, ces êtres qui s’évertuent à se maintenir en vie et rêvent d’éternité alors qu’eux, les dieux, voudraient connaître la mort pour goûter le prix de la vie et comment cela influence les pensées et la conduite des humains.
Il sera, par ailleurs, question d’amour maternel et pour illustrer ce propos on fera sortir la louve romaine détenue au fond du pseudo sanctuaire, pour la placer au premier plan, et lui seront arrachés les nourrissons accrochés à ses mamelles peut-être pour les restituer à celle qui les a portés…
Si l’on se perd quelque peu à décrypter le sens qu’il faut donner à ses tableaux, toujours esthétiquement très soignés, on se laisse gagner par le plaisir de les contempler, séduits par leur inventivité, par la rigueur de ce travail où les corps sont investis par un constant rappel à la mythologie, non pas pour l’éclairer mais pour la déclarer encore et toujours pertinente.
Les costumes (Laura Dondoli), les maquillages, les grondements (Création sonore Nicolas Ratti) qui semblent jaillir des profondeurs de la terre contribuent à donner à cette représentation une atmosphère étrange, mystique par son côté ritualisé, solennel, voire, sacrificiel qui a subjugué le public.
C’était le 3 mai
Marie-Françoise Grislin
 Après un détour
Après un détour