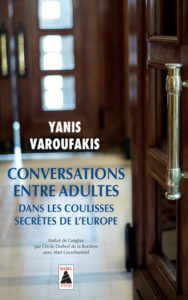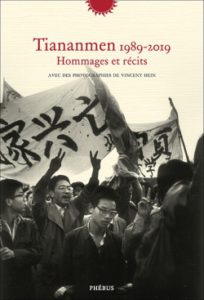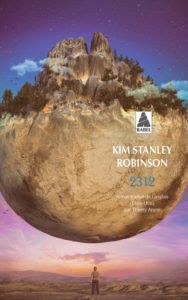© Eric Larrayadieu
« Salieri, ce mal-
aimé »
Christophe
Rousset est
claveciniste et le
chef fondateur des
Talens lyriques. Sa
formation est
aujourd’hui l’une des meilleures
interprètes de musique baroque, collectionne les récompenses
(victoire de la musique classique, nomination aux Grammy
awards) et ses disques sont régulièrement distingués par la
critique. A l’occasion de l’enregistrement du Tarare d’Antonio
Salieri chez Aparté, Christophe Rousset revient sur ce
compositeur quelque peu oublié.
Après les Danaïdes et les Horaces, vous enregistrez Tarare
d’Antonio Salieri. Qu’est-ce qui vous attire chez ce compositeur ?
Son étiquette de « mal-aimé » de l’histoire de la musique. Salieri
était acclamé partout en Europe et bénéficiait d’une réputation
bien plus importante que celle de Mozart. Cherchons l’erreur!
Comment qualifierez-vous ses opéras français ?
Ils s’inscrivent dans la tradition de Gluck qui lui obtient la
commande des Danaïdes. Il s’inspire sans imiter et va plus loin dans
ses architectures, dans ses audaces, ses couleurs orchestrales bien
plus « viennoises ». Et l’avantage quand Salieri écrit en français
c’est qu’on n’ira pas le comparer à Mozart car ce dernier n’a pas
écrit d’opéra en français. Quelle chance pour Salieri ! Ainsi, son
génie propre peut s’exprimer sans que nous le fassions passer sous
d’injustes fourches caudines.
N’est-il pas un compositeur malaimé qui a eu la « malchance »
d’être né à la même époque que Mozart et éclipsé par
ce dernier ?
Exactement. À part que dans ses opéras en français, Salieri
préfigure clairement une veine romantique et héroïque qui ouvre
vers le XIXe.
Peut-on parler d’influences réciproques entre les deux hommes ?
Car Tarare composé quelques années après les Noces de Figaro et
l’Enlèvement au sérail rappelle fortement ces opéras ?
Sûrement. Cependant, on trouve un peu l’exotisme de l’Enlèvement
au sérail dans Tarare mais au fond peu de Mozart. En revanche on
trouve beaucoup de Salieri dans Mozart comme la Grotta di
Trofonio dans Don Giovanni et La Cifra dans Così fan tutte.
Votre approche de Salieri est-elle différente de celle que vous
adoptez avec Lully ou Haendel par exemple ?
Évidemment parce que les esthétiques sont si différents.
Cependant la référence à Lully est toujours pertinente quand on
parle de « tragédie lyrique ». J’avoue beaucoup aimer
personnellement les terrains vierges comme Salieri. Les traditions
d’interprétation de Mozart sont très encombrantes pour un chef
comme moi ! Difficile d’obtenir des Nozze ou un Cosi comme je les
rêve dans mon imaginaire: les chanteurs ont trop d’idées précises,
puisées chez leurs professeurs, chez d’autres chefs ou metteurs en
scène. C’est très contraignant … et ça n’existe heureusement pas
avec Salieri!
On retrouve sur cet opéra quelques chanteurs habitués des
Talens lyriques mais surtout une petite nouvelle : Karine
Deshayes
Karine était Vénus sur un enregistrement que j’ai fait d’une
tragédie d’Henri Desmarets, Vénus et Adonis (1697). Je l’ai connue
toute jeune et lui ai proposé ses premiers récitals en France et à
l’étranger, avant qu’elle ne chante sur les scènes les plus
prestigieuses. C’est un plaisir pour moi de la retrouver après un
autre inédit Uthal de Méhul réalisé il y a deux ans. J’ai juste
regretté que le rôle d’Aspasie dans Tarare soit si court!
Par Laurent Pfaadt