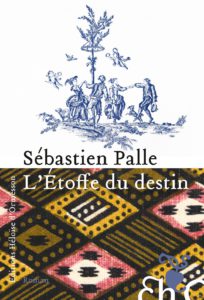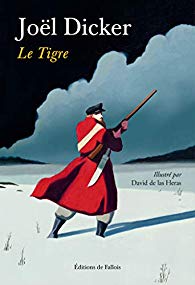© Louvre Abu Dhabi
Le siècle d’or hollandais est à
l’honneur d’une magnifique
exposition du Louvre Abu
Dhabi
C’est presque une histoire de
roman. Il existerait ici, dans un
comptoir d’Arabie, sur la
route de Jakarta à Rotterdam,
un portrait du Christ de
Rembrandt. De nombreux
voyageurs occidentaux ont
contemplé son étrange
beauté sans avoir pu le ramener. Pourtant, ce tableau
de petite taille, cette étude pour la figure du Christ qui rappelle celle
de la Hyde Collection de New York n’est autre que la dernière
acquisition du Louvre Abu Dhabi, magnifique musée posé sur la mer
et bâti autour d’un partenariat entre treize institutions artistiques
françaises et l’émirat d’Abu Dhabi.
Renouvelant en permanence ses collections et bien décidé à en faire
un carrefour des civilisations, le musée présente une exposition
fascinante sur le siècle d’or hollandais. Fruit de la collaboration entre
le Louvre parisien et la collection privée Leiden qui a accepté de
prêter quelques-uns de ses incroyables chefs d’œuvre, l’exposition
qui regroupe près d’une centaine d’œuvres suit la trace des grands
maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, à commencer par
son plus illustre représentant, Rembrandt. D’emblée, le visiteur est
frappé par le sens du détail de ce dernier, par cette capture quasi
instantanée de moments de vie, d’attitudes physiques qui donnent
l’impression que le sujet va s’animer, s’échapper de la toile dans
laquelle il semble, un court instant, prisonnier. Les plis du cou de
l’Etude de la femme à la coiffe blanche ou les mains bleuies du portrait
de la femme assise les mains jointes constituent ainsi de parfaits
exemples de l’art incomparable du portrait rembrandtien. Mais le
meilleur reste à venir avec cette Minerve peinte alors que
Rembrandt, installé à Amsterdam, est au faîte de sa gloire. La déesse
est là, en majesté. Sa cape aux reflets moirés semble glisser sur
l’accoudoir du fauteuil. On s’avance, prêt à retenir le vêtement divin
s’il venait à glisser hors du cadre.
L’exposition prend grand soin de montrer les influences du génie de
Leyde à commencer par Pieter Lastman et surtout Jan Lievens qui
fut son ami mais également son rival. Il y a indubitablement des
traits communs dans ces barbes et dans cette influence de l’école
caravagesque d’Utrecht mais la magie de Rembrandt prend
inévitablement le dessus, cette magie qui a, très vite, relégué Lievens
dans une ombre qu’un astucieux atelier pédagogique permet de
comprendre en analysant le jeu de lumières de ses Joueurs de cartes.
Car il faut se rendre à l’évidence, Rembrandt est unique. « Reconnu
comme l’un des plus grands conteurs de l’histoire de l’art, Rembrandt
avait un don exceptionnel pour révéler l’âme humaine dans ses peintures » reconnaît d’ailleurs Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abu Dhabi. Rembrandt fut une comète dans la peinture occidentale si bien qu’il n’eut véritablement pas d’héritier digne de son art, seulement des peintres se réclamant ou disons-le imitant son génie, aussi brillantes d’ailleurs furent ces imitations.
Si ce siècle d’or avait ses astres, nombreuses furent également ses
étoiles. Sous nos yeux se succèdent ainsi scènes de la vie
quotidienne avec leurs intérieurs parfois insérés dans des niches
comme chez Gabriel Metsu, figure de proue avec Gérard Dou de la
peinture fine, peinture historique d’un Ferdinand Bol ou portraits
d’un Caspar Netscher qui ferme en quelque sorte ce siècle. Mais le
siècle d’or de la peinture hollandaise resterait incomplet sans cette
autre comète, Johannes Vermeer. Celui qui révolutionna la peinture
avec son traitement de la lumière arrive presque en apothéose de
l’exposition. Deux tableaux du génie sont ainsi montrés mais quels
tableaux. La jeune femme assise au virginal de la collection Leiden,
seule peinture de Vermeer possédée par un fond privé et la
dentellière du Louvre sont, pour la première fois, réunies dans un
dialogue stupéfiant. Outre le fait que ces deux œuvres aient été
peintes sur le même rouleau de tissu, il y a là un lien dirions-nous
presque charnel entre les deux oeuvres. Et le visiteur, venu chercher
un trésor, en découvre alors une multitude.
Par Laurent Pfaadt
Rembrandt, Vermeer et le siècle d’or hollandais :
Chefs-d’œuvre de la collection Leiden et du musée du Louvre,
jusqu’au 18 mai 2019 au Louvre Abu Dhabi.