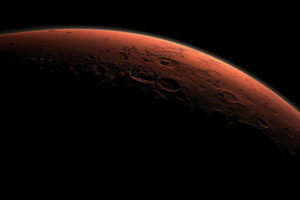« C’est un roman
« C’est un roman
qui parle des gens,
au-delà de leur
origine »
Révélation de la
scène littéraire russe
avec son premier
roman magistral,
Gouzel Iakhina, scénariste, nous offre une plongée saisissante dans
l’époque relativement méconnue de la dékoulakisation qui suivit
l’arrivée de Staline au pouvoir. Avec ce roman, Gouzel Iakhina renoue
également avec la grande fresque épique russe. A l’occasion de sa
venue au salon du livre de Paris dont la Russie est l’invitée d’honneur,
elle se confie.
Pourquoi avez-vous choisi cette période plutôt oubliée de l’URSS ?
Le début de l’ère soviétique – les trente premières années de la
jeune Russie soviétique – me semble une période de
bouleversements particulièrement intéressante. Mon pays est
passé par de graves traumatismes; ces traumatismes se sont
succédés sans répit, sans qu’on ait le temps de s’arrêter pour les
interpréter ou les étudier. Il y a eu d’abord la guerre civile, qui a
laissé le pays dévasté, en proie à la famine, puis les purges
staliniennes. Dans le même temps, cette époque a été marquée
par un élan inouï de la pensée, une incroyable énergie créatrice,
un enthousiasme inégalé. C’est là, dans les années 1920-1930,
qu’on trouve la clé de tout ce qui s’est passé ensuite dans le pays,
au milieu et à la fin du XXe siècle.
Zouleikha rappelle un peu la Sosha d’Isaac Bashevis Singer avec son
innocence, sa pureté et son coté enfantin ? Racontez-nous la genèse
de ce personnage.
Je voulais écrire sur un personnage qui effectue un voyage mental
du passé au présent, dont l’esprit se transforme. Elle passe du
paganisme à la modernité. C’est pourquoi, dès le début, j’avais en
tête ce personnage de femme-enfant profondément ancrée dans
un monde archaïque, dans une sorte de Moyen Âge, et qui, petit à
petit, s’extirpe de ce Moyen Âge, acquiert de l’expérience, apprend
à être libre et à aimer. La succession d’événements tragiques
qu’elle va subir change profondément sa personnalité et l’amène
paradoxalement à trouver une liberté intérieure.
Le personnage du commandant Ignatov est également très
intéressant. Il est à la fois bourreau et victime. Résume-t-il
l’ambivalence de ce régime, de cette époque ?
Ignatov est pris dans un étau entre deux exigences
contradictoires. Il accompagne les koulaks en Sibérie puis devient
commandant de leur village. D’un côté, il doit les surveiller, les
contraindre à effectuer des normes de travail, les tuer en cas
d’évasion. D’un autre côté, il doit prendre soin d’eux, obtenir pour
eux de la nourriture et des médicaments, et plus tard, en Sibérie,
chasser pour les nourrir. Ainsi, petit à petit, il apprend à les voir
comme des gens. Et sa transformation, ce passage d’un
communiste convaincu, aveuglé par son idéologie, à un homme qui
pense par lui-même et éprouve de la compassion, est l’une des
lignes et l’un des thèmes principaux du roman.
Ignatov est un produit du système. Mais c’est justement ce
système qui finira par le briser, qui l’exile d’abord loin de sa ville
d’origine, de ses amis, l’empêche de choisir sa voie, puis ruinera sa
santé et lui refusera le moindre statut social. Broyé par le système,
il préfère le quitter et rejoindre le camp des exilés. De nombreux
destins ont été brisés de cette façon, l’ancien bourreau devenant à
son tour victime. De manière générale, la frontière entre
bourreaux et victimes était floue: dans certains cas, c’est la
victime qui devenait bourreau. On le voit, dans mon roman, avec
l’ancien truand Gorelov: contrairement à Ignatov, il ne s’oppose
pas au système, mais adopte volontiers ses règles et finit par être
élevé au rang de gardien des exilés.
Dans ce livre on comprend qu’il existe toujours une petite lumière
dans les ténèbres, une vie au milieu de la mort. Comme la scène de la
découverte de la grossesse de Zouleikha dans ces trains de la mort.
Je voulais, d’un côté, raconter les difficultés de la lutte pour la
survie dans la taïga sibérienne, avec toute l’horreur de cette vie en
exil, et d’un autre, montrer que, même au sein de cette horreur,
peut se cacher la semence d’un bonheur prêt à éclore. Car, pour
Zouleikha, ce « voyage en enfer » finit par se transformer en «
chemin vers une nouvelle vie ». Le village d’exilés décrit dans le
roman est comme une arche de Noé. Paysans, condamnés de droit
commun, intellectuels, musulmans, chrétiens, païens et athées
sont tous obligés de s’entraider pour survivre. Et, en dépit de tout,
ils survivront. Et Zouleikha survivra avec eux, ainsi que son fils
nouveau-né. Au fond, c’est un roman qui parle des gens, au-delà de
leur origine. Du fait que, lorsqu’on se trouve à la frontière entre la
vie et la mort, toutes les caractéristiques sociales disparaissent:
les préjugés ethniques et religieux, les différences de classe – et il
ne reste plus que des êtres humains. Dans le livre, on voit que la
vie est plus forte que la mort.
Le roman est aussi une formidable plongée dans la société tatare de
cette époque à la fois animiste et islamique. Comment la qualifieriez-
vous ?
Je n’avais pas pour objectif de décrire la société tatare. Bien sûr,
on peut dire que la première partie du roman présente un
environnement tatar, avec une couleur locale, des mots, un
quotidien et une mythologie tatars. Mais dès que Zouleikha quitte
son village, ces caractéristiques commencent à s’effacer.
Au début du roman, Zouleikha vit dans un monde archaïque,
presque comme au Moyen Âge, entourée de gens qui ne l’aiment
pas; elle est brimée, ravalée au rang d’esclave; en vérité, elle ne
peut «dialoguer» qu’avec les esprits du foyer et de la nature. À la
fin du livre, elle habite dans un petit village multiculturel; elle a
rencontré un homme qu’elle aime, donné naissance à un fils, parle
une autre langue, se nourrit et gagne sa vie toute seule, en
chassant. Cette métamorphose ne se fait pas en un jour, mais
pendant les seize ans qui sont le temps du roman. Son chemin, de
son village à la lointaine Sibérie, est aussi un cheminement mental
du passé au présent. C’est sur cette opposition que je voulais
travailler: le passage d’un monde archaïque à la modernité.
Votre roman dit-il, après d’autres, quelque chose de l’âme russe, si
mélancolique et torturée ?
Je voulais raconter une histoire qui fonctionnerait sur deux niveaux:
d’un côté, c’est un roman historique, qui parle d’évènements
concrets survenus dans les années 1930 en URSS, la
dékoulakisation et la déportation des koulaks. Mais c’est aussi une
sorte de mythe, qui parle de thèmes et de questions universels, et
cette histoire aurait pu arriver à des gens de n’importe quelle origine
ou nationalité.
Traduction : Maud Mabillard
Gouzel Iakhina, Zouleikha ouvre les yeux,
Chez Editions Noir sur Blanc, 2017, 468 p.
Laurent Pfaadt