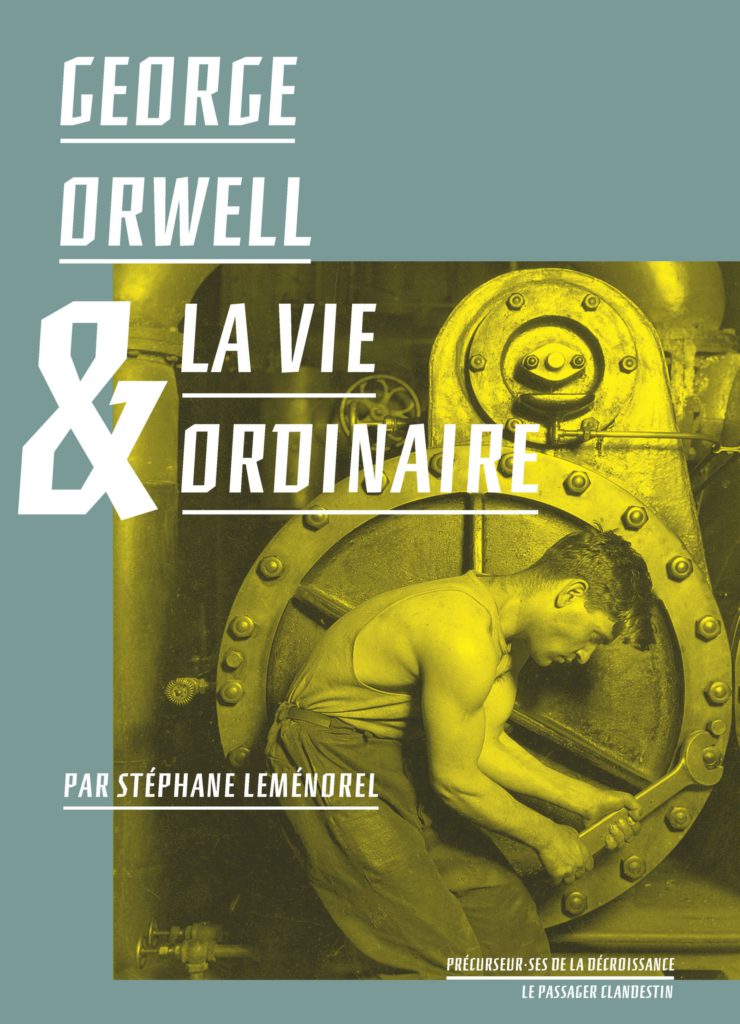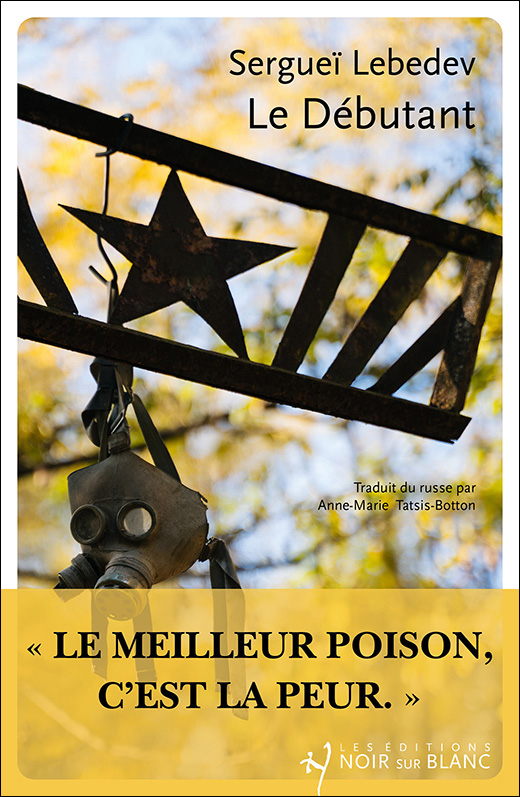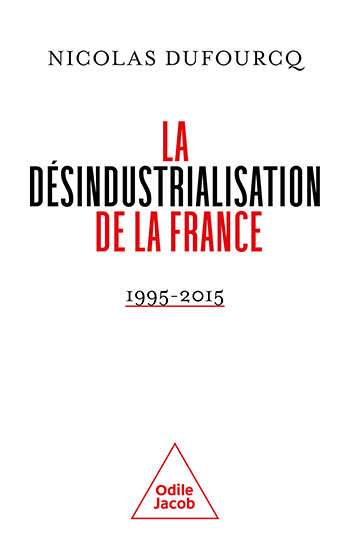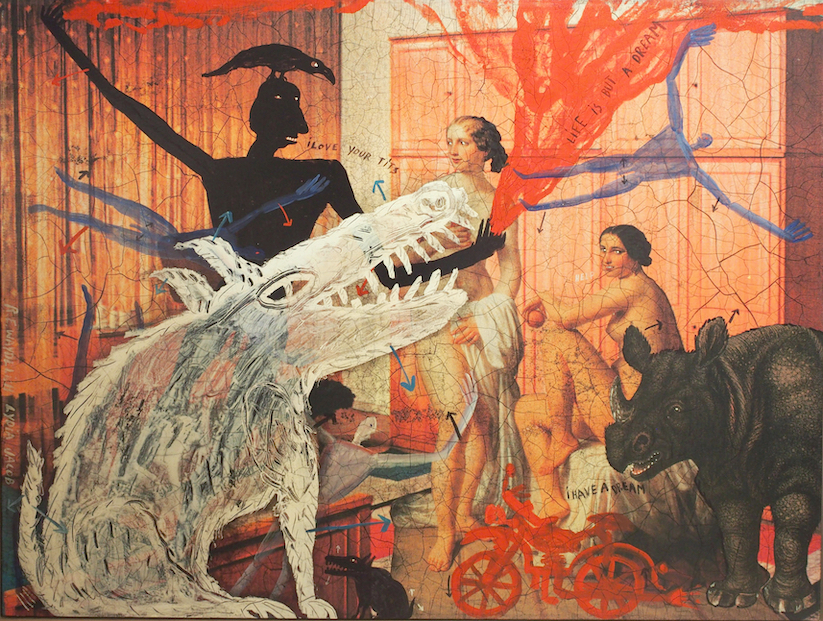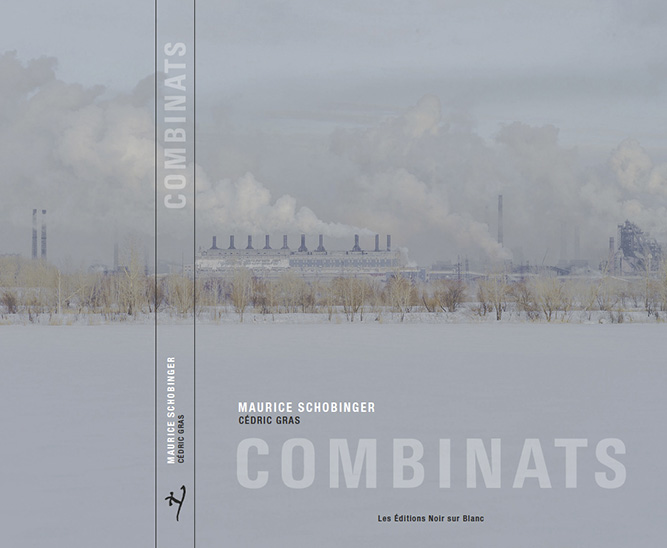Pour sa dernière saison au TJP-CDN Renaud Herbin ne déroge pas au grand principe qu’il a mis en œuvre lors de son arrivée dans cette mémorable institution il y a 11 ans, à savoir la liaison Corps-objet-image. La programmation est, comme il se doit, prometteuse avec pas moins de vingt-deux spectacles qui s’adressent à tous, certains même aux très jeunes. Elle débutera par deux créations de Renaud Herbin « A qui mieux mieux » à voir dès 3 ans, interprété par Bruno Amnar, qui évoque avec des kilos de laine la venue au monde d’un petit être qui va découvrir la réalité de la vie et par sa sensibilité s’ouvrir à tout ce qui peut l’émerveiller.
Puis ce sera la reprise de « Par les bords » avec le danseur Côme Fradet qui exprime comment un être désemparé, fragilisé par les aléas de la vie, par le déracinement qui lui fut imposé, essaie puis réussit à se redresser, à trouver un équilibre pour se reconstruire (spectacle inspiré par la situation des Afghans obligés de fuir leur pays). Ces deux spectacles sont produits par le TJP-CDN et
« L’Etendue », compagnie implantée à Strasbourg que vient de créer Renaud Herbin pour poursuivre son activité de création telle qu’il la conçoit « à la croisée de l’écriture chorégraphique et de la poésie ».
Nous retrouverons des artistes déjà venus au TJP-CDN comme Pierre Meunier, ce « réenchanteur du monde » qui propose avec sa fidèle compagne Marguerite Bordat un oratorio inspiré de l’œuvre de Gaston Bachelard, des textes accompagnés par la violoncelliste Noémie Boutin et la pianiste Jeanne Bleuse.
Le performeur, scénographe et metteur en scène David Séchaud présente avec Paul Schirck « Indomptable » qui mêle bricolage, électro-magnétisme, dérision, magie et poésie.
Julika Mayer revient dans trois spectacles dont « Ding » à voir dès 2 ans où elle crée l’étonnement avec une simple couverture de survie découpée et manipulée avec un sèche-cheveux.
Dans « La cérémonie du poids » avec Rafi Martin elle met en jeu le corps confronté aux arts martiaux et dans « Résonancias » les deux artistes accompagnés du musicien Fernando Munizaga nous invitent à prendre en considération le monde qui nous entoure.
Damien Bouvet explore en compagnie de trois musiciens les aventures d’un prince transformé en oiseau. Mettant en jeu son corps et sa voix, il arrive à jouer tous les personnages de ce conte à voir dès 3 ans.
Retour aussi de la plasticienne Christelle Hunot avec « Panoramique no1 Eloge du blanc » (à voir dès la naissance) où, manipulant des draps blancs, elle crée un univers sensible et une réflexion sur le temps.
Marion Collé, fildefériste et poétesse crée pour cinq acrobates « Traverser les murs opaques » pour montrer qu’on peut danser sur un fil tendu et lutter contre l’impuissance.
Quant à Miet Warlop , elle ramène ses personnages bricolés dans leur maison de carton
dans « After all Springville. Disasters and amusement parks », un spectacle burlesque, drôle, avec un scénario catastrophe comme elle les aime.
D’autres spectacles nous attendent, en particulier “Gadoue“ qui n’avait pu passer aux Giboulées. Dans ans ce corps-à corps avec la matière, Nathan Israël fait l’éloge du jeu et de la patouille.
Jeu aussi avec les objets dans « Traits » où à l’aide d’une roue Cyr Coline Garcia réalise une œuvre picturale.
De nombreux effets Ivon Delpratto de proposer au public de curieuses images parfois tronquées et à reconstruire.
De multiples objets serviront à Laurent Meunier dans « La construction » à créer un spectacle qui tient de l’art brut, une performance de micro-cirque en lien avec le public pour créer surprise et dérision avec de petits riens.
Public acteur aussi dans « Déplacer les montagnes » (dès 6mois) de Fanny Bouffort qui offre à manipuler des objets en bois en forme de runes scandinaves.
La participation du public est requise aussi dans « Le feu de l’action » par Mickael Chouquet et Balthazar Daninos deux chercheurs loufoques qui essaient de comprendre les pathologies de l’action.
Spectacles plus existentiels « Le renard de l’histoire » d’Antoine Cegarra nous parle de la mémoire, des disparitions, du passé et de l’avenir avec de nombreux effets lumineux et sonores qui évoquent des présences spectrales.
A la limite du monde humain et animal on trouvera « L’odeur du gel » d’Emily Evans le rêve du Grand Nord peuplé d’étranges créatures.
« Les Multigrouillaes » présente un monde fantastique d’insectes accroché à sa loupiote, en totale dépendance du minerai lumineux qui l’alimente et dont le manque crée l’obligation de se métamorphoser.
La plupart des spectacles offrent la possibilité de rencontres avec les artistes ou de s’inscrire dans des chantiers de façon à mieux comprendre les gestes artistiques et de devenir soi-même créatif.
Renaud Herbin a fait du TJP-CDN, un lieu de création et de coproduction, un lieu d’accueil qui attache une grande importance aux multiples rencontres entre le public et les artistes. Il laisse une maison en parfait état de marche.
Marie-Françoise Grislin