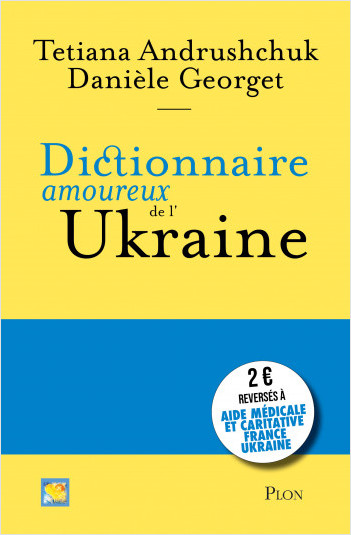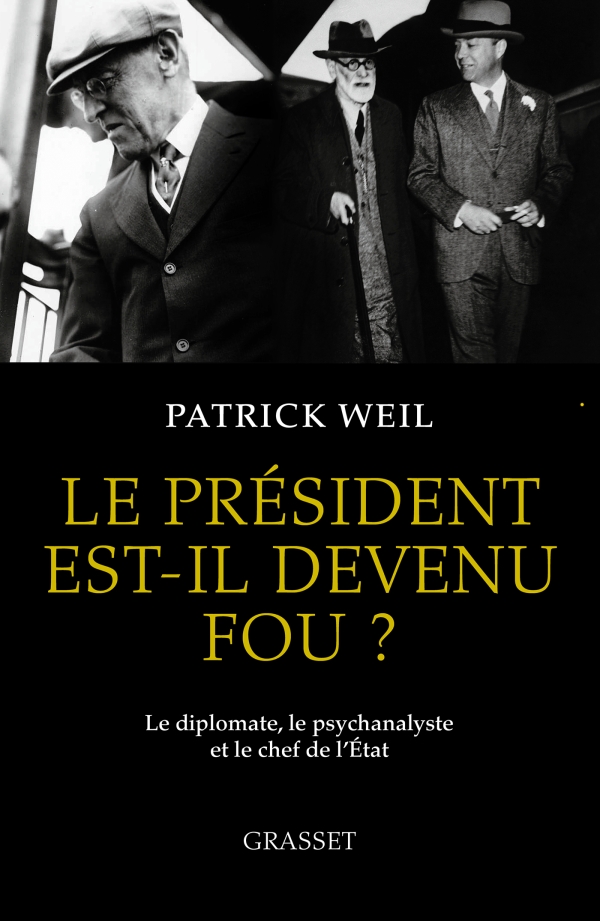L’année dernière, le festival s’était trouvé confronté à un adversaire de taille, le COVID. La pandémie s’était installée durablement dans nos vies, et avait failli priver les amateurs de films de genre de leur frisson annuel. C’était sans compter sur la volonté des organisateurs, qui avaient réussi à maintenir la manifestation en la proposant en format dématérialisé. Un festival intégralement en ligne, histoire de montrer que Gérardmer n’avait pas dit son dernier mot et qu’il en faudrait plus pour annuler l’événement.
En cette fin de mois de janvier 2022 le festival a réinvesti les salles, un soulagement pour les habitués. Car le spectre de la pandémie n’était jamais loin, et jusqu’au bout l’incertitude quant au maintien de l’événement a plané dans l’esprit du public. La fréquentation était bonne, identique à 2020, ce qui était surprenant vu les contraintes de pass vaccinal + gestes barrières imposés aux spectateurs (masque obligatoire dans les salles de projection, restaurants, bars, lieux fermés….). Mais les amateurs étaient présents, avec toujours cette capacité inimitable à chauffer les salles. Avec 10 films en compétition le festival avait vu grand, et les membres des jurys avaient tous répondu à l’appel. Julie Gayet était présidente du Jury Compétition longs-métrages. Elle était assistée de Grégory Montel, Alexandre Aja (un habitué du festival), Suliane Brahim, Valérie Donzelli, Mélanie Doutey, Bertrand Mandico et Pascal-Alex Vincent.
Pour la compétition courts-métrages, c’étaient les jumeaux Ludovic et Zoran Boukherma (ils nous avaient donné l’excellent Teddy l’année dernière à Gérardmer) qui se chargeaient de la présidence. Ils étaient assistés de Shirine Boutella, Saïda Jawad et Antonin Peretjatko. Le millésime était bon, nous allons évoquer certaines péloches sortant du lot.
On a commencé notre voyage avec She Will, film du Royaume-Uni mis en scène par Charlotte Colbert et sélectionné dans le cadre de la compétition officielle. Lors de sa première projection à l’Espace Lac, la comédienne principale, Alice Krige, est montée sur la scène pour présenter le film, dans lequel elle interprète une ancienne star vieillissante. Très habile dans le sous-entendu, She Will nous permet de croiser cette vieille trogne de Malcolm McDowell et de partager la psyché ô combien perturbée de son personnage principal.
Saloum, production franco-sénégalaise, était un film de genre bien sympathique. Le producteur Alexis Perrin et le comédien principal Yann Gaël avaient expliqué la genèse du film à un public toujours accueillant. Le long-métrage s’articulait autour de la cavale sanguinaire d’une équipe de mercenaires à travers la Guinée Bissau, la Gambie et le Sénégal. Saloum propose un étonnant mélange des genres qui fonctionne bien. Un film fantastique en langue française que l’on aimerait bien voir distribué.
Le film taïwanais The Sadness, était présenté en compétition du festival. Alors là même les plus fatigués des spectateurs ne risquaient pas de s’assoupir, tant le long-métrage proposait un cocktail survitaminé à base de gore (beaucoup) et de sexe (un peu). Dans cette histoire de virus qui se propage dans les rues de Taïwan, nous suivons la course effrénée de Jim et Kat. Le metteur en scène Rob Jabbaz n’y va pas par quatre chemins. Il parvient à choquer, ce qui est un des impératifs du sous-genre des « films d’infectés » tout en débordant sur des terrains plus sensibles. Le film nous fait partager une forme de poésie dans la tragédie, même si celui-ci est devenu plus célèbre pour son horreur décomplexée.

Puis Paco Plaza faisait son entrée, 14 années après son passage fracassant à Gérardmer avec le premier REC (récompensé par 3 Prix à l’époque, celui du Jury, du Jury Jeunes, et du Public), coréalisé avec Jaume Balaguero. Le réalisateur est monté sur la scène du Lac afin de présenter La abuela, présenté en compétition. Son film nous a embarqué dans un cauchemar éveillé aux côtés de son personnage principal, Susana, appelée au chevet de sa grand-mère (la abuela en question) qui a fait un avc. Le film se clôt sur une conclusion glaçante, comme on les aime à Gérardmer. Le film fut récompensé par le Prix du Jury (ex-aequo avec SHAMAIN de Kate Dolan).
Mona Lisa and the Bood Moon est réalisé par la réalisatrice américaine d’origine iranienne Ana Lily Amirpour (qui nous avait donné il y a déjà 8 ans l’étonnant A Girl Walks Home Alone at Night, film de vampire en noir et blanc dans un enfer iranien). Le spectateur y suivait les errances d’une jeune fille au coeur de la Nouvelle-Orléans. Échappée lors d’une nuit de pleine lune d’un hôpital psychiatrique où elle était enfermée depuis plus de dix ans, Mona Lisa Lee est une jeune fille dotée de pouvoirs paranormaux. Elle va découvrir un monde qu’elle ne connaît pas. Emmenée par une bande-son phénoménale (le film a été récompensé par le Prix de la Meilleure Musique), la cavale de Mona invite le spectateur à une vision finalement optimiste du monde. Ana Lily Amirpour fait un portrait de l’innocence, confrontée à l’inconnu, mais sous l’angle de la bienveillance. Avec ses personnages bien écrits (et un contre-emploi de Kate Hudson, ici à des années-lumière de ses rôles habituels) et ses éléments de comédie habilement mêlés au fantastique, Mona Lisa and the Blood Moon est une pellicule inclassable. Le film aurait bien mérité un prix supplémentaire.
Dans le film d’animation japonais de Takahide Hori intitulé Junk Head il est question de la survie de l’espèce humaine dans un futur lointain. Les hommes sont devenus éternels, mais ne peuvent plus se reproduire. Un humanoïde est envoyé au plus profond de la Terre, afin de comprendre ce que sont devenus les madrigans, ces créatures créées par l’homme pour les servir. Les personnages animés en stop-motion sont étonnants (la créature d’Alien fait plusieurs apparitions remarquées), et s’expriment via un mélange de borborygmes incompréhensibles, onomatopées et sons étouffé. Le film questionne sur la vie, la mort avec des personnages qui deviennent attachants.
After Blue (Paradis sale), le délire (sans connotation négative) proposé par Bertrand Mandico ne laisse par insensible. Dans ce film de science-fiction présenté hors compétition, Bertrand Mandico nous invitait à rejoindre Roxy, fille de Zora, sur la planète After Blue. Sur cette planète uniquement peuplée de femmes, Zora, jeune fille un peu fantasque, aurait commis l’irréparable, libérer une meurtrière, Kate Bush (!!!). Elle devra partir à sa poursuite pour l’éliminer. Le long-métrage de Bertrand Mandico se dévoile très vite. L’histoire nous offre des tableaux visuels inédits, somptueux, et des dialogues surréalistes. Tout à fait à sa place à Gérardmer, After Blue a laissé une impression étrange à l’issue de sa projection. Au point de se demander si on avait réellement assisté à certaines scènes, ou plutôt rêvé…
Le Hongrois Post Mortem, en compétition, met en scène un jeune rescapé de la Grande Guerre, Tomas, qui revient à la vie civile comme photographe des défunts. Il met en scène ceux-ci dans des décors propres à leur entourage, les clichés prenant place ensuite dans les albums de famille. Revenu d’entre les morts, Tomas croit au paranormal, et éprouve une réelle empathie envers les morts. Dans le village où il a été invité les fantômes des défunts se manifestent. Avec son histoire originale et ses moyens limités, le réalisateur hongrois Péter Bergendy a réussi un subtil mélange entre surnaturel et poésie (voir les scènes où Tomas est aux côtés des familles ayant retrouvé la paix). Post Mortem relâche le spectateur sur une impression étrange, entre légèreté et exaltation.
Censor de la galloise Prano Bailey-Bond, était présenté hors compétition. Nous y suivons le quotidien d’Enid Baines, fonctionnaire travaillant pour le bureau de la classification des films en Angleterre. Son rôle à la commission de censure est de s’assurer que les films proposés au public ne sont pas de nature à le traumatiser ou le pousser à la violence. Les nasties mettaient en scène une ultra-violence et un gore assumé et constituaient une défiance criante pour l’establishment d’alors. Avec son petit côté « Peter Strickland », pour le travail sur les sens et la perception, Censor devient de plus en plus oppressant au fil des scènes, pour se conclure par un final tout en fureur.
Autre bonne surprise, Ogre d’Arnaud Malherbe. Présenté en compétition, le film fut projeté à la séance de 20H00 à l’Espace Lac, et fut précédé par la cérémonie-hommage au cinéaste britannique Edgar Wright qui était présent. Celui-ci fut présenté par Alexandre Aja, avant de prendre la parole devant un public conquis. Edgar Wright laissa ensuite la place au réalisateur Arnaud Malherbe. Ogre raconte le nouveau départ que prend une mère et son fils, Chloé et Jules, partis loin d’un époux/père abusif et violent pour s’installer dans un petit village du Morvan. Chloé est accueillie chaleureusement, elle sera la nouvelle institutrice d’une école rouverte pour l’occasion. Dans le village le sujet sur toutes les lèvres est celui de la bête sauvage qui rôde, et s’attaque au bétail des agriculteurs. Pour Jules, qui souffre de surdité, un ogre erre dans la forêt voisine, c’est lui qui s’en prend aux bêtes et a enlevé le disparu. Pour brouiller un peu plus les pistes, il introduit le personnage du médecin du village, interprété avec une (trop ?) grande ambiguïté par le comédien Samuel Jouy. La surdité de Jules est l’occasion de pure frayeur, le gamin enlevant ses prothèses auditives aux moments-clefs. Le film se laisse regarder avec plaisir, avec une fin très ambigüe.
Dans The Innocents du Norvégien Eskil Vogt le spectateur suit un groupe de jeunes enfants habitants dans une banlieue nordique. Les nouveaux venus vont se mêler aux résidents, et découvrir qu’ils partagent certains pouvoirs paranormaux. Dès les premières scènes on ressent le trouble lié à la cruauté si particulière dont seuls les enfants sont capables. The Innocents ne s’embarrasse pas de spectaculaire inutile. Eskil Vogt s’appuie avant tout sur l’émotion et la suggestion. Mention spéciale à la comédienne norvégienne Alva Brynsmo Ramstad qui crève l’écran dans le rôle d’Anna, la grande sœur handicapée de l’héroïne, et à Rakel Lenora Flottum qui incarne le rôle principal, Ida. Celle-ci alterne le côté inexpressif et la spontanéité naturelle des enfants avec une facilité déconcertante. Le film fut doublement récompensé à Gérardmer, avec le Prix de la Critique et celui du Public.
Avec le délirant Crabs, projeté lors de la Nuit Décalée, il s’agissait de fournir un délire digne des pires soirées vidéo de notre adolescence. Et force est de reconnaître que le film remplit parfaitement sa mission. Dans cette histoire de crabes modifiés suite à des radiations, les comédiens en font des tonnes, les crabes improbables le disputent à la monstrueuse créature finale, la musique tonitruante côtoie des dialogues stupides à souhait sans le moindre complexe. Peirce M Berolzheimer assume le côté délire sans queue ni tête de Crabs, et finalement son film s’avère une petite bouffée d’oxygène au coeur de projections plus anxiogènes qui font le quotidien du festival.
Eight for Silver du britannique Sean Ellis, qui nous avait déjà présenté The Broken lors de l’édition 2008 du festival. Nous y suivons John McBride, pathologiste appelé à la rescousse au coeur d’un village de la France rurale à la fin du 19ème siècle. Des événements surnaturels mettent le village à feu et à sang. Les légendes tziganes auraient ressuscité un monstre carnassier proche du loup-garou. Tant mieux, à Gérardmer on adore les loups-garous ! La photographie est réussie, en particulier par temps obscur, dans les brumes qui envahissent la forêt et les marécages au petit matin. Un récit que les amateurs ont apprécié, entre bestiaire imaginaire, poésie et malédiction.
Voilà, c’en est fini de ce tour d’horizon de la 29ᵉ édition du Festival International du Film Fantastique de Gérardmer. En renouant avec son public, la manifestation a prouvé qu’elle n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction. Avec 40 000 spectateurs, le festival a retrouvé les chiffres de l’année 2020, et confirme sa place au coeur du genre. Les spectateurs ont progressivement quitté la Perle des Vosges, et pensent déjà à la prochaine édition. La 30ᵉ, qui devrait nous réserver bien des surprises…
Jérôme MAGNE