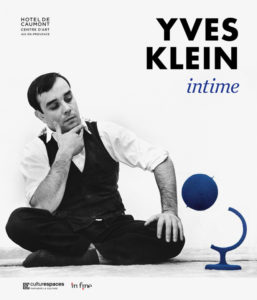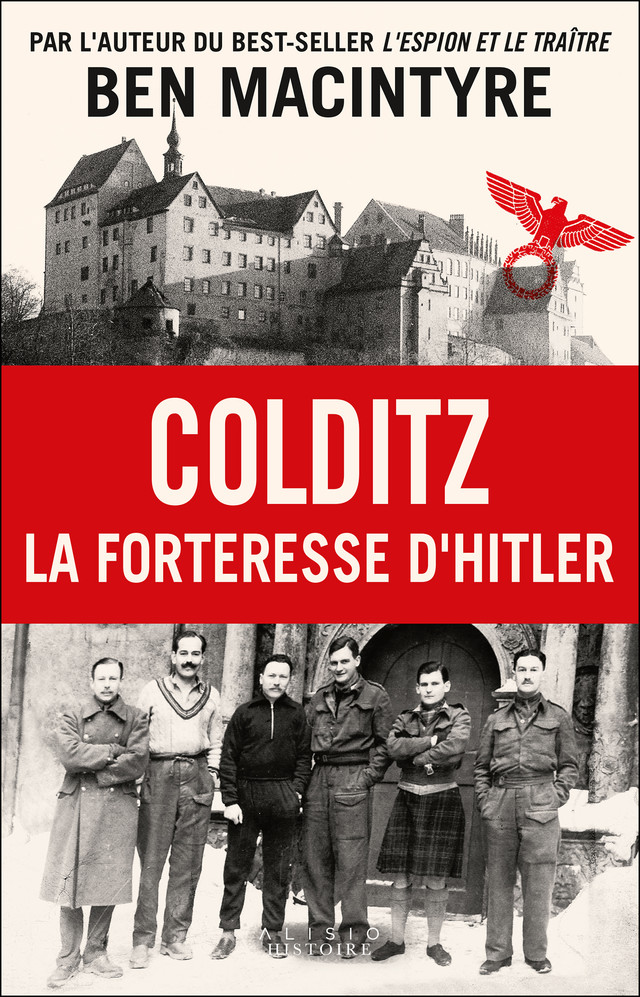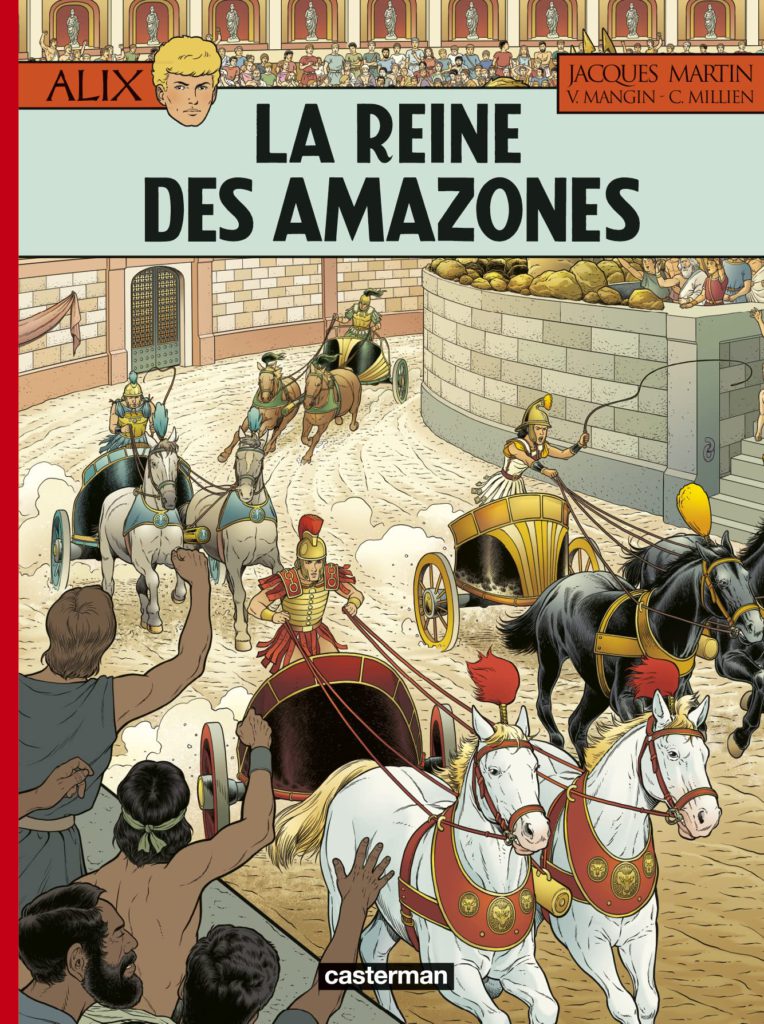Le retour des absents semble fasciner Laurent Mauvignier, l’auteur de cette pièce de théâtre pour le moins étrange et captivante mise en scène par Arnaud Meunier.
La scénographie nous montre l’intérieur vide et impersonnel d’une maison de campagne dans laquelle on n’a plus remis les pieds depuis longtemps, délaissée qu’elle fut pour cause de drame, réoccupée en ce jour particulier de l’enterrement du grand- père.
En effet, c’est là que dix ans auparavant a disparu Elisa, la fille de ce couple venu là par obligation et qui s’apprête à quitter les lieux. Impossible de le faire en toute hâte comme le souhaite la femme, car l’homme qui est le fils du défunt avance la nécessité de régler les affaires chez le notaire. Mécontentement évident de l’épouse et irritation manifeste de part et d’autre. Cependant que très vite surgit le vrai prétexte à rester. Lui avoue avoir fait au cimetière une rencontre surprenante en la personne d’une jeune fille qui se prétend être leur fille disparue et ça, la femme ne veut pas l’entendre et refuse l’idée même de la voir. S’ensuit une véritable scène de ménage car son mari monte sur ses grands chevaux ne comprenant pas l’attitude de sa femme et voulant la persuader de dépasser ses préjugés concernant cette fille qu’elle qualifie sans l’avoir vue de folle et d’usurpatrice.
Commence alors une sorte d’enquête pour déterminer l’identité de la jeune fille et cela dans un climat de tension extrême entre le mari et la femme.
La jeune fille a ramené dans une boîte de chaussure une robe rouge, or elle en portait une le jour de sa disparition. Pour lui c’est quasiment une preuve car au fond de lui il croit que cette fille peut être leur fille, il veut, d’ailleurs que leur fils vienne la rencontrer au grand dam de sa femme qui ne souhaite pas le retour du garçon, prétextant qu’il doit préparer ses examens. De toute façon elle ne peut concevoir la possibilité de voir resurgir l’enfant disparue comme si cela devait rouvrir une plaie sans doute pas vraiment cicatrisée, à peine en rémission. Comme si elle se protégeait de la souffrance.
La totale incompréhension qui s’installe entre eux s’exprime par un comportement bien différent de l l’un et de l’autre. Pendant qu’elle reste figée, toujours maitresse d’elle-même, sourde aux injonctions violentes que ne cesse de lui adresser son mari, (magnifique interprétation d’ Anne Brochet), lui passe par des phases d’agitation suivies de moments d’abattement, de remémoration, de doute (Philippe Torreton excelle de justesse dans ses colères et son désespoit) et presque d’hallucination au cours desquelles son père apparaît et lui dit tout ce qu’il a sur le cœur concernant leur relation, lui reprochant la rareté de ses visites ou la faiblesse de son caractère. A l’évidence père et fils ne sont pas dans le même monde, au sens propre et figuré. Dans cette mise en scène le grand-père est réellement incarné avec son langage direct et cru de vieux paysan par Jean-François Lapallus qui campe un personnage truculent qui prête à rire et allège ainsi l’atmosphère
Bientôt, la jeune fille fait une entrée timide dans la maison, encouragée par le père. Prestation également impressionnante de la comédienne Ambre Febvre qui montre une possible Elisa dont le corps manifestement a été malmené, mal nourri, et en est presque déformé, elle en fait une sorte de sauvageonne apeurée mais qui cherche une reconnaissance à travers des paroles plus ou moins incohérentes qui évoquent une probable séquestration rendant plausible sa réapparition.
L’arrivée du fils (Romain Fauroux) ravive la douleur de la mère qui, sans retenue, lui avoue qu’elle a détesté le voir grandir car cela ne pouvait que souligner l’absence de sa sœur à ses côtés, qu’elle a eu horreur aussi qu’on lui dise de reporter sur lui tout son amour puisqu’elle n’avait plus que lui.
Le garçon qui a rencontré la jeune fille pense qu’elle est peut-être bien sa sœur. La mère très secouée par cette situation que chacun cherche à clarifier à sa façon s’est quelque peu rapprochée d’elle mais reste dans le doute. C’est, alors que le dénouement semble se rapprocher, que la fille s’enfuit, laissant l’énigme irrésolue.
Une histoire qui nous aura tenu en haleine de bout en bout.
Marie-Françoise Grislin
Représentation du 11 avril au TNS
En salle jusqu’au 15 avril