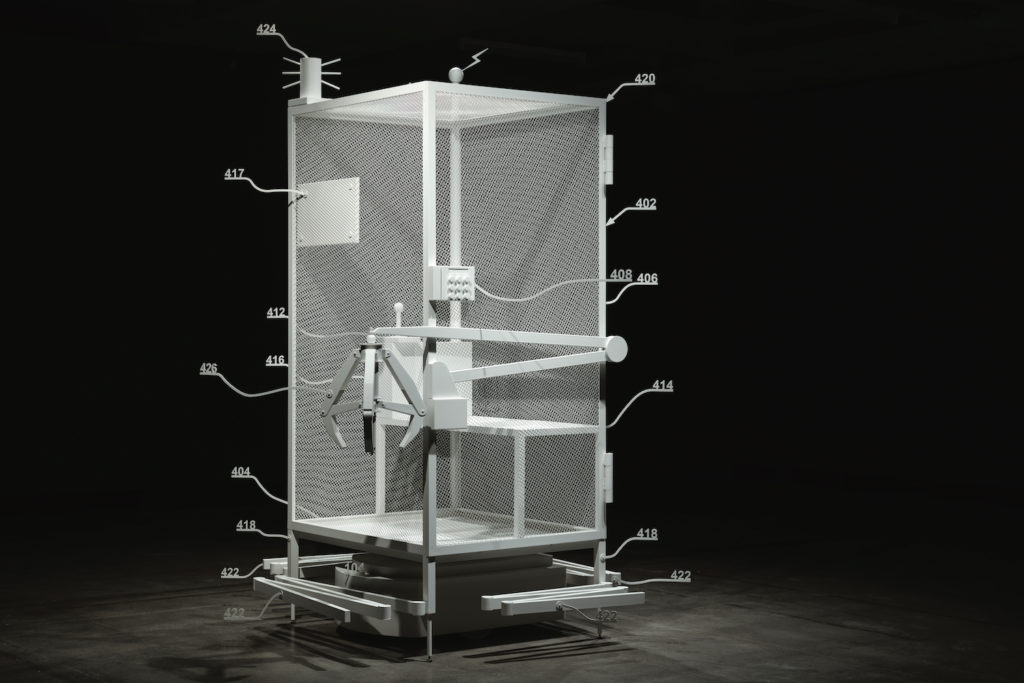La nouvelle exposition des Bassins de lumière magnifie la
Sérénissime

Si vous ne ressortez pas de cette exposition sans avoir une folle
envie d’aller à Venise, alors on ne peut rien pour vous. Car
l’expérience que propose les Bassins de lumières est proprement
stupéfiante. Après Gustav Klimt, le nouveau voyage proposé par le
centre d’art numérique de Bordeaux conduit son visiteur dans la
magie de Venise. Imaginé par l’artiste numérique Gianfranco
Iannuzzi, déjà auteur du Klimt, le visiteur entre dans un véritable
rêve éveillé, à la fois visuel et musical. « Capturer l’esprit du lieu et le
faire vivre, le sublimer par l’image et non l’inverse », tel est son credo.
Celui qu’il met au service de la Sérénissime est à la fois sacré et
profane. Sous nos yeux se succèdent l’histoire de celle qui fut, au
temps de sa splendeur, l’une des grandes puissances maritimes de l’Europe et du monde. Dans cette ancienne base sous-marine où les
couloirs des U-Boot prennent l’aspect de canaux dans lesquels se
reflète l’histoire de Venise, débute ainsi un voyage dans le temps à
travers plusieurs siècles de gloire. Et d’abord à Lépante dans le
magnifique tableau d’Andrea Vicentino où les armées du doge et du
pape remportèrent une victoire décisive face à l’empire Ottoman.
Sur les murs de la magnifique basilique Saint Marc, au style byzantin
éclatant, se révèlent saints de mosaïque et Pala d’oro, ce grand
retable d’émaux aux reflets dorés. Comme un soleil entrant dans un
cloître au crépuscule et au son du Spiritus Sanctus Vivificans
d’Hildegard de Bingen, se dévoilent alors, dans un effet de
mouvement prodigieux, les merveilles d’une ville à la beauté
demeurée intemporelle et devenue ici, surnaturelle, comme
enveloppée dans la main de Dieu.
Les grands peintres vénitiens – Véronèse et ses inoubliables Noces
de Cana, Le Tintoret, Canaletto qui magnifia le Grand Canal,
Carpaccio et Titien avec ses femmes diaphanes – drapent le béton
armé et rivalisent avec les grandes stars de la Mostra tandis que les
passerelles se parent des marbres des palais. Chaque visiteur a ainsi
le sentiment d’être le doge lui-même longeant la colonnade en
dentelles de brique de son palais pour se rendre dans sa loge de la
Fenice. De ce décor émane alors les premières notes d’une musique,
celle des accords baroques et romantiques des Vivaldi, Verdi,
Albinoni et Paganini, qui fait ondoyer l’eau sous nos pieds et anime
des personnages en costumes. La Traviata composée pour la Fenice
en 1853 retentit. On entrevoit des larmes sur les visages des Piéta.
Dans un formidable fondu de noir et de blanc, le carnaval prend vie
et happe le visiteur dans un tourbillon d’émotions. Pendant près de
quarante-cinq minutes, un ancien bunker a ainsi revêtu un
gigantesque et magnifique masque de lumière, à la fois vivant et
mystérieux, sous l’œil impassible du lion de la Sérénissime. L’illusion
est parfaite. En sortant, il nous a semblé voir des gondoles sur la Garonne.
Par Laurent Pfaadt
Venise, la Sérénissime, création de Gianfranco Iannuzzi, Production Culturespaces Digital, Bassins des Lumières, Base sous-marine,
Bordeaux, jusqu’au 2 janvier 2023