Plusieurs ouvrages reviennent sur les grands maîtres des échecs et
sur celle du plus célèbre d’entre eux, l’Américain Bobby Fischer
« Le seul jeu qui appartienne à tous les peuples et à toutes les époques, et
dont nul ne sait quel dieu l’a apporté sur terre pour tuer l’ennui, pour
aiguiser l’esprit, pour stimuler l’âme. Où commence-t-il, où finit-il ? »
écrivait Stefan Zweig dans l’un de ses plus grands livres, Le joueur
d’échecs (1943).
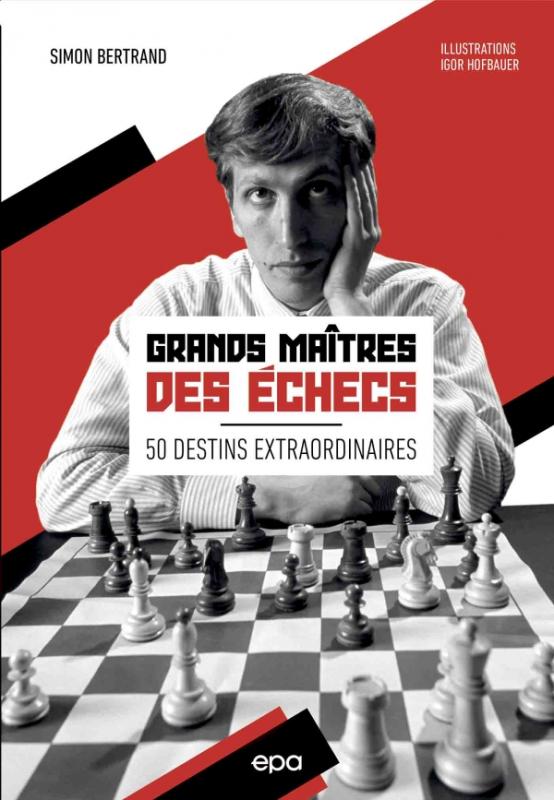
Depuis son introduction en Europe au Xe siècle, les échecs n’ont eu
de cesse de fasciner, empereurs comme écrivains. De Napoléon à
Vladimir Nabokov en passant par Stefan Zweig, Benjamin Franklin
ou Albert Einstein, ils inspirèrent jusqu’à aujourd’hui romans, bande-
dessinées ou séries télévisées comme en témoigne le récent succès
du Jeu de la dame sur Netflix.
Si des tournois ont existé dès le Moyen-Age, ce n’est qu’à la fin du
XIXe siècle que naquit un championnat du monde. Ainsi depuis 1886
et l’autrichien Wilhelm Steinitz et jusqu’au norvégien Magnus
Carlsen, champion du monde depuis 2013, le monde vit avec cette
figure de génie, sorte de super-héros avant l’heure, qui traversa les
frontières tout au long de cette histoire plus que centenaire. C’est ce
que raconte à merveille le très beau livre de Simon Bertrand aidé
d’Igor Hofbauer, auteur de BD qui a d’ailleurs conçu ce livre comme
un comics, lui conférant une esthétique qui devrait séduire tous les
publics et en y injectant ce mouvement, cette force et cette tension
inhérentes à ces parties mythiques analysées.
Au fil des pages défilent ainsi grands maîtres et champions. Ceux de
l’entre-deux-guerres, véritables vedettes adulées, courtisées,
photographiées, sortes de gladiateurs en complets et chapeaux de
feutre qui codifièrent ce jeu à coups de tactiques, d’ouvertures et de
défenses qui servent encore aujourd’hui de manuels à tout
champion en herbe. Ils se nommèrent José Raul Capablanca ou
Alexandre Alekhine. Après la guerre, les échecs devinrent un grand
jeu diplomatique où Américains et Soviétiques s’adonnèrent à une
immense partie qui dura plus de quarante ans. Les échecs servirent à
prouver la supériorité de chaque camp et leurs rois, souvent
soviétiques et affublés de surnoms, s’appelèrent Mikhail Botivnnik,
Tigran Petrossian ou Boris Spassky.
Les Américains, en retard, usèrent alors de leur arme atomique. Elle
porta un nom : Bobby Fischer. Pas de surnom. Juste Bobby Fischer.
Le génie américain, excentrique, mit tout le monde d’accord. Encore
aujourd’hui, des films, des biographies et des romans graphiques
dont celui, très beau, en noir et blanc – comme la vie de Bobby
Fischer – de Julian Voloj et Wagner Willian retracent sa vie et son
destin. Une ville, Reykjavik, devenue le centre du monde le temps de
plusieurs parties, y gagna une réputation éternelle. « On eut dit que
chaque être humain retenait son souffle dans l’attente du tournoi que
tout le monde appelait le duel du siècle » écrit le romancier islandais
Arnaldur Indridason dans son polar dont l’action se situe au moment
du fameux duel Fischer-Spassky en 1972
Et puis Bobby Fischer quitta les échecs comme il y était entré : dans
un ouragan. « Le 3 avril 1975, sans avoir déplacé un seul pion, Anatoli
Karpov devint le douzième champion du monde des échecs (…) Ce jour-là,
Bobby devint le premier champion du monde à renoncer au titre » relate
ainsi Frank Brady, dans ce qui constitue aujourd’hui la biographie la
plus réussie du champion américain. Cet ouragan qui avait déjà avalé
les tempêtes du passé – l’ouvrage de Simon Bertrand s’attache
d’ailleurs à redonner toutes leurs places à certaines figures oubliées
notamment celles, féminines, de la Géorgienne Nona Gaprindashvili,
première femme à avoir obtenu le titre mixte de Grand Maître
international en 1978 ou la Hongroise Judit Polgar – se dissipa en même temps qu’une URSS qui produisit avec Anatoli Karpov et
surtout Gary Kasparov, champion du monde à 22 ans en 1985, ses
derniers cavaliers. Puis l’anonymat médiatique vint à nouveau
recouvrir ce jeu. Ni l’affrontement de l’homme avec la machine
(Kasparov face à l’ordinateur Deep Blue), ni l’arrivée de pays
asiatiques (Chine, Inde) dans la course avec notamment
Viswanathan Anand, champion du monde à plusieurs reprises entre
2000 et 2012, ne changèrent la donne.
On croyait les échecs oubliés, ringardisés. Jusqu’à l’irruption d’une
série qui relança ce jeu qui prouve grâce à ces deux livres
fantastiques que ce jeu est immortel. Mais après tout comme
l’écrivait Stefan Zweig : « n’est-ce pas déjà le limiter injurieusement que
d’appeler les échecs un jeu ? »
Par Laurent Pfaadt
Simon Bertrand, Igor Hofbauer, Grands maîtres des échecs,
50 destins extraordinaires, éditions EPA, 316 p, 2021
Julian Voloj, Wagner Willian, Bobby Fischer, L’ascension et la chute d’un génie des échecs,
Les Arènes BD, 176 p. 2021
A lire également :
La meilleure biographie consacrée à Bobby Fischer : Frank Brady, Fin de partie, Aux forges de Vulcain, 2018, 440 p.
Un thriller palpitant de l’un des maîtres du polar scandinave : Arnaldur Indridason, Le Duel, Métaillé, 2014, 320 p.
Un classique indémodable : Stefan Zweig, Le joueur d’échecs, Livre de poche, 2013, 128 p.
