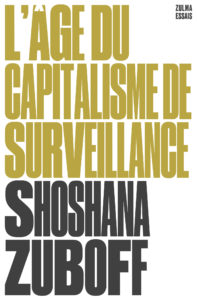Une exposition et un livre
Membres du Schlager Club, Yrak, Fernand et Sven sont les trois
artistes peintres exposés au Malagacha à Strasbourg jusqu’au 12
mars. Laurence Mouillet les a rencontrés et a mis son talent
d’écrivain et de photographe à contribution pour un très beau livre
qui leur est consacré, permettant à un plus large public de mieux
les connaître quand les collectionneurs les ont repérés dès leurs
débuts.

De la rue, notre regard est interpelé par des toiles qui empruntent
leurs couleurs vives au street art. Dès l’entrée, nous sommes attirés
au fond de la galerie par six garçons presque grandeur nature sur
une photo noir et blanc comme une invitation à les rejoindre. Le
Schlager Club dont le nom s’est imposé à eux quand il a fallu qu’ils
s’identifient sur la scène artistique renvoie à ces musiques
populaires jouées dans les bals, bluettes sentimentales ou chansons
amusantes mais aussi à l’idée de ce qui « frappe ». Ces Mulhousiens
ont trouvé un lieu où créer et l’espace nécessaire dans un bâtiment
de la friche industrielle de la Mer Rouge dont deux cheminées
dominent encore le site, éteintes depuis que Mulhouse n’est plus la
ville de la fabrication du rouge garance et du tissage des indiennes
qui faisaient rêver à un ailleurs exotique. Désormais, le rêve choisit
d’autres territoires moins éloignés, il nait sur les murs et s’épanouit
sur la toile.
C’est peu dire que Laurence Mouillet a été inspirée par ces trois
artistes et par ce lieu improbable du Schlager Club. Elle raconte
l’atelier, la menuiserie où se fabriquent les cadres des toiles, le bar
où l’on refait le monde autour d’une bière et le billard au milieu. Elle
raconte les trois garçons et leur parcours en une plume
délicatement ciselée et riche de fulgurances poétiques, séduite
qu’elle a été par la découverte d’un univers pictural qu’elle
connaissait mal. Et au-delà des mots, c’est un regard qu’elle porte
avec une acuité singulière sur les ambiances et le geste des artistes.
Elle joue avec ses propres influences et une photo du bar rappellera
une nature morte de Stoskopff, les portraits des peintres
évoqueront les Flamands par la lumière sur le visage, une photo
renverra au Mystère Picasso de Clouzot qui interrogeait la capacité à
filmer le peintre en train de peindre grâce à la transparence. Il se
joue dans la galerie Malagacha un dialogue étonnant entre les photos et les peintures avec une scénographie qui présente une
œuvre et le peintre à l’œuvre. Notre préférée, une calligraphie de
Sven qui joue sur les noirs, brillant, mat, granuleux encadrée de part
et d’autre par deux photos identiques de deux appliques en verre
fixées sur des briques noires. L’effet de ce contraste entre l’œuvre
très actuelle du graffiti et ces photos de cet objet rétro est des plus
intéressants et illustre à merveille la question de la représentation
de la lumière et de l’obscure clarté, oxymore baudelairien que
Soulages a interrogé toute sa vie. L’art se nourrit de l’art et avance
toujours plus riche.
Les trois artistes exposés ont chacun leur univers même s’ils ont
tous commencé dans la rue. Précisément, Damien Seliciato qui a
inauguré la galerie Malagacha il y a trois ans, avait le désir d’exposer
l’Art Urbain, un art qu’il veut « commercialisable » mais pas
« commercial », balayant la polémique sur l’idée que les graffs
doivent rester dans la rue. Les tableaux de Sven, Yrac et Fernand ne
souffrent pas d’être circonscrits à l’échelle d’une toile. Fernand fait
de chacun de ses tableaux un rébus ou un roman pour qui se plaît à
lire tous les objets qu’il représente et qui appartiennent à son
histoire, à son quotidien. Yrac décline en autant de figures possibles
imaginables les lettres de son nom d’artiste avec une belle pureté
des lignes et des aplats de couleur. Mais qui ne voit pas son nom peut
distinguer un visage de profil, une larme et si le trait déborde le
cadre, sans doute est-ce un clin d’œil pour nous dire que le cadre
n’empêche pas d’être libre. Sven est un passionné de calligraphie. Ses
lettres et signes cabalistiques dont on suit le tracé aux couleurs
éclatantes ou de ces noirs que l’on aime dessinent un monde en soi,
celui d’un artiste reconnaissable entre tous.
Commencer une toile c’est comme sortir dans la nuit noire sans lanterne
et découvrir à l’aube où l’on voulait aller
(Laurence Mouillet – extrait)
L’exposition est visible jusqu’au 12 mars à la Galerie Malagacha, 9 rue du Parchemin à Strasbourg.
Le livre de Laurence Mouillet, Schlager Club, éd. Médiapop, a été tiré
à 100 exemplaires numérotés auxquels sont jointes 3×30
sérigraphies originales des reproductions des grands formats de
chacun des artistes. 10 exemplaires sont accompagnées de la
reproduction de la photo de Laurence Mouillet des cheminées,
intitulée Les Sentinelles (de la Mer Rouge). Les sérigraphies font
15/20 cm. Le livre est vendu 40 euros.
Signature avec les artistes et Laurence Mouillet à la librairie 47°Nord à Mulhouse le samedi 5 mars de 11h à 18h. Le 12 mars avec l’auteure toute la journée à la Galerie Malagacha.
Par Elsa Nagel