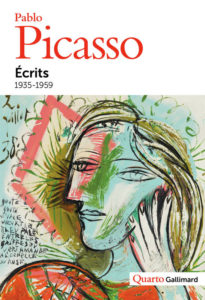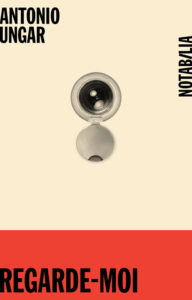Génie de la peinture, Pablo
Picasso fut également l’auteur d’écrits remarquables réunis dans ce nouveau
volume de la collection Quarto
Tout le monde connaît le peintre le plus célèbre du 20e siècle.
Chacune de ses expositions attire des millions de visiteurs. Mais peu
en revanche savent qu’il écrivit une multitude de textes poétiques,
des fulgurances d’une beauté stupéfiante, aujourd’hui reunis dans ce
volume absolument magnifique de la collection Quarto.
Regroupant plus de 340 textes poétiques ainsi que deux pièces de
théâtre, Le Désir attrapé par la queue (1945) et Les Quatre petites filles
(1968), écrits entre 1935 et 1959, ce livre complète, grâce à un
certain nombre d’inédits puisés dans les musées Picasso et dans des
collections privées, l’édition aujourd’hui épuisée du livre d’art
consacré à ses Ecrits en 1989 et coordonnée par Michel Leiris. Ces
textes inscrivent ainsi Pablo Picasso dans plusieurs temporalités :
artistiques bien évidemment où le peintre évoque son rapport à la
peinture mais également sa relation aux écrivains et poètes de son
temps qui virent très tôt en lui l’un de leurs pairs. Historiques
ensuite où les mots de Picasso, sans jamais être explicites,
reviennent tels des aplats sombres sur une guerre d’Espagne qui
s’acheva avec la victoire de Franco – « le roi a mis sa robe de mariée et
paré d’anémones ses cheveux mais le long voile de plomb l’immobilise et
l’écrase » – et sur la seconde guerre mondiale présente dans le Cahier
Royan. Pendant ces années 1935-1940 où même « la lumière se cache
les yeux devant le miroir », sa production s’intensifia comme si l’écrit
devenait pour lui une sorte d’exutoire à cette trop grande souffrance
que la peinture ne parvenait plus à absorber.
Un certain nombre de personnages traversent ses textes, en
particulier les figures de Dora Maar « diablement séduisante dans son
déguisement de larmes et chapeautée à merveille » (18 février 1937)
dont le livre puise abondamment dans l’ancienne collection, et de
Françoise Gilot, « ma femme chérie et la mère de mes enfants Claude et
Paloma que j’aime tellement » (12 avril 1951). Mais également tous
ces poètes et écrivains qui se succèdent dans l’ouvrage, formant un
aréopage de génies, d’Apollinaire qu’il rencontra à Ilya Ehrenbourg
en passant par Max Jacob, André Breton et moins connu, Aimé
Césaire. Car, à y regarder de plus près, Picasso apparaît comme le
double inversé d’un Guillaume Apollinaire et de ses fameux
calligrammes.
Christine Piot, qui a coordonné ce volume avec Marie-Laure
Bernadac, prévient : « Gardons-nous de demander à ce qu’il a écrit la
vérité de ce qu’il a peint. Les poèmes de Picasso ne sont pas la
transcription de ses tableaux » Certes oui, cependant des similitudes
apparaissent comme des repentis poétiques cachés dans sa peinture
et dessinent une œuvre à plusieurs dimensions qui prend tout son
sens à force de la contempler. Faisant fi de l’orthographe et de la
grammaire comme des codes de la perspective qu’il transgressa,
Picasso assume son impuissance face à la force créatrice de l’art :
« La peinture est plus forte que moi / Elle me fait faire / Ce qu’elle veut ».
Et à la lecture de ces textes, sa poésie semble effectivement obéir à
la même logique.
Ce livre absolument fabuleux, est un véritable musée de papier que
l’on parcourt à foison, s’attardant ici sur telle ou telle œuvre,
parcourant là tel manuscrit ou lettre. Un livre sans fin qui se lit dans
tous les sens, se débute et s’achève à n’importe quelle page. Picasso
est omniprésent mais jamais écrasant. Il survole le lecteur, l’invite à
entrer dans son œuvre selon son bon plaisir, à travers la description
d’un repas, la manière de se torcher le cul de façon propre et
élégante ou dans l’analyse de cet Enterrement du comte d’Orgaz
(1978) qui passe du théâtre à la poésie avec le consentement
implicite du grand Greco.
En 1931, Picasso illustrait le Chef d’œuvre inconnu de Balzac. Voici
celui du peintre enfin révélé entre nos mains…
Par Laurent Pfaadt
Pablo Picasso, Ecrits 1935-1959, édition présentée et annotée par Marie-Laure Bernadac et Christine Piot,
collection Quarto, Gallimard, 936 p.