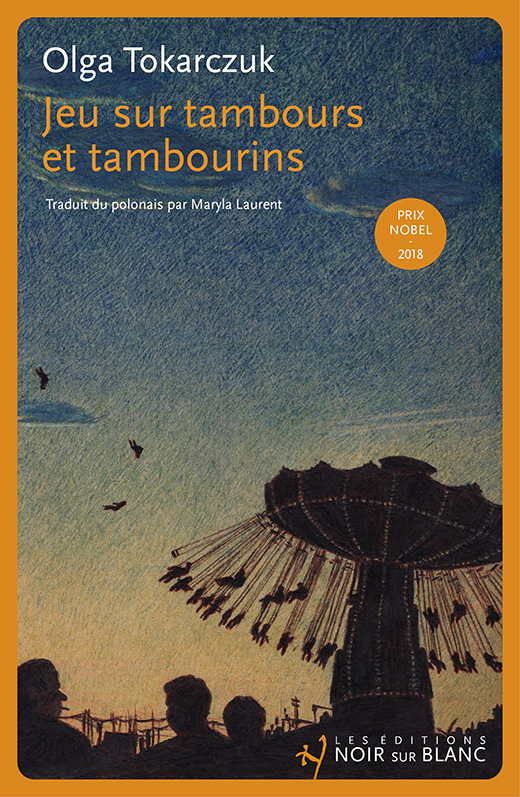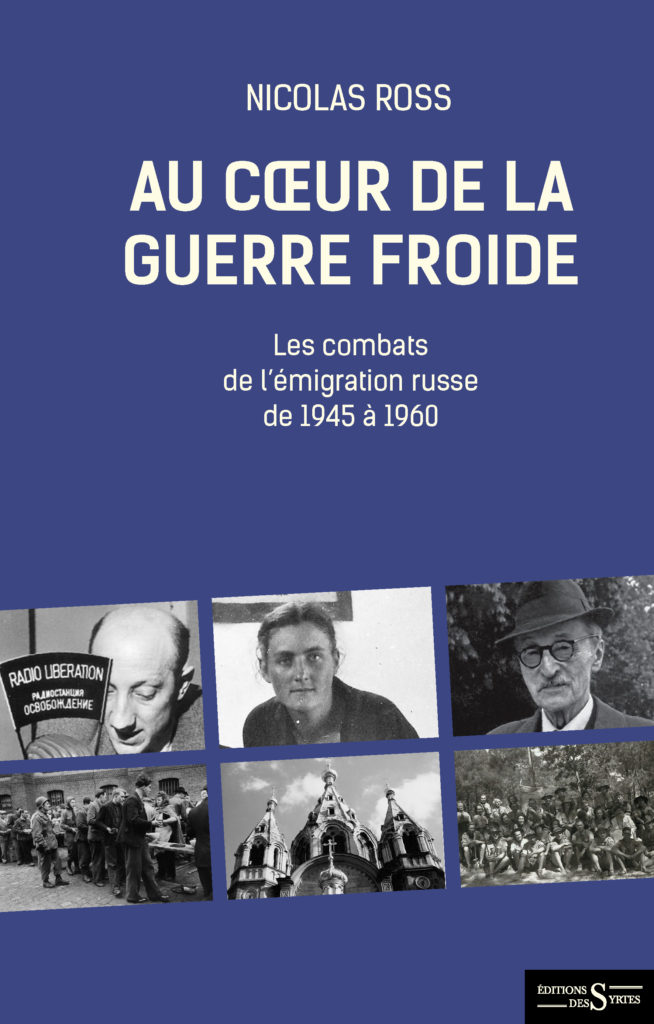Texte de Marie Ndiaye
Mise en scène Blandine Savetier
Ces deux artistes sont associées au TNS et d’elles nous avons pu voir plusieurs de leurs oeuvres, de l’auteur « Hilda »en 2021 mise en scène par Elisabeth Chailloux, « Les Serpents » par Jacques Vincey en 2022 et « Berlin mon garçon » par Stanislas Nordey en 2O22 et les mises en scène de Blandine Savetier pour« Neige » d’Othan Pamuk en 2021 et pour « Nous entrerons dans la carrière » en 2021.
La pièce, une adaptation par Waddah Saab et Blandine Savetier du texte deMarie Ndiaye créée ces derniers jours au TNS ne manque pas d’originalité à plus d’un titre.
Et tout d’abord par sa construction en abîme.
Tout commence en effet par la genèse de l’œuvre, une commande à Marie Ndiaye du Musée d’Orsay et des éditions Flammarion à l’occasion de l’exposition « Le Modèle Noir » en 2019. Peut-être moment d’angoisse pour trouver le sujet adéquat. C’est ainsi que naît le personnage de la narratrice, clone de l’autrice en quelque sorte, historienne, professeur d’université que va interpréter Natalie Dessay et qui se met en demeure d’évoquer une chanteuse noire, d’origine cubaine dénommée Marie l’Antillaise dont on dispose de quelques photos du célèbre photographe Nadar. Il s’agit probablement de Marie Martinez qui connut une gloire éphémère au XIXème siècle. En plein souci d’écriture elle fait alors la rencontre de Marie Sachs, une artiste noire qui prétend réincarner Marie Martinez et l’invite à trois reprises à assister à ses shows. Ainsi se met en place la chaîne des personnages évoqués dans cette œuvre.
Ensuite, l’originalité de la pièce tient aussi à l’extrême attention apportée à la scénographie, signée Simon Restino, qui voit la narratrice habiter un ancien piano à queue désaffecté placé à l’avant-scène qui lui sert de refuge pour se livrer à ses réflexions et pour éventuellement écrire. Et à la projection en fond de scène de l’image de l’intérieur du théâtre de l’Odéon puis à l’installation de lourds rideaux qui permettent l’apparition ou la sortie de l’artiste accordant à celle-ci un certain prestige jusqu’au délabrement final dans le désordre et l’obscurité.
Enfin le caractère particulier et remarquable de cette pièce vient sans aucun doute de la confrontation entre les deux femmes, la narratrice en perpétuelle recherche d’inspiration, constamment préoccupée par le doute au sujet de la légitimité d’écrire sur une artiste disparue dont on ne dispose que de peu d’éléments de sa biographie et la danseuse et chanteuse Marie Sachs qui se produit de façon magistrale sous les yeux ébahis de la narratrice. Le contraste entre les deux personnages est saisissant et leur interprétation finement menée. D’un côté Natalie Dessay qui campe une narratrice agitée, tendue, crispée quelque peu envieuse de la liberté, du talent, de la créativité dont fait preuve Marie Sachs mais qui ne peut résister à répondre à ses invitations qui la laissent subjuguée toujours en proie aux affres de la création. De l’autre, Nancy Nkusi, qui donne à Marie Sachs sa prestance, son élégance, son talent de danseuse et de chanteuse. Revêtu de robes somptueuses ou de justaucorps seyants, (costumes Simon Restino et Blandine Savetier) son corps s’envole, se contorsionne, glisse et se déploie avec une virtuosité sidérante accompagné par la musique qu’interprète en live le musicien Greg Duret qui n’hésite pas à quitter sa console pour danser à ses côtés, certes avec moins de grâce mais avec un enthousiasme et une frénésie quelque peu clownesques pouvant illustrer l’aspect « cabaret » de la prestation de l’artiste.
La fin est une énigme et une résolution. Après une séance éprouvante où la danseuse déchaînée semble vouloir envoûter la narratrice, elle disparaît à l’instar de son modèle, Marie Martinez, tandis que la narratrice se sent prête à entrer dans l’écriture de son sujet comme si une certaine osmose s’était opérée entre elles, la transmission de la possibilité chacune dans son domaine de créer.
Marie-Françoise Grislin
Représentation du 2 mars au TNS
En salle jusqu’au 10 mars