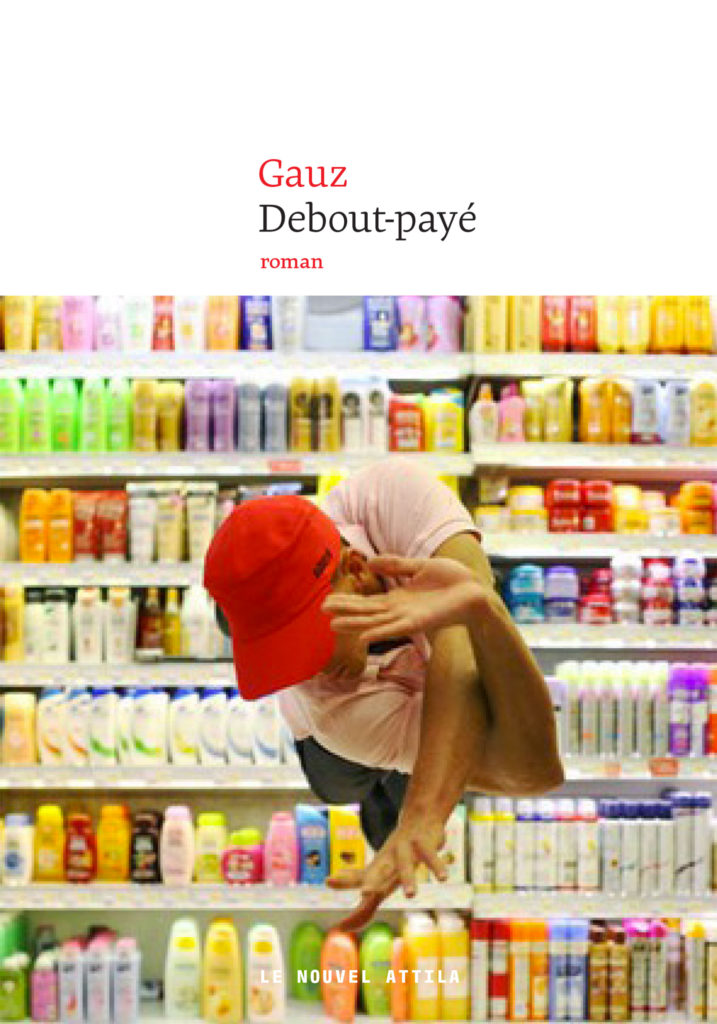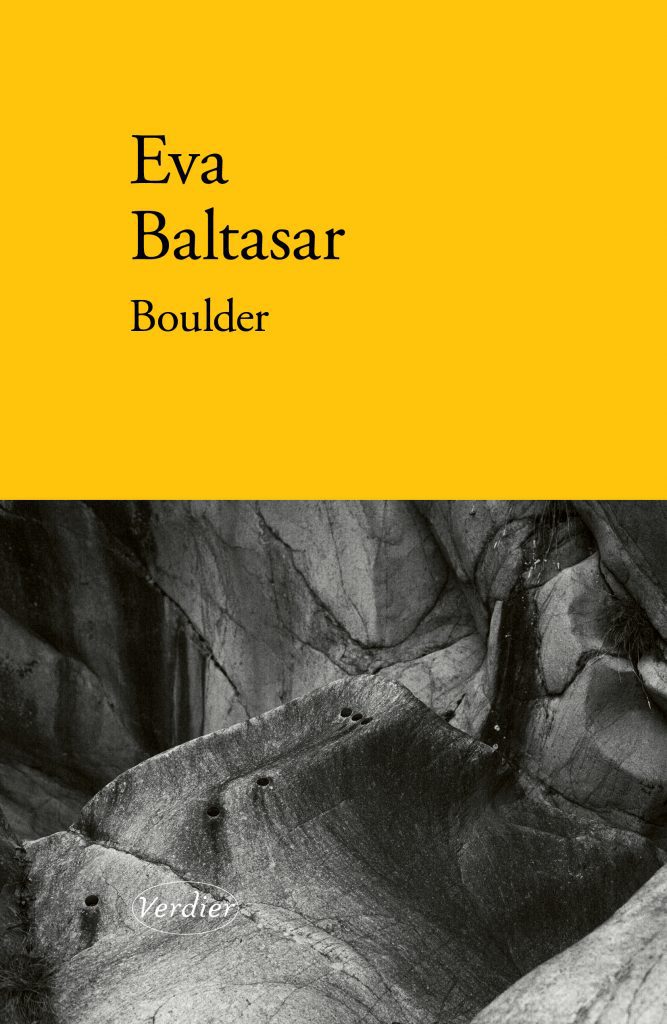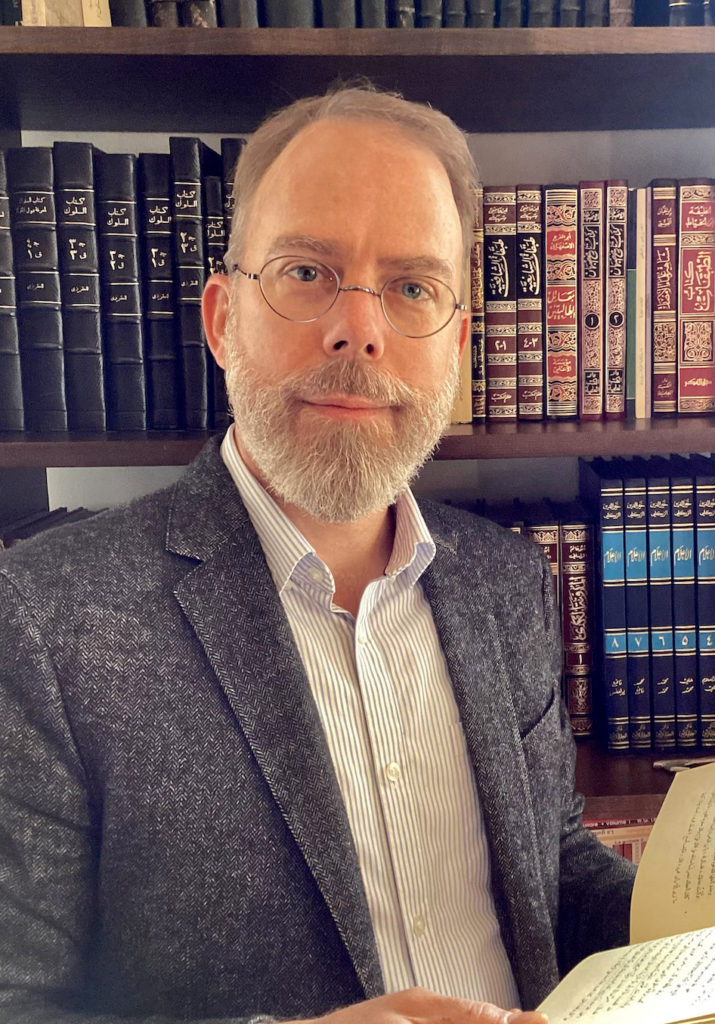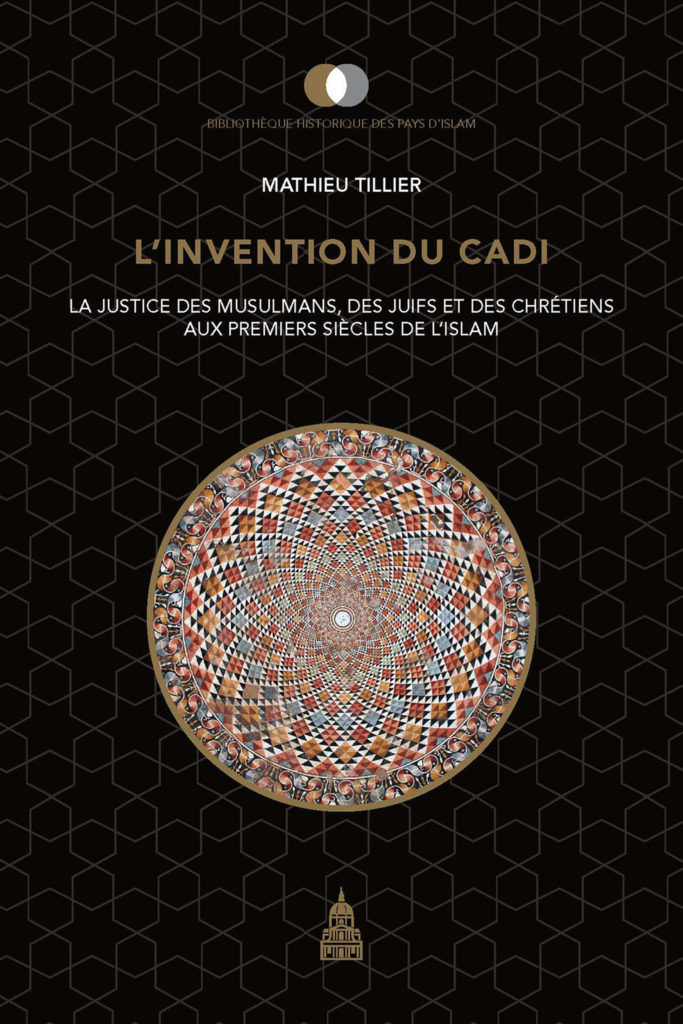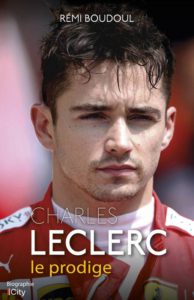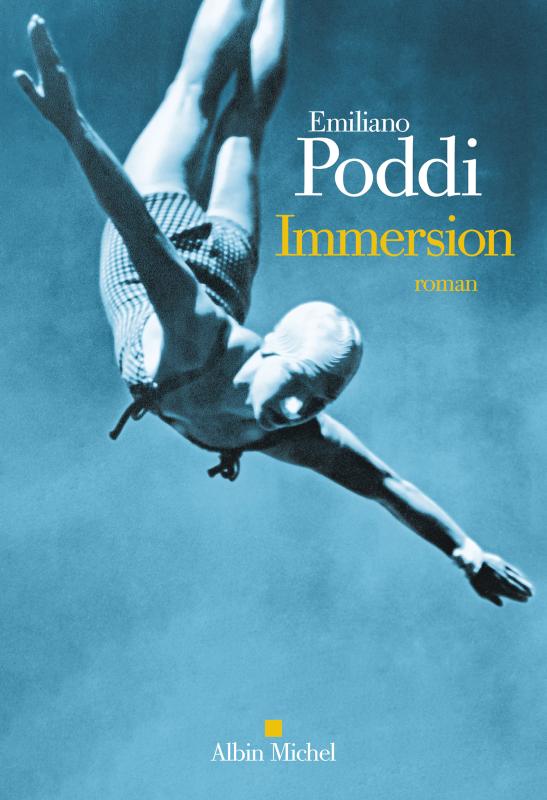L’écrivain Gérard de Cortanze raconte avec passion l’histoire de l’automobile
Chez les Cortanze, littérature et automobile ont toujours fait bon ménage. Et des rallyes de Monte-Carlo que disputa Charles au prix Renaudot que remporta Gérard en 2002, l’histoire se traverse en voiture et à toute allure. Son dernier livre permet ainsi de choisir sa monture parmi cent modèles afin de parcourir cette histoire de l’automobile mais surtout sa propre histoire.

Alors retournons dans la bibliothèque de l’écrivain pour emprunter le juste bolide. Sur les rayonnages se trouvent ces voitures cachées dans les livres qui, non seulement, se dévoilent sous nos yeux mais disent aussi quelque chose de l’écrivain.
Il y a cette Delahaye 135 qu’admira aux 24h du Mans en 1938, une Violette Morris victorieuse du Bol d’or automobile en 1927 avant de basculer dans la collaboration à qui l’auteur consacra l’un de ses plus beaux livres, Violette Morris, la femme qui court (Albin Michel, 2019). Il y a cette Jeep Willys avec une Martha Gellhorn (Le roman de Hemingway, Le Rocher, 2011) déployant sa magnifique chevelure blonde en retirant son casque au moment d’entrer dans le camp de Dachau avec les Américains. Cette Renault 4 CV, cette « voiture optimiste » tirée de son Dictionnaire amoureux des sixties (Plon, 2018), une voiture qui « est en soit un roman » et dont la fabrication s’acheva en 1961. Et évidemment l’Alpine 110 Renault, « fille émancipée de la Renault 8 Gordini et de la R8 Major », la marque du cousin André. Enfin, ces Ferrari F355 ou F40, Lamborghini Diablo ou Maserati Quattroporte qu’auraient certainement conduit les Vice-rois s’ils avaient vécu à notre époque.
D’autres voitures apparaissent au fil des pages. Les Américaines rivalisent avec les Allemandes et les Japonaises lorsque se dévoilent la Ford Mustang Shelby GT500, la Porsche 911 ou la Nissan Fairlady dans ce magnifique concours de beauté. La course n’est donc jamais bien loin et atavisme oblige, celui qui écrivit sur les 24 h du Mans ne pouvait oublier la Matra Simca MS670 de Pescarolo et Hill (1972) ou la Peugeot 905 victorieuse au Mans il y a trente ans exactement.
Vous l’aurez compris, ce livre est bien plus qu’une simple succession d’images. Gérard de Cortanze nous offre ici un voyage extraordinaire dans ce vingtième siècle automobile palpitant. A la manière d’un Phileas Fogg effectuant un tour du monde, le lecteur change de voiture selon ses envies et observe une époque, un moment, un morceau d’histoire, grimpant tantôt dans la Rolls-Royce Phantom, tantôt dans un combi Volkswagen, tantôt dans une Citroën XM. Mais surtout à travers ses choix personnels, Gérard de Cortanze nous accompagne dans notre propre album familial, celui de nos vacances et des récits de courses mythiques des repas du dimanche midi. Pour nous dire, que l’on soit passionné ou non d’automobile, qu’il y a toujours eu une voiture pour accompagner notre vie.
Par Laurent Pfaadt
Gérard de Cortanze, Une histoire de l’automobile en cent modèles mythiques
Chez Albin Michel, 240 p.