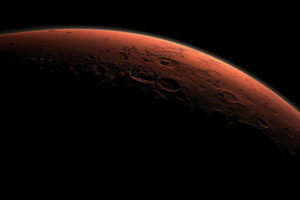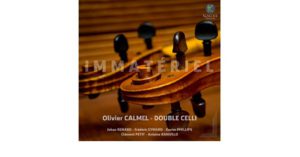© Tom Bauer missoulian
Quand un accident
dans une mine met à
nu une société. Du
grand Kevin Canty
En cette année 1972,
les Etats-Unis sont
au faîte de leur
puissance. Richard
Nixon n’a jamais été
aussi populaire et
l’économie
américaine grâce à l’extraction minière est florissante. Les mineurs
travaillent durs mais sont bien payés. Les samedis soir, tous se
retrouvent au bar et la révolution sexuelle bat son plein. Dans cette
région de l’Idaho, on pourrait croire que tout va bien. Et pourtant. A
l’image de ces hommes qui sentent la gerbe et de ces femmes qui
exhalent le shampoing bon marché, les descentes dans les
profondeurs ne sont pas qu’un métier, il s’agit d’un état d’esprit. Elles
sont permanentes nous dit Kevin Canty. C’est devenu un mode de
vie.
Les héros du nouveau roman de l’écrivain américain que l’on
compare déjà à Richard Ford ou à Ernest Hemingway sont jeunes
mais ils donnent l’impression d’avoir déjà vécu. Mariages ratés,
dépendance à l’alcool, stérilité ou règlements de comptes, ils sont
nombreux tels Ann ou David à vouloir autre chose, à souhaiter une
autre vie. Mais ce rêve s’arrête bien souvent à l’entrée de cette
maudite mine qui avale les hommes, sorte d’abîme mental dont on
ne sort jamais. Car passé ce bref espoir, la mine se rappelle à eux.
Même lorsqu’on n’y travaille pas. Encore et encore. Car derrière ces
montagnes, ils sont persuadés qu’il n’y a rien pour eux.
Il va falloir un accident où périrent 91 mineurs pour que tout cela
vole en éclat, pour que cette prison mentale ne s’effondre. « Tout a
commencé à changer – son père ivre mort comme jamais David ne l’a vu –
mais après ce moment, rien ne sera plus jamais pareil. Il y aura un avant
et un après » écrit ainsi l’auteur. Avec ses phrases courtes,
tranchantes comme des lames de rasoirs, Kevin Canty nous dépeint
cette microsociété qui se fracture, se désagrège. On pourrait croire
à une caricature si on n’avait pas l’impression qu’elle nous ait
tellement familière d’avoir déjà vu telle bagarre pour un honneur
que l’on brandit quand on a plus rien ou tel ivrogne agressif parce
que sans perspectives. Dans cette déchéance collective où l’auteur
brosse quelques tableaux d’une incroyable beauté littéraire comme
ces scènes poignantes de l’incertitude qui précède l’annonce de la
mort des mineurs, il est aisé de conclure qu’il n’y a rien à faire, que la
fatalité a définitivement gagné.
Cependant, l’incroyable puissance du livre tient au message de
Canty. Il n’y a de salut que pour ceux qui traversent le purgatoire.
Qu’il faut endurer la perte, la douleur pour parvenir au bonheur et à
la liberté. David, Ann et Lyle l’apprendront à leurs dépens. Pour cela,
il leur faudra passer de l’autre côté des montagnes. Une vraie leçon
d’humanité.
Par Laurent Pfaadt
Kevin Canty,
De l’autre côté des montagnes,
chez Albin Michel, 272p.