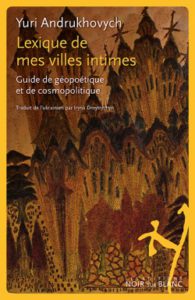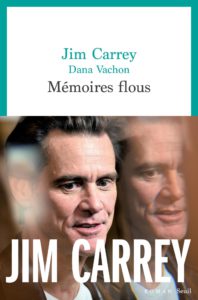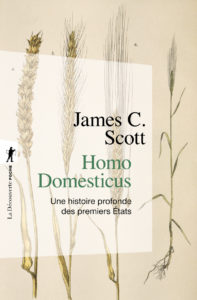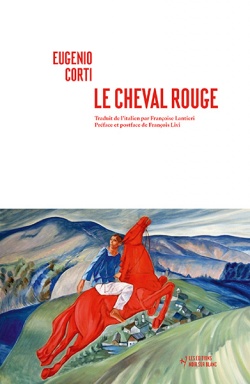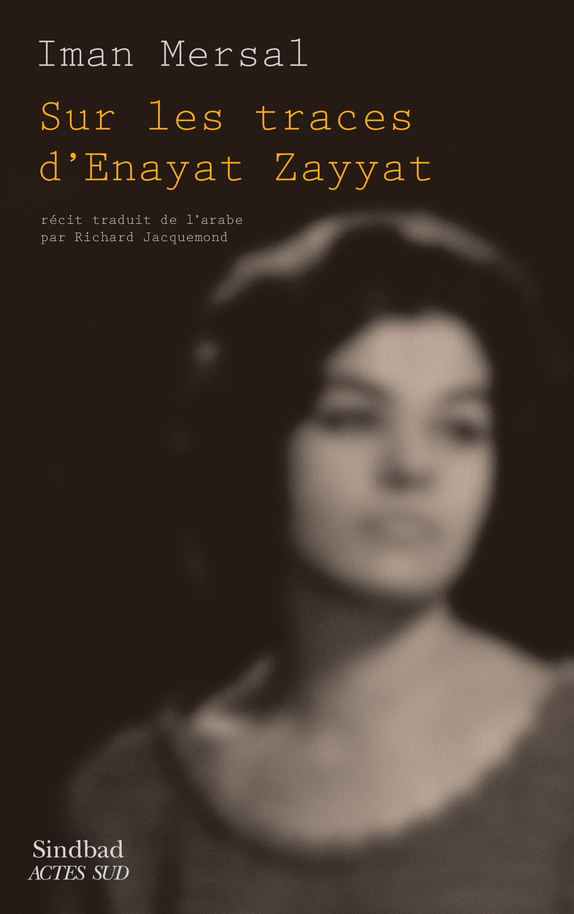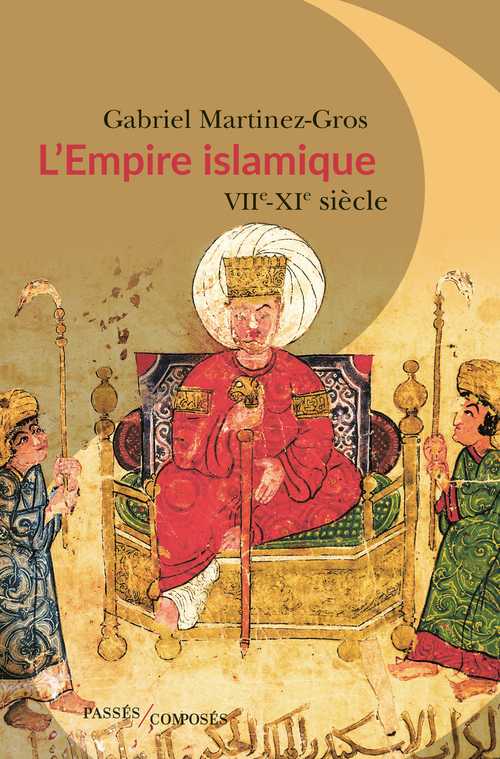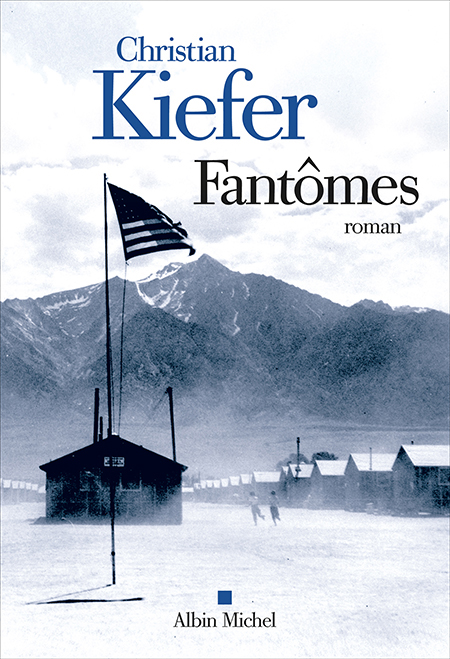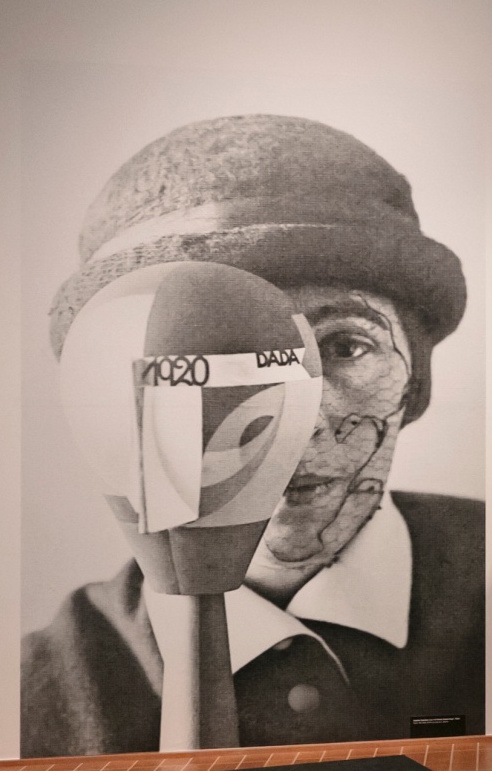copyright Michael Amrouche
« Regouper ces voix sera une force »
Les femmes écrivent le monde. Avec cette ambition, le décor de
Dalva, nouvelle maison d’édition, est posé. Fondée par l’ancienne
directrice éditoriale du domaine étranger chez Buchet-Chastel,
Juliette Ponce, Dalva souhaite devenir le creuset de ces nouvelles
plumes féminines qui racontent nos sociétés, notre monde.
Rencontre
Pourquoi ce nom de Dalva ?
Je crois que certains personnages de fiction peuvent laisser une
empreinte profonde chez leurs lecteurs, influer sur eux au moins
autant que des personnes réelles. C’est un peu pour moi le cas de
Dalva, l’héroïne du roman éponyme de Jim Harrison. J’ai lu ce roman
quand j’étais adolescente. L’image que j’ai gardée de ce personnage
ne s’est jamais effacée : une femme libre et émancipée, sensuelle,
profondément connectée à la nature qui l’entoure et animée d’une
quête intellectuelle et culturelle forte. Quand je me suis mise à
réfléchir à ce nouveau projet éditorial, quand mes envies ont
commencé à se mettre en place et que je cherchais un nom, Dalva
m’a semblé une évidence.
Pourquoi choisir de ne publier que des femmes ?
Quand, dans d’autres maisons, j’ai publié des voix de femmes très
fortes, comme les livres de Viv Albertine ou Miriam Toews, j’ai senti
qu’il y avait une véritable adéquation entre mon envie de lectrice et
d’éditrice de lire et de publier davantage de femmes et la réception
très enthousiaste que le public réservait à ces récits de destins
féminins. Pourtant, au sein d’une collection de littérature générale,
je sentais aussi que le propos de ces livres perdait de son intensité.
Je pense qu’il y a des lacunes dans l’édition française, où les autrices
restent très minoritaires. Je ne dis pas que les éditeurs ont des
réticences mais c’est un fait : nous publions davantage les hommes.
La littérature, dans ce qu’elle a d’universel, en pâtit forcément.
Parions que regrouper ces voix sera une force. Parce qu’il me semble
que ces autrices ont des démarches qui sont cohérentes. Que les
associer aurait un sens et permettrait d’invoquer la belle énergie qui
se dégage de leurs écrits.
Concrètement, que va-t-on lire chez Dalva ?
Je suis convaincue qu’en France on pourrait mettre en lumière ce
que les femmes ont à dire de manière plus joyeuse et positive. J’ai
envie de porter des voix d’autrices fortes, de valoriser leur art, leur
réussite. Celles que j’ai choisi de défendre ont en commun leur talent
littéraire autant que des personnalités fascinantes. Elles sont pour
moi des sources d’inspiration au quotidien. Peut-être par goût
personnel, j’aime les histoires d’émancipation, d’avancée. Il y a des
thématiques qui me passionnent comme les relations entre
générations, la question de la liberté et, évidemment, du prix à payer
pour cette liberté dans nos sociétés contemporaines. Je suis
également très intéressée par les femmes qui parlent de la nature,
disons par ce que l’on appelle le nature-writing au féminin. Si la
maison fait ses premiers pas avec exclusivement de la littérature
étrangère, j’espère bien ouvrir très vite le catalogue à la littérature
française. J’adorerais publier des autrices dans la lignée de Violaine
Huisman, Nastassja Martin ou Florence Aubenas…
Par Laurent Pfaadt
Premiers livres à paraître en mai 2021
avec L’Octopus et moi de la Tasmanienne Erin Hortle
et Trinity, Trinity, Trinityd’Erika Kobayashi.