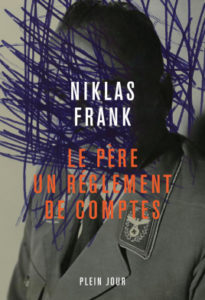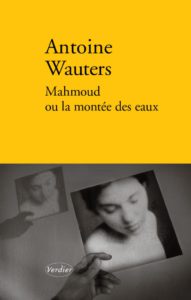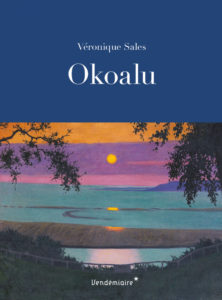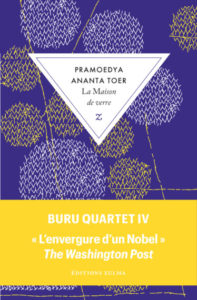Le compositeur français était à l’honneur du concert de l’orchestre philharmonique de Strasbourg

On aurait dit une réunion de famille. Car entre Berlioz, le chef
d’orchestre John Nelson et le ténor américain Michael Spyres, la
relation est tellement forte que l’on peut aisément parler de
communion. Ayant gravé ensemble plusieurs disques de référence
dont les Troyens et la Damnation de Faust chez Erato, John Nelson et
Michael Spyres ont ainsi retrouvé dans la capitale alsacienne leur
compositeur favori.
Avec l’ouverture de Béatrice et Bénédict, emprunte à la fois de
légèreté et de fougue, la chef a donné le ton. Le ténor américain
pouvait ainsi entrer en scène. Ses Nuits d’été aux accents tantôt
bucoliques, tantôt ténébreux et formidablement accompagnés par
des cordes très inspirées, ont tracé un sentier qui est passé par
champs et cimetières. Avec sa voix souvent qualifiée de baritenor,
Michael Spyres conduisit le spectateur dans une promenade au
milieu de paysages italiens tout droit sortis de Shakespeare.
Au détour de l’un d’entre eux, soufflait un vent, celui de l’alto de
Timothy Ridout. Avec un Harold en Italie de toute beauté, l’altiste
britannique de vingt-six ans dont le nom devrait très vite s’imposer
sur les grandes scènes européennes aux côtés des Zimmermann et des Tamestit, a d’emblée captivé son auditoire grâce à un toucher
unique mis au service de l’incroyable musicalité de son instrument.
John Nelson, amiral aux commandes d’un vaisseau philharmonique
qu’il connait bien pour l’avoir dirigé lors de batailles homériques ou
face au diable a, quant à lui, été, une fois de plus, impérial dans cette
œuvre majeure du répertoire pour alto.
Le public était-il préparé à cet Harold en Italie de grande classe ?
Probablement pas. Ceux qui avaient quitté la salle à l’entracte en
furent donc pour leurs frais. Le jeu proprement ensorcelant de
Ridout s’est fondu à merveille dans un orchestre qui lui offrit, en
retour, quelques dialogues de toute beauté notamment avec la
sublime harpe de Salomé Mokdad. Au milieu de ce paysage sonore,
l’alto a ainsi tracé une palette d’ombres et de lumières. Comme un
aigle aux ailes de feu surgissant du crépuscule et de l’arrière de la
salle comme il est de coutume dans cette oeuvre, Timothy Ridout a
transcendé Berlioz avant de délivrer un Hindemith de toute beauté,
pour le plus grand bonheur de spectateurs conquis.
Par Laurent Pfaadt
A écouter :
Michael Spyres, Baritenor, Orchestre philharmonique de Strasbourg, dir. Marko Letonja, Erato
Chez Warner Classics
Timothy Ridout, Britten, Vaughan Williams, Martinu, Hindemith, Orchestre de chambre de Lausanne, dir. James Philipps
Chez Claves records