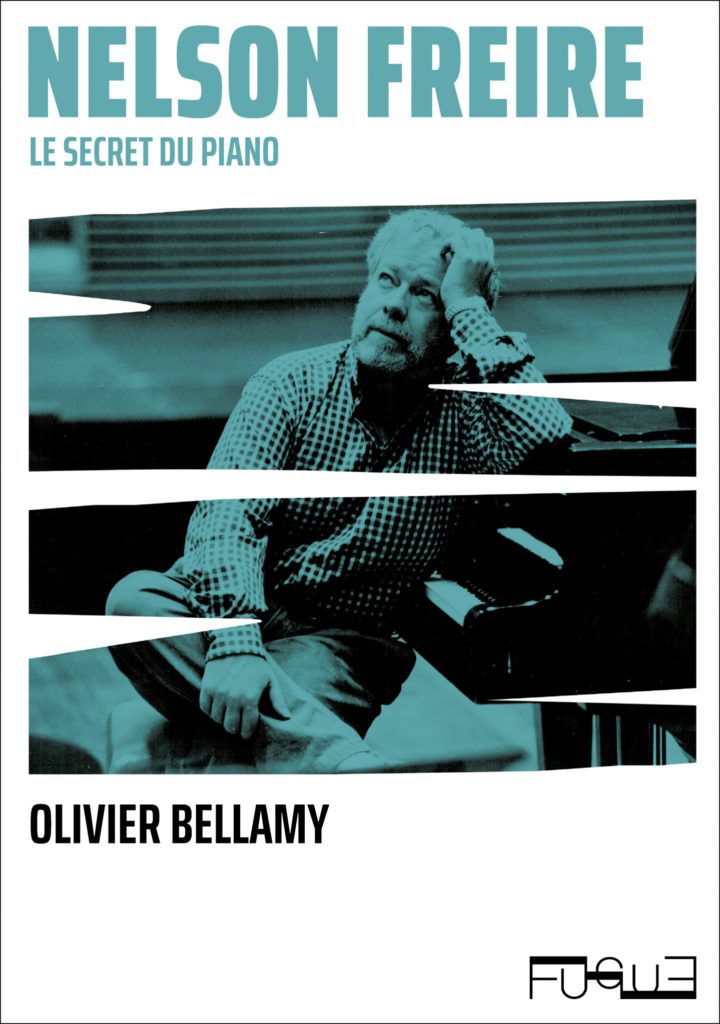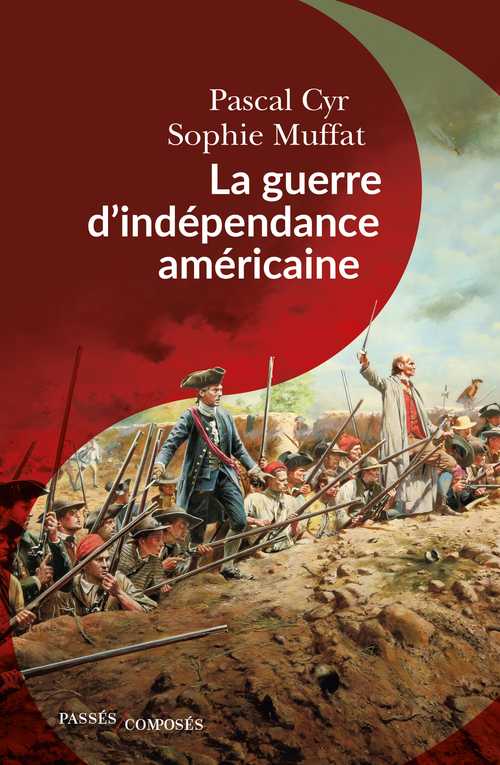Dernière-née de l’édition, les éditions Fugue, fondées par trois éditrices du groupe Libella – Sophie Bogaert, Gaëlle Belot et Eva Dolowski – souhaitent promouvoir des voix nouvelles de la littérature française, des livres de référence pour les amateurs de musique ainsi que des portraits de grands artistes des scènes d’aujourd’hui. Pour inaugurer l’aventure de Fugues, elles ont choisi le merveilleux pianiste brésilien, Nelson Freire, par l’un des plus grands connaisseurs de l’instrument roi, Olivier Bellamy, ancien journaliste de Radio classique dans ce portrait à la fois sensible et fascinant.
Novembre 2017. L’auteur de ces lignes assiste à la répétition du 20e concerto de Mozart à Montpellier. Il a pour l’occasion emmener des lycéens pour leur permettre d’observer ce pianiste de légende. En interprétant le génie autrichien, Nelson Freire se souvient-il de ce Jeunehomme, ce neuvième concerto de Mozart qu’il joua à 12 ans en compagnie de l’orchestre symphonique du Brésil et qui signa le début de son incroyable destin ? Repense-t-il à ces rues, à ce Ring d’une Vienne maintes fois arpentées après les classes de Bruno Seidlhofer ? Ou en compagnie de l’autre légende du livre, Martha Argerich, son âme-soeur ? Peut-être.
Martha Argerich – Nelson Freire. L’une des plus belles histoires d’amitié que la musique ait connue. Une histoire digne d’un film. Ils sont si différents et pourtant si complémentaires. Elle est le feu. Lui l’eau. Elle ne jure que par Ravel quand lui préfère Debussy. Olivier Bellamy nous conte à merveille cette relation qui naquit dans la capitale autrichienne et se poursuivit jusqu’à la mort de Freire. Biographe et proche de la pianiste argentine, Olivier Bellamy nous fait pénétrer dans l’intimité de leur relation, « il sent tout d’elle, elle sent tout de lui » écrit-il sans jamais verser dans le voyeurisme. On y découvre cette relation musicale et humaine si spéciale qui les lia. Grâce à sa parfaite connaissance de l’univers du piano et de la musique classique, l’auteur parsème son récit de détails qui humanisent ces êtres parfois perçus comme hermétiques au monde tout en rendant son sujet fascinant. Il est là avec Nelson Freire, en Europe, au Brésil, en Australie dans ces innombrables concerts où il transcenda Brahms, Chopin ou Debussy dont il eut une affectation particulière. Mais également avec ses Miguel et Bosco, ses grands amours.
Suivre la destinée de Nelson Freire, c’est aussi parcourir l’histoire de la musique et du piano durant cette deuxième partie du vingtième siècle et le début du vingt-et-unième. On y croise les figures de légende, de Sviatoslav Richter qu’il croisa à la Roque d’Anthéron dont il devint à partir de 1986 un habitué à Vladimir Horowitz qu’il admira avec Argerich au Carnegie Hall à l’occasion du jubilé du pianiste ukrainien en 1978 en passant par Michelangeli et cette incroyable rencontre avec le pianiste italien et le roi de la bossa nova, Tom Jobim ou son amie de toujours, Cesarina Riso ou Cristian Budu qu’il soutint.
Une mauvaise chute en 2019 va sceller son destin. Le cristal s’est brisé en mille morceaux. L’éclat n’est plus aussi brillant et il le sait. Cet hypersensible sombre alors dans la dépression. Et Olivier Bellamy accompagne dans ces dernières pages, un pianiste jouant cette marche funèbre, non pas ce troisième mouvement de la deuxième sonate de ce Chopin qu’il affectionnait tant mais celle de sa propre vie. Seule la perspective d’aller se reposer à Petrópolis semble encore le réconforter. Petrópolis, la ville où Zweig s’est suicidé, déçu d’un monde qui a sombré dans la folie. Petrópolis, la ville où l’écrivain viennois est définitivement entré dans la légende. Suicide ou chute, le 31 octobre 2021, Freire a rejoint Zweig, inscrivant ses pas dans ce Ring de légende qu’ils ont tous deux arpenté.
Le livre d’Olivier Bellamy refermé, il a fallu réécouter Chopin.
Par Laurent Pfaadt
Olivier Bellamy, Nelson Freire, le secret du piano,
Aux éditions Fugue, 224 p.