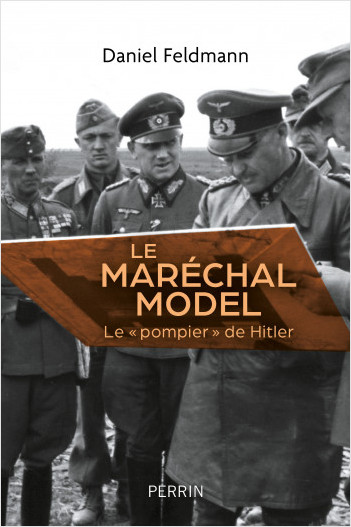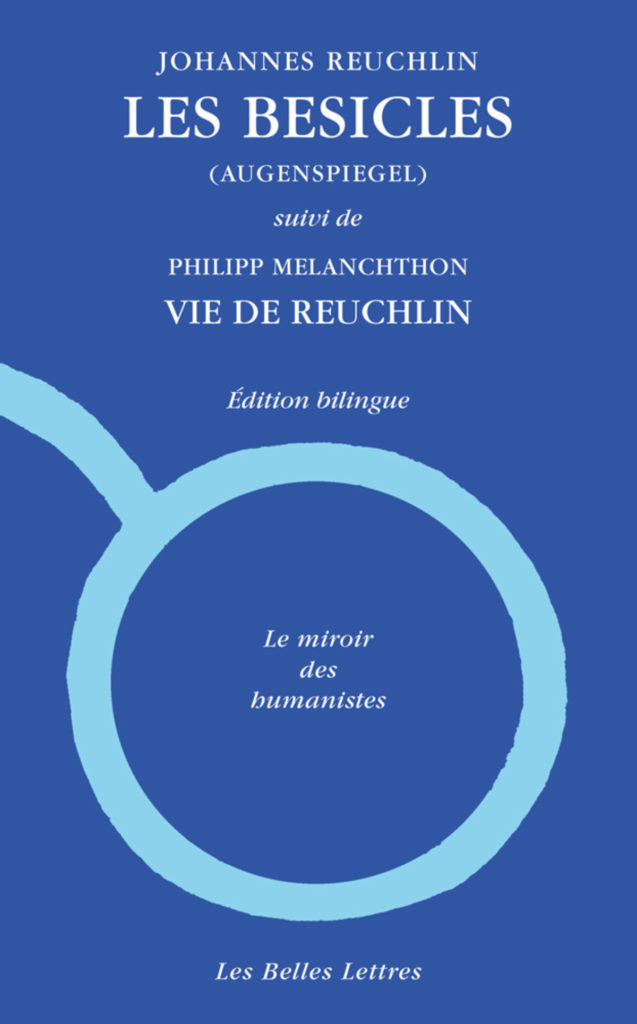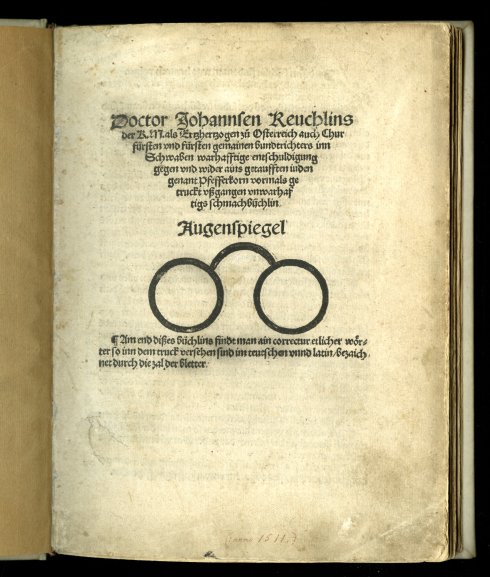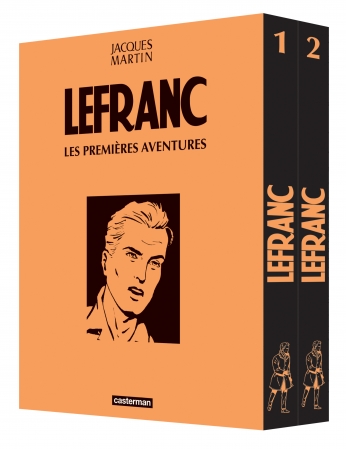Anne Monfort met en scène une pièce de l’autrice allemande Anja Hilling née en 1975, pièce écrite en 2008, traduite par Silvia Berutti-Ronelt et Jean-Claude Berutti.
Un spectacle dérangeant dont le genre nous échappe quelque peu car peut-être nous attendions -nous à une pièce de science-fiction et qu’en fait, même si en prélude des éléments s’y référant sont bel et bien posés, c’est de relationnel dont il sera essentiellement question.
Nous sommes donc en 2175 et depuis plusieurs années la température a atteint 60 degrés et la vie sur la terre est devenue presque impossible. Le soleil n’apparaît plus, les rivières ne coulent plus et les humains qui, malgré tout se sont adaptés, ne peuvent sortir sans protection sinon leur peau est brûlée et ils meurent. C’est dans ce contexte apocalyptique qu’évoluent les protagonistes, disons les rescapés de cette situation dramatique. Ils sont trois une femme, Pagona et deux hommes, Taschko et Posch , peut-être faudrait-il dire quatre puisqu’il y a « Bébé », une fille, encore dans le ventre de Pagona, sa mère mais qui va tenir une grande place dans cette histoire. Car c’est autour d’elle que tout s’organise.
En effet, Pagona parle à cette enfant conçue par voies naturelles alors que cela n’est quasiment plus possible et que les statistiques exposent quelques rares cas qui se sont terminés par la mort des femmes. Pagona, elle, se découvrant enceinte, a décidé de garder l’enfant sachant les risques auxquels elle s’exposait. C’est à Taschko, cet artiste peintre dont elle est amoureuse, qu’elle désire confier l’enfant pour qu’il l’élève.
C’est à elle qu’elle révèle ses rencontres avec Taschko et Posh, le riche patron d’une entreprise qui récupère la peau des morts servant fabriquer des isolants pour les murs des maisons ce qui permet d’y vivre sans ces habits protecteurs indispensables à l’extérieur.
La pièce oscille entre le soliloque de Pagona qui s’adresse simultanément à l’enfant à naître et au public et des scènes reproduisant les rencontres entre les trois protagonistes.
C’est ainsi que l’on pourra suivre ce moment presque romanesque au cours duquel Pagona, serveuse dans un bar, se retrouve avec Taschko, le peintre dermaplaste, chargé de la décoration du lieu qui doit peindre une fresque reproduisant, comme il le fait habituellement, des scènes du temps passé celui où la nature existait, où le ciel était bleu et dont il a connaissance par les cassettes VHS récupérées par son patron Posh. Amoureuse de Taschko, elle voudrait l’embrasser mais il ne peut y consentir car, lors du viol qu’il a subi sa peau a été brûlée et on ne peut plus le toucher ce qui rend leur relation difficile. Néanmoins leur sentiment amoureux reste vif et s’affirme lors de leur rencontre au point que c’est à lui qu’elle veut confier l’enfant conçu avec un autre, en l’occurrence, Posh au cours d’une scène ambigüe, presque scène de viol plus ou moins consenti.
.
La dimension politique apparaît nettement ici et domine le côté science-fiction du scénario.
Pour suggérer cet univers dystopique un décor relativement sobre avec des éléments sans vraiment de liens entre eux, un sol brillant, une cabane colorée, des arbres squelettiques suspendus, une barque sur l’eau et un écran pour quelques projections dont celle de la femme -moustique aux ailes déployées sur fond de ciel très bleu, illustrant la nostalgie de l’ancien temps (scénographie et costumes Clémence Kazémi, lumières Cécile Robin)
La musique a la part belle, écrite spécialement pour soutenir ces propos et ces situations par Nùria Giménez-Cosma avec l’appui de l’IRCAM avec les nuances et les trouvailles que cela impose.
Dans cet univers étrange dont les propos nous interpellent rejoignant nos préoccupations sur l’avenir de la planète et de l’humanité les comédiens se prêtent au jeu avec une belle conviction.
Judith Henry campe une Pagona sensible parfois incertaine, malgré tout déterminée face au destin qu’elle a choisi et qui la voue à la mort ce dont elle se préoccupe moins que de l’amour qu’elle voue à son enfant et à Taschko .
Jean- Baptiste Verquin réussit un Posh, pas très sympathique, un patron, un capitaliste sans scrupule
Mohand Azzoug donne à Taschko sa fébrilité d’homme blessé, impuissant, dépendant mais amoureux lui aussi.
En fin de compte, la survie de l’humanité ne va-t-elle pas dépendre essentiellement de sa capacité à aimer envers et contre tout, peut-être est- ce cela que nous dit la pièce d’Anja Hilling ?
Marie-Françoise Grislin
Représentation du 7 décembre au TNS