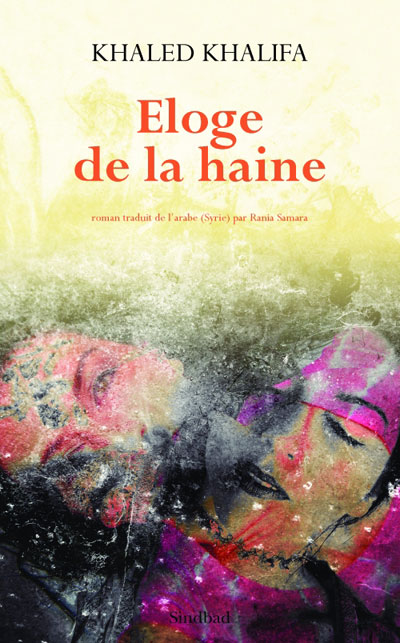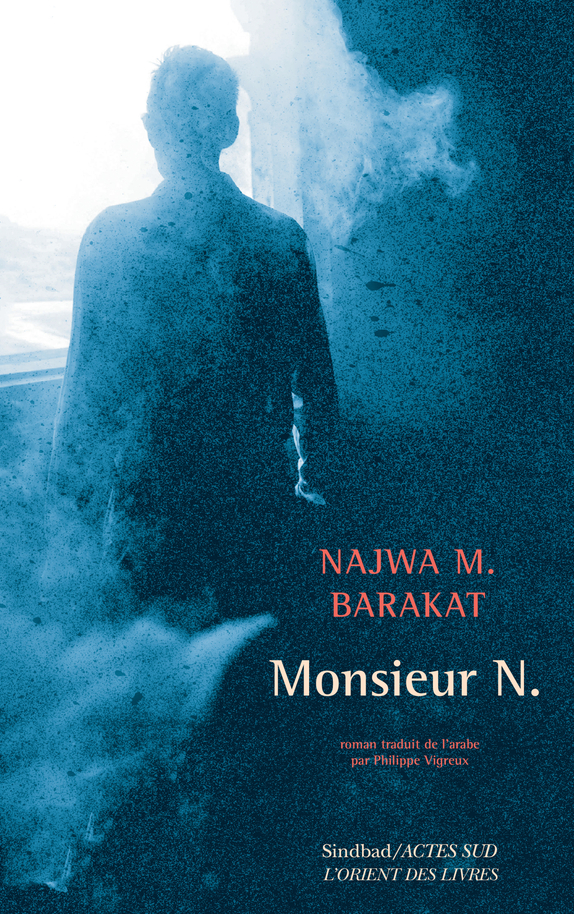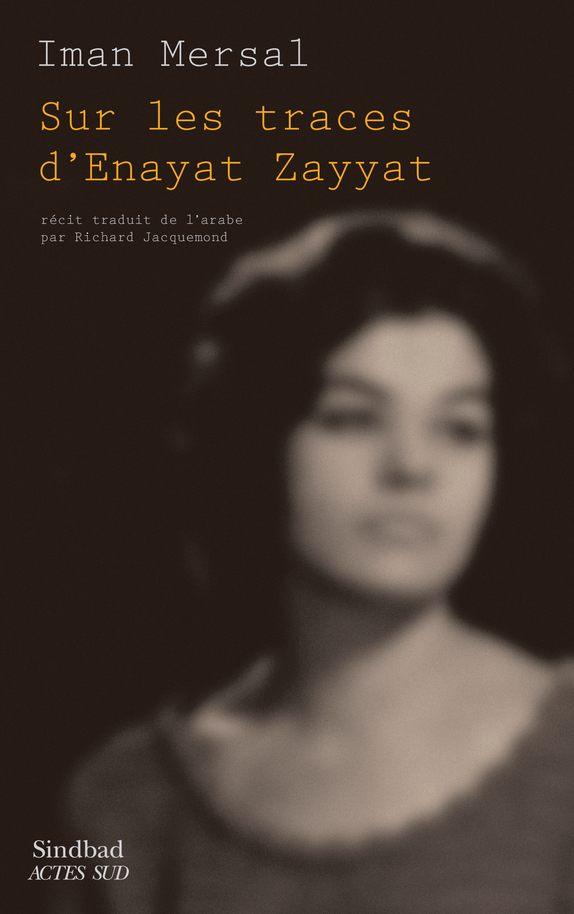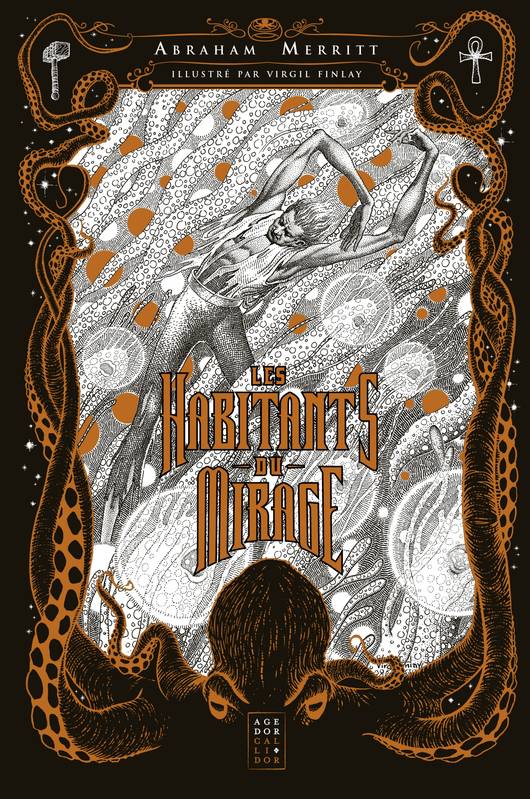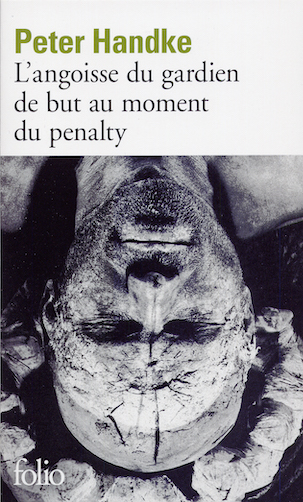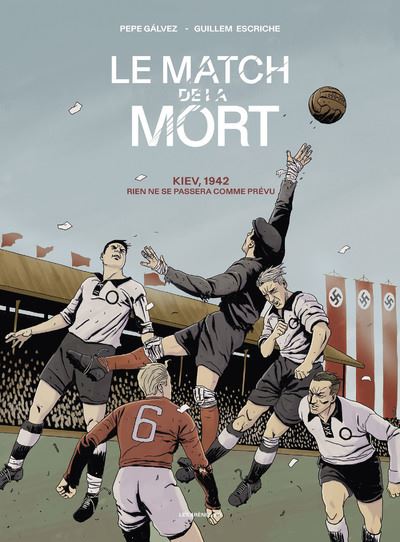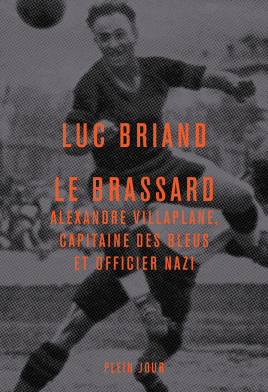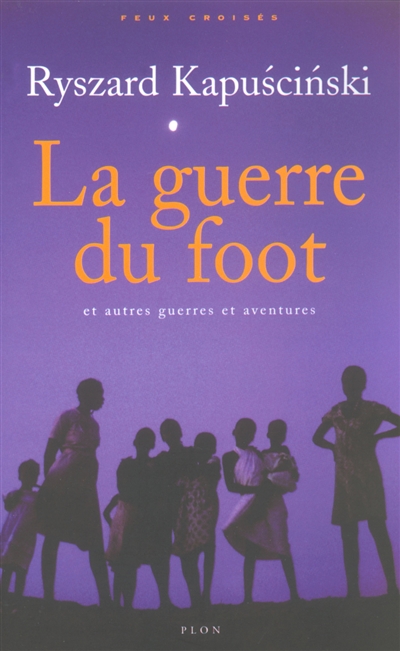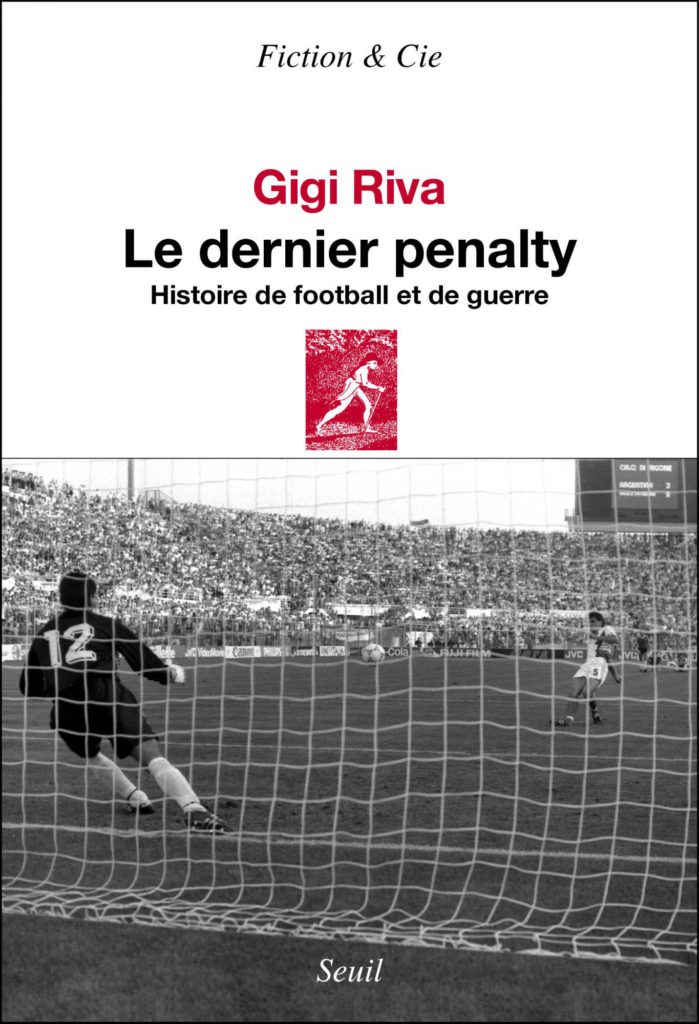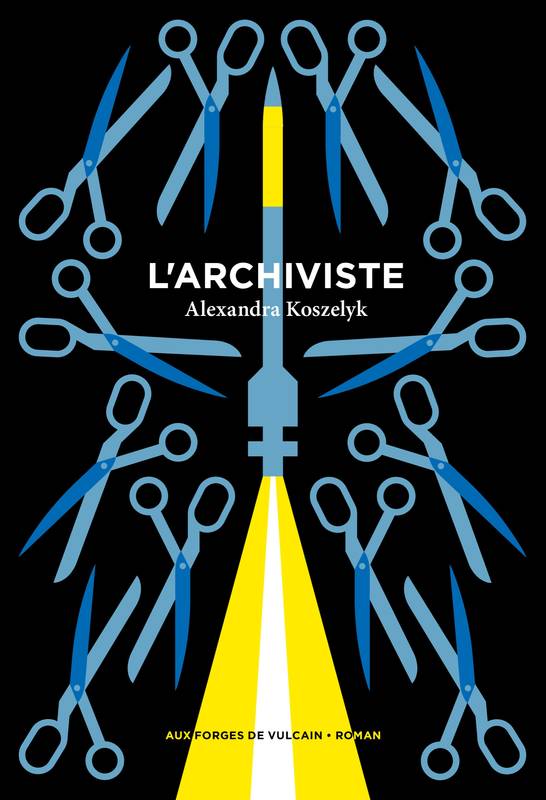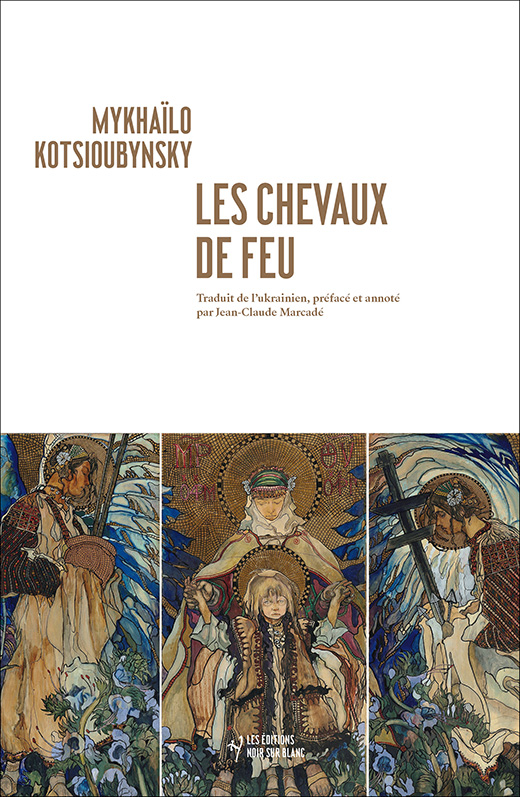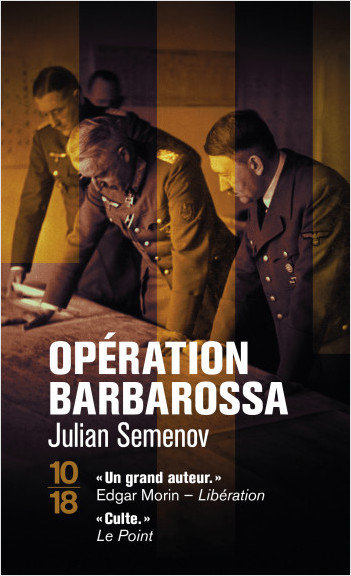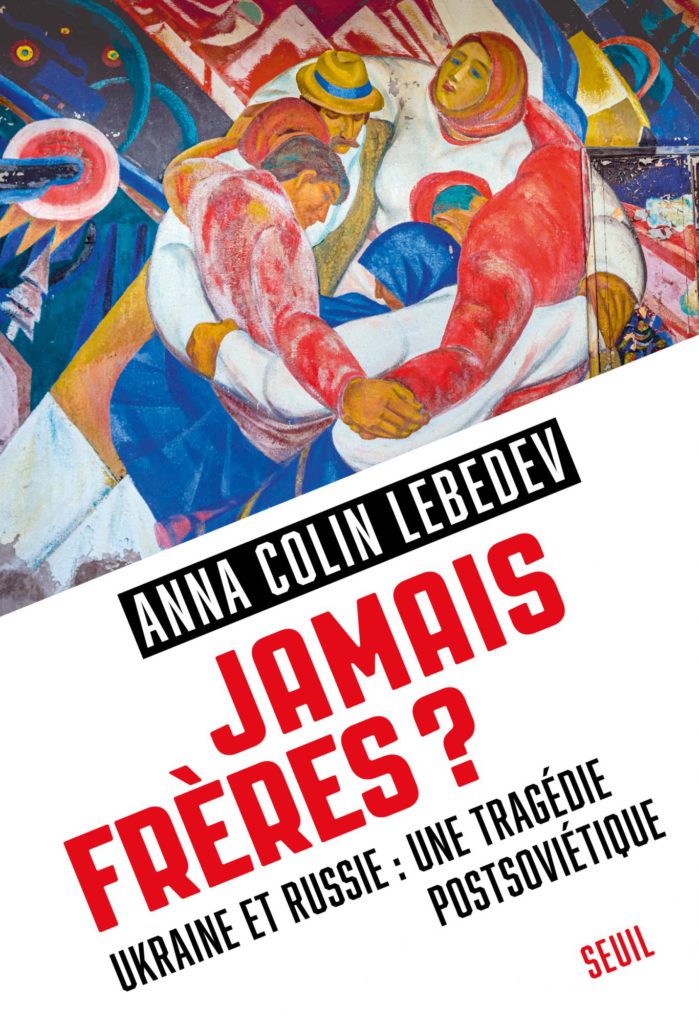Depuis qu’Alain Lombard l’introduisit à Strasbourg dans les années 1970, la musique de Gustav Mahler a connu nombre de belles interprétations grâce notamment à Jan Latham-Koenig, Marc Albrecht et Marko Letonja. Le concert de l’OPS donné le 25 novembre dernier était entièrement consacré à la neuvième symphonie. Invité pour l’évènement, le chef russe Vassili Sinaïski en a donné une vision d’une intelligence musicale exceptionnelle, soutenue par un orchestre chauffé à blanc.

Une telle performance mérite d’autant plus d’être saluée que ce chef d’œuvre du romantisme tardif, bien qu’ayant fait l’objet d’une centaine d’enregistrement, pose des problèmes d’interprétation qui sont loin d’être toujours résolus. A côté de chefs ne retenant que la seule dimension romantique, il y a ceux qui, à l’inverse, l’enferment dans un modernisme monolithique. Il en est aussi qui restituent bien l’ambiance ironique et sarcastique des deux mouvements centraux mais qui achoppent devant le dramatisme austère des mouvements extrêmes ; et d’autres chez qui c’est le contraire. Il y a enfin ceux qui, restituant bien le caractère transitoire et ambivalent de l’œuvre, font cependant preuve de timidité face à une matière sonore dont la sauvagerie tourne le dos aux nuances maniérées, aux phrasés édulcorés, aux pianissimi exagérés. Toutes ces insuffisances ou ces impasses furent magistralement surmontées lors du concert de Vassili Sinaïski, atteignant un niveau d’excellence tel que l’on regrette qu’aucune radio, télévision ou maison de disques n’aient, ce soir-là, posé ses micros dans la salle Érasme. Quand pareille intelligence de l’œuvre le dispute à la passion de l’exécution, il émane de cette musique un amour éperdu de la terre et un adieu au monde d’une puissance émotive bouleversante. Avec des mouvements précis, des gestes attentionnés et des expressions de visage d’une grande humanité, ce chef a obtenu de l’OPS ce qu’il faut bien appeler une véritable performance sonore. À preuve, le terrifiant scherzo, d’une difficulté telle qu’il est arrivé à un orchestre comme le Philharmonique de Berlin d’y commettre de fautives embardées (sous la direction de Léonard Bernstein, en 1979). Sinaïski l’attaque, quant à lui, dans une rythmique implacable et dans un tempo foudroyant ; cordes de l’orchestre unies derrière la super-soliste Charlotte Juillard, vents et percussions enflammés se surpassent jusque dans une coda des plus impressionnantes. Pour le reste, on ne peut qu’approuver la justesse de style, tant au plan des timbres particulièrement vibrants que des rythmes ou des mélodies, qui jouent la puissance du sentiment contre le sentimentalisme niais et font entendre tout ce que cette musique recèle d’extrêmement savant mais aussi de profondément populaire.
Une semaine avant, l’orchestre accueillait le violoniste arménien Sergey Khachatryan dans le concerto pour violon de Beethoven. Il y a un peu plus de vingt ans, encore dans son adolescence, il était venu jouer cette même grande œuvre. Nonobstant sa jeunesse et son trac d’alors, on avait déjà perçu sa musicalité souveraine et son lyrisme profond. Quelques années plus tard, il donnait en concert et enregistrait à Paris, avec son mentor Kurt Masur, une mémorable version des deux concertos de Shostakovitch. Non seulement il n’a rien perdu de ses qualités d’antan, mais il a gagné une liberté de jeu qui a rayonné du début à la fin du chef d’œuvre beethovenien, culminant dans un rondo final particulièrement alerte et chantant. C’est un autre chef russe, venant quant à lui de la grande école pétersbourgeoise, Stanislas Kochanovsky, qui dirigeait ce soir-là l’orchestre. Certains mélomanes se sont demandés si la nervosité des forte staccato, l’orchestre à cordes resserré et son jeu sans vibrato, les vents particulièrement audibles et les timbales très claires, autrement dit l’option d’un style ‘’historiquement informé’’ s’accordaient avec le lyrisme profond et la sonorité délicate de Kachatryan. C’est oublier, à mon sens, la restitution particulièrement chantante des longues phrases mélodiques, si bien jouées par le quatuor à cordes de l’orchestre, décidément très en forme.
En seconde partie de soirée, Stanislas Kochanovsky nous aura offert une troisième symphonie de Brahms de grande classe, bien contrastée entre la froide énergie des mouvements extrêmes et les moments mélancoliques et nostalgiques des parties centrales. On eût certes aimé un surcroît de sentiment dans le célèbre allegretto ; en revanche, on a particulièrement apprécié la droiture des instruments à vents dans les dernières mesures de l’œuvre, quand la musique semble enfin atteindre une réelle sérénité. D’un bout à l’autre de cette belle et étrange symphonie, le jeu de l’OPS s’est montré d’une clarté et d’une homogénéité parfaites.
Je profite de cette recension pour dire également tout le bien que je pense de deux concerts de musiciens amateurs, entendus durant le mois de novembre. Le samedi 12, l’Orchestre des Solistes de Strasbourg, formé d’étudiants de l’Académie Supérieure de Musique, donnait son premier concert sous la direction d’Etienne Bideau, violoniste par ailleurs. Après un larghetto pour cor de Chabrier et un concerto pour clarinette et alto de Bruch, témoignant de la qualité des solistes de cette nouvelle formation, l’orchestre et son jeune chef nous ont offert une symphonie écossaise de Mendelssohn d’une juvénilité d’inspiration et surtout d’une qualité d’exécution que l’on n’attendait pas d’une formation débutante. On aura seulement regretté l’acoustique quelque peu tourbillonnante de l’église Saint-Pierre le jeune.
Gaspard Gaget a, quant à lui, bénéficié de l’acoustique nouvellement rénovée du Palais des Fêtes pour le 150ème anniversaire de la Chorale Strasbourgeoise, institution historique qu’il dirige et qu’il dynamise depuis maintenant trois ans. Pour cette soirée du samedi 26 novembre, le Chœur d’hommes de Molsheim était convié pour des chants de son répertoire, également le Centre Chorégraphique de Strasbourg pour une chorégraphie sur une musique de Mozart. La partie instrumentale de la soirée était assurée par des instrumentistes de La Philharmonie, orchestre d’amateurs fondé en 1900. Après une petite symphonie d’un quasi-contemporain de Beethoven, G. Valéri, dirigé par le chef Gustave Winckler, musiciens et choristes strasbourgeois se sont retrouvés sous la direction de Gaspard Gaget pour un Magnificat de Vivaldi et une Spatzenmesse de Mozart qui, l’un comme l’autre, ont montré le niveau artistique que peut atteindre un ensemble de choristes amateurs lorsqu’ils sont guidés à la fois par l’exigence et l’enthousiasme. Qualités que l’on aura encore appréciées dans le chœur final de l’Oratorio de Noel de J.S.Bach, qui terminait ce programme ambitieux et fort bien conçu.
Michel Le Gris