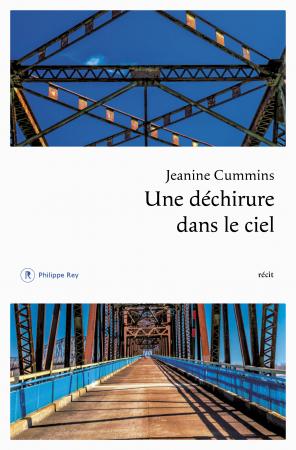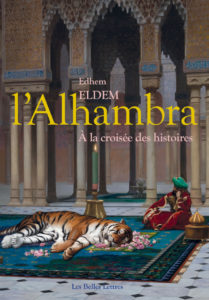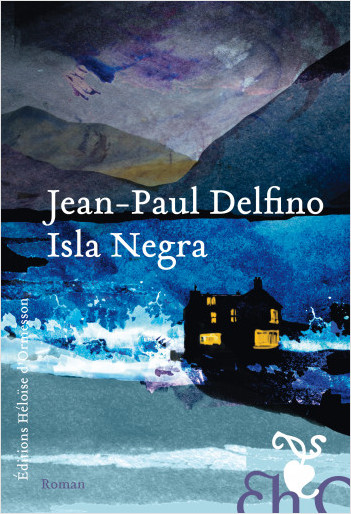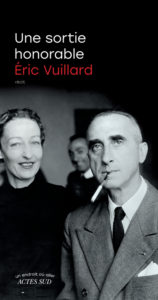Plus de 50 jours après le début de la guerre, nous poursuivons notre série visant à promouvoir des ouvrages traitant de l’Ukraine ainsi que des auteurs ukrainiens afin de sensibiliser l’opinion et d’éclairer les lecteurs sur ces enjeux qui traversent le pays alors que pleuvent sur Kiev, Kharkiv, Marioupol ou Mykolaïv, les bombes russes. Rétablir la vérité historique, redire l’attachement de l’Ukraine à l’Europe, et promouvoir les lettres et la culture ukrainiennes à travers leurs écrivains, leurs artistes, tels sont les enjeux de cette bibliothèque ukrainienne.
L’autre enjeu, affirmé d’emblée
dans le premier épisode de notre série, est de mobiliser un maximum de lecteurs
et d’acteurs sur les dangers que courent les bibliothèques du pays, toutes les
bibliothèques, qu’elles soient historiques ou non. Alerter sur la disparition
d’un savoir national et sur la fin de l’accès aux livres, à la lecture mais
également à la mémoire pour toute une population, tel est également l’autre
enjeu de cette chronique. Continuons donc à nous mobiliser pour sauver les bibliothèques
ukrainiennes avec #Saveukrainianlibrary. Ainsi, dans cet épisode, vous
trouverez les photos de la destruction de la bibliothèque de Tchernihiv, près
de la frontière avec le Belarus.
Ceci étant dit, promenons-nous
dans cette nouvelle bibliothèque ukrainienne
Pierre Lorrain, L’Ukraine, une
histoire entre deux destins, Bartillat, 670 p.
Comprendre l’Ukraine, sa résistance,
son désir d’indépendance, sa vocation européenne, c’est d’abord comprendre son
histoire. Grâce au livre de Pierre Lorrain, spécialiste reconnu de la Russie,
cet ouvrage permet assurément d’y voir plus clair.
Complété par les premières années
de la présidence Zelensky, l’ouvrage de Pierre Lorrain entre ainsi dans la
complexité de ce pays, entre Europe et Russie, entre aspirations européennes et
berceau de l’histoire russe. Couvrant ainsi plus de mille ans d’histoire, le
livre de Pierre Lorrain témoigne d’une exceptionnelle objectivité qui permet de
cerner les grands enjeux et les forces à l’œuvre dans ce conflit. Assurément
une lecture salutaire en ces temps de guerre.
Jean Lopez, Kharkov 1942,
Perrin, 316 p.
L’histoire de l’Ukraine contemporaine
s’est édifiée dans le sang. Et Kharkov devenue aujourd’hui Kharkiiv, a
malheureusement renoué avec son tragique passé. Haut-lieu de la guerre à l’Est
entre Wehrmacht et Armée rouge, elle a été le théâtre de trois batailles
sanglantes. Après avoir pris la ville en septembre 1941, les Allemands affrontèrent
ainsi au printemps 1942, des Soviétiques bien décidés à infléchir le cours de
la guerre après avoir stoppé la Wehrmacht devant Moscou, quelques mois plus
tôt. Premier opus de la nouvelle collection Champ Bataille des éditions Perrin,
ce récit haletant de la bataille par un Jean Lopez toujours aussi passionnant,
nous fait entrer dans ce combat titanesque. Agrémenté de cartes et de
témoignages de premier plan, le lecteur suit au jour le jour, dans les
états-majors et sur le front, le récit de cette bataille majeure.
Niels Ackermann &
Sébastien Gobert, New York, Ukraine, guide d’une ville inattendue, éditions
Noir sur Blanc, 204 p.
Et si on vous disait que les Etats-Unis sont déjà présents en Ukraine, est-ce que vous nous croirez ? C’est pourtant bien le cas comme le rappelle le très beau livre de Niels Ackermann et Sébastien Gobert sur la ville de New York en Ukraine dont voici notre chronique :http://www.hebdoscope.fr/wp/blog/new-york-ukraine-guide-dune-ville-inattendue/
Maria Galina, Autochtones,
traduit du russe par Raphaëlle Prache, Agullo éditions, 2020
Ecrivain de science-fiction,
Maria Galina nous emmène avec ce récit inquiétant dans une ex-république
soviétique que l’on identifie très vite à l’ouest de l’Ukraine, à la recherche
d’un obscur groupe d’artistes des années 20 qui aurait créé un opéra mythique
« La mort de Pétrone » ne donnant lieu qu’à une seule représentation.
Un enquêteur bien décidé à retrouver la trace de ces hommes et ces femmes
commence alors à recueillir des témoignages et s’enfonce dans un abîme aux
frontières du réel. Et très vite, il est confronté à d’étranges phénomènes.
D’autant plus que les autochtones,
dont on ne sait s’ils sont humains ou non, semblent fortement intéressés par
son enquête. D’indices en contre-vérités, le lecteur, ensorcelé par le subtil talent
de conteuse de Maria Galina, avance alors dans un labyrinthe fait de détours historiques
et policiers. Entre loups-garous et le Maître et Marguerite de
Boulgakov, enfoncez-vous dans le blizzard littéraire fascinant de Maria Galina.
Sans certitude de retour…
Interview de Maria Galina (entretien réalisé le 1er
avril)
Comment allez-vous aujourd’hui ? Pouvez-vous nous décrire
la situation à Odessa ?
Plus d’un mois s’est écoulé
depuis le début de la guerre et, dans une certaine mesure, une routine s’est
installée avec les bombardements et les sirènes annonçant les raids aériens.
Odessa reste relativement calme par rapport à ce qui se passe dans l’est de
l’Ukraine et dans certaines petites villes non loin de Kiev. Il y a une
certaine activité marchande à Odessa – même les animaleries sont ouvertes – et
il n’y a pas de pénurie alimentaire jusqu’à présent. Même le célèbre marché
alimentaire Privoz est actif. Bien sûr, il y a des restrictions militaires,
telles que des couvre-feux et des postes de blocage, des barricades et des
contrôles…
Vous aviez prévu de venir au Festival Intergalactiques à
Lyon fin avril. Est-ce toujours le cas ?
Non. Aujourd’hui, il est très
difficile de quitter l’Ukraine. Tous les vols ont été bien évidemment reportés.
De toute façon, je ne quitterai l’Ukraine qu’en dernier recours, s’il n’y a pas
d’autre issue. J’aime la France. Elle est, à bien des égards, similaire à
l’Ukraine – multiculturelle et diversifiée – mais en même temps d’un seul
tenant, avec une histoire ancienne, complexe et unique.
Avez-vous des contacts avec des auteurs russes ?
Comment vivent-ils la situation ?
Beaucoup de mes amis et collègues
ont quitté à la hâte la Russie afin d’éviter d’être complices de ce crime.
Beaucoup d’autres sont restés et vivent aujourd’hui sous la menace de
poursuites s’ils protestent ouvertement contre la guerre. Mais de nombreux
écrivains de science-fiction soutiennent également activement cette agression,
et il m’est très difficile de comprendre quel mécanisme psychologique les
habite. C’est un phénomène assez étrange, car en théorie, ceux qui imaginent le
futur devraient s’appuyer sur des idéaux humanistes. Ils ont été fortement
influencés par la propagande et sont eux-mêmes devenus les instruments de cette
dernière. Je suis fier de ces membres de Russian Fandom qui sont restés quant à
eux, inébranlables. Mais il y en a très peu hélas.
Pensez-vous que cette guerre
va entraîner le développement de la littérature et de la langue ukrainienne ?
Les guerres et les cataclysmes
sociaux en général, aussi cynique que cela puisse paraître, servent
généralement de puissants stimulants créatifs. L’Ukraine, au cours des vingt
dernières années, a fortement développé sa propre littérature y compris de
science-fiction. Aujourd’hui, elle essaie de rompre avec l’héritage impérial,
ce qui aurait pour conséquence de favoriser des découvertes créatives très
intéressantes et inattendues. En règle générale, en tant de crise, la réponse
littéraire la plus immédiate est celle de la poésie et de l’essai. Après
seulement vient la prose et la fiction. L’Ukraine a aujourd’hui besoin de
forger son propre mythe culturel sans lequel aucun pays ne peut exister. Et
maintenant que ce mythe est créé – dans lequel les écrivains de science-fiction
ukrainiens ont d’ailleurs leur propre rôle à jouer – tout est réuni pour
construire un nouveau récit national.
Quant à la langue, le russe était
très répandu ici avant la guerre même s’il régresse aujourd’hui. Tous les
Ukrainiens sont bilingues et jusqu’à présent la langue que vous parliez n’avait
pas d’importance. Certaines personnes ne réalisaient même pas quelle langue ils
utilisaient pour communiquer ou pour écouter les informations. Les choses ont changé
aujourd’hui.
Comment pouvons-nousaider les auteurs ukrainiens ?
Tout d’abord, il est important de réaliser que l’Ukraine se bat non seulement pour son indépendance mais également pour sa propre survie. Deuxièmement, il faut savoir que la Russie utilise tous les agents de propagande y compris les auteurs russes pour s’imposer. Il faut proposer aux auteurs ukrainiens toutes les plates-formes culturelles disponibles afin qu’ils puissent s’exprimer. Car jusqu’à présent, la culture ukrainienne est restée, pour ainsi dire, dans l’ombre. Mais c’est une culture européenne vibrante et vivante. Et j’aimerais que cette culture soit reconnue à sa juste valeur dans le monde entier.
Par Laurent Pfaadt