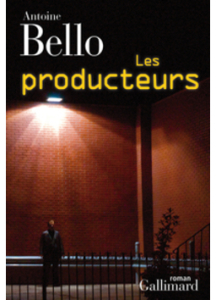Deuxième opus du subtil changement de Jo Walton
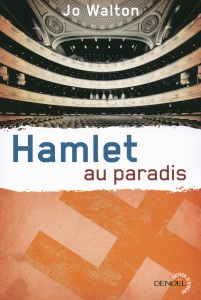
On avait laissé notre brave inspecteur Carmichael au prise avec le meurtre de Peter Farthing, artisan du rapprochement de l’Angleterre avec le IIIe Reich.
On le retrouve quinze jours plus tard avec une nouvelle affaire peu commune. Une compagnie de théâtre s’apprête à donner Hamlet de Shakespeare lorsqu’une actrice meurt dans l’explosion de sa maison. Avec sa perspicacité légendaire Carmichael se doute vite que la bombe qui a soufflé la maison n’a rien d’un accident. Et, en tirant les fils de cet écheveau, l’inspecteur de Scotland Yard
plonge une nouvelle fois dans les tréfonds d’une machination qui va le mener jusqu’au plus haut sommet de l’état et ne va pas le laisser indemne car Adolf Hitler et le Premier Ministre britannique doivent assister à la représentation du chef d’œuvre de Shakespeare.
Jo Walton, auteure récompensée à maintes reprises, poursuit dans ce deuxième opus du subtil changement son incroyable travail de réécriture de l’histoire britannique durant la seconde guerre mondiale. L’uchronie qu’elle nous dépeint est, à la manière d’une Connie Willis, une histoire alternative tout à fait plausible et qui interpelle le lecteur lorsque l’on se souvient des sympathies d’un Édouard VII ou d’un lord Halifax pour le régime nazi. Originale autant que glaçante, elle contient tous les ingrédients nécessaires à passer une nuit blanche.
Construit sur le même modèle que le premier tome autour de deux personnages principaux, l’inspecteur Carmichael et Viola Lark qui a fui son milieu d’origine pour intégrer cette troupe de théâtre, Hamlet au paradis poursuit sa peinture d’une aristocratie anglaise compromise et vérolée par le mal en même temps qu’il nous tient en haleine jusqu’à la dernière page.
Quelque chose nous dit que le dernier volume du subtil changement, Half a Crown (la moitié d’une couronne), non seulement apportera les réponses aux questions d’un Carmichael qui ressemble un peu au Bernie Gunther de Philip Kerr, mais surtout révélera l’extraordinaire machination bâtie par Walton. Shakespeare n’écrivait-il pas dans sa pièce maîtresse que « nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce nous pouvons être » ?
Jo Walton, Hamlet au paradis, Denoël, 2015
Laurent Pfaadt