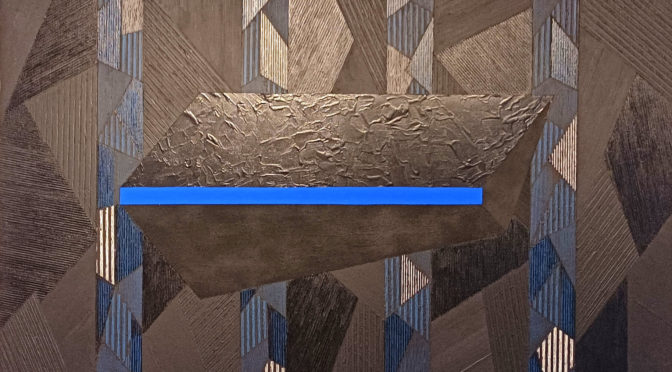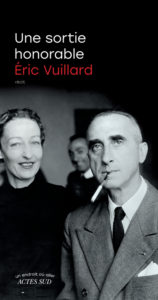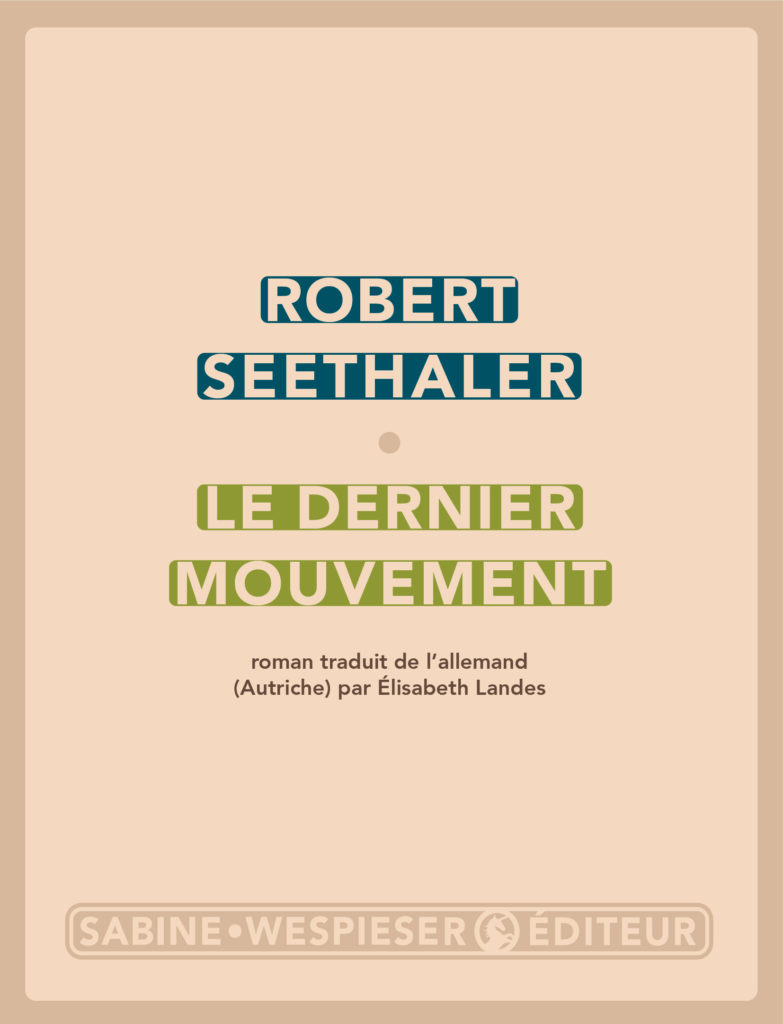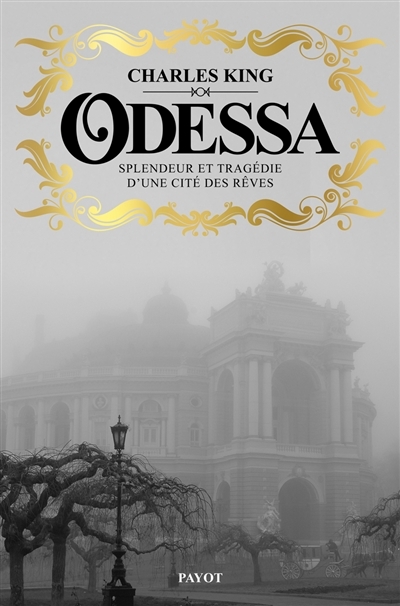Les 24 et 25 février derniers, l’intégrale des cinq concertos pour
violon et orchestre de Mozart joué par le violoniste David Grimal
restera un évènement musical exceptionnel, tant sous l’angle de la
performance technique que par l’engagement esthétique de
l’interprète.
C’est durant la seule année 1775 que Mozart, jeune de ses 19 ans
mais déjà auteur d’œuvres remarquables, compose l’ensemble de ses
concertos pour violon. Si l’aspect divertissant et décoratif de la
forme concertante domine encore les deux premiers, les trois autres
offrent en revanche une inventivité et une complexité d’écriture qui
annoncent les futures grandes œuvres, notamment celles pour piano
et orchestre ; car Mozart, dans sa maturité, ne reviendra pas au
concerto pour violon si ce n’est lors de tentatives ou d’ébauches
jamais abouties, comme si le genre restait pour lui entaché de la
servitude des années passées au service du prince-archevêque de
Salzbourg.
Même si huit mois seulement séparent leur composition, l’étonnante
progression, qui s’accomplit entre le premier et le dernier de ces
concertos, n’est jamais autant sensible que lorsque l’on a la chance
de les entendre dans leur succession. Fort bien soutenu par un petit
ensemble d’une vingtaine de musiciens et leur premier violon
Charlotte Juillard, David Grimal insuffle dans ce corpus mozartien
une vitalité juvénile hautement stimulante et parfaitement en
situation, si l’on tient compte de la durée d’un concert de presque
trois heures obligeant à aller de l’avant. Les tempi ne s’enlisent pas,
c’est le moins que l’on puisse dire, au risque d’altérer parfois la
volupté mélodique comme, par exemple, dans le premier
mouvement des quatrième et cinquième concertos. Ce n’est
toutefois qu’une mince réserve car, pour le reste, on est surtout
conquis par la grande liberté d’un jeu radieux, tant chez le soliste
que dans l’orchestre. Si la grâce des deux premiers concertos est
particulièrement bien rendue, leur jeu fluide, libre et spontané nous
vaut un des plus beaux troisième qu’il m’ait été donné d’entendre.
Faut-il par ailleurs attribuer aux archets d’époque procurés par
David Grimal cette sonorité de cordes particulièrement douce
entendue ces deux soirs ? Les musiciens jouaient en effet avec des
archets différents (plus courts), mais sur leurs instruments habituels.
Quant aux deux cors, hautbois (et flutes dans le troisième concerto),
il s’agissait de factures actuelles. Un pas dans l’historiquement
informé, un autre dans la modernité puisque Grimal a repris pour
son concert de Strasbourg les cadences (talentueuses) qu’il avait
faites écrire par le compositeur Brice Pauset à l’occasion de son
enregistrement des mêmes concertos effectué en 2015 avec son
ensemble Les Dissonances.
La soirée, celle de vendredi du moins, s’est achevée avec un bis offert
en solidarité avec l’Ukraine en guerre : le grave de la sonate pour
violon n°2 de Bach, joué du coup avec une extrême gravité, dans un
son de stradivarius d’une beauté renversante.
Par Michel Le Gris