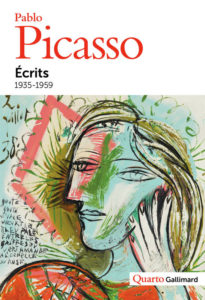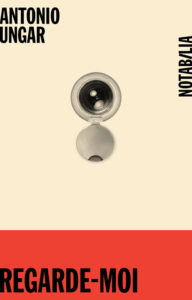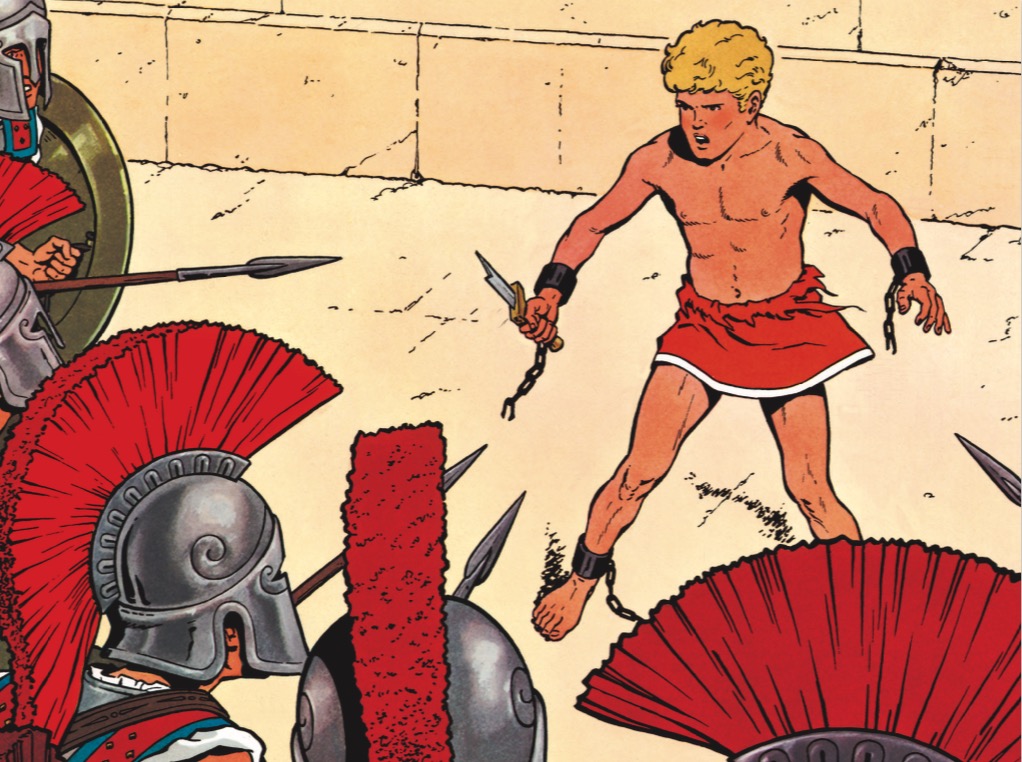La Maison du Danemark invite à découvrir l’art des îles Féroé

C’est un tout petit archipel – à peine plus de 50 000 habitants – et
pourtant d’une vitalité artistique exceptionnelle comme en
témoigne cette exposition présentée au Bicolore, la plateforme d’art
contemporain de la Maison du Danemark. Empruntant le titre de
l’exposition au poète danois Thomas Kingo (1634-1703), elle met en
lumière quatre artistes sélectionnés par la commissaire de
l’exposition, Kinna Poulsen : Ingalvu av Reyn, sorte de père
fondateur de l’art féroïen et héraut d’un naturalisme artistique,
Hansina Iversen, présente à l’occasion d’un Artist Talk, Zacharias
Heinesen, artiste majeur des Féroé qui résida par deux fois à la cité
des arts de Paris et Rannva Kunoy. Immédiatement, les influences
sautent aux yeux : Cézanne dans Reyn, abstraction américaine chez
Iversen dont les couleurs et en particulier ce rose qui enveloppe
cette nouvelle série de toiles rappelle un Willem de Kooning qu’elle
vit à New York et Nicolas de Staël chez Heinesen. Pour beaucoup
d’artistes féroïens, la France et Paris tout particulièrement
constituèrent des sources d’inspiration majeures. Autant dire que
cette exposition constitue une sorte de retour aux sources.
L’art féroïen n’ayant qu’une petite centaine d’années, Kinna Poulsen
a décidé de mettre l’accent sur sa florissante création
contemporaine. Si la nature constitue toujours un vecteur créatif
important, les toiles présentées se signalent par leur lumière
jaillissante, avec des couleurs saturées chez Iversen ou un jeu
tridimensionnel absolument fascinant, particulièrement marqué
chez Kunnoy notamment dans cette incroyable Study qui dispense
un jaune magnétique. Hansina Iversen qui s’est formée en Islande et
en Finlande est ainsi revenue sur sa conception de l’art, sur son
travail consistant à « construire un monde dans le monde, un espace
dans l’espace » dans lequel, elle travaille une peinture à l’huile qui
permet plus de transparence tout en libérant ses mouvements qui
dessinent de merveilleux aplats. Mais elle confesse également que
l’environnement impacte également son art, d’où son retour dans
ses Féroé natales afin de permettre « l’accomplissement de mon
langage artistique, de mon identité pour être moi-même ».
Une commissaire d’exposition, une artiste peintre perdue dans un
monde d’hommes, une traductrice et une journaliste danoise. Un
directeur du Bicolore qui salue le public d’un « Bonjour Madame,
Monsieur et Troisième genre ». Une fois de plus, le Danemark a été
plus qu’un éclat de soleil mais bel et bien un phare. Et dehors, une
lumière comme venue du Nord baignait la plus belle avenue du
monde. Comme pour illuminer cette belle découverte picturale à ne
pas rater.
Par Laurent Pfaadt
Un éclat de soleil, Art des îles Féroé, Le Bicolore,
Maison du Danemark, 142 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Jusqu’au 13 mars 2022